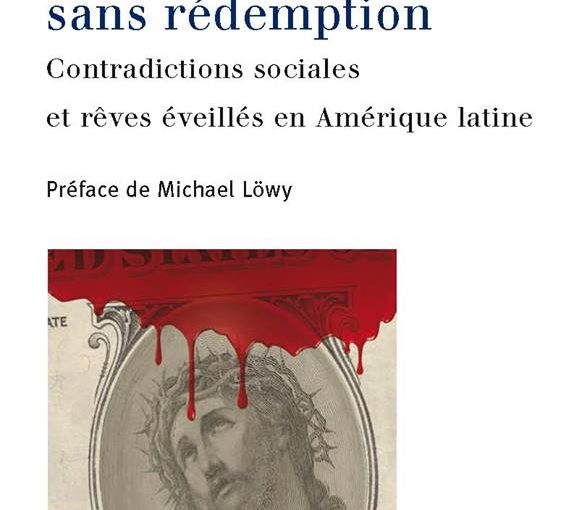Conférence : Mexique, un pays, plusieurs pouvoirs ?
jeudi 8 octobre à 19:30
Maison De l’Amérique Latine
rue du collège 27, 1050 Bruxelles
Avec Luis Martinez Andrade Sociologue Mexicain et auteur du livre “Religion sans rédemption” parut aux éditions Van Dieren en 2015.
Entrée gratuite.
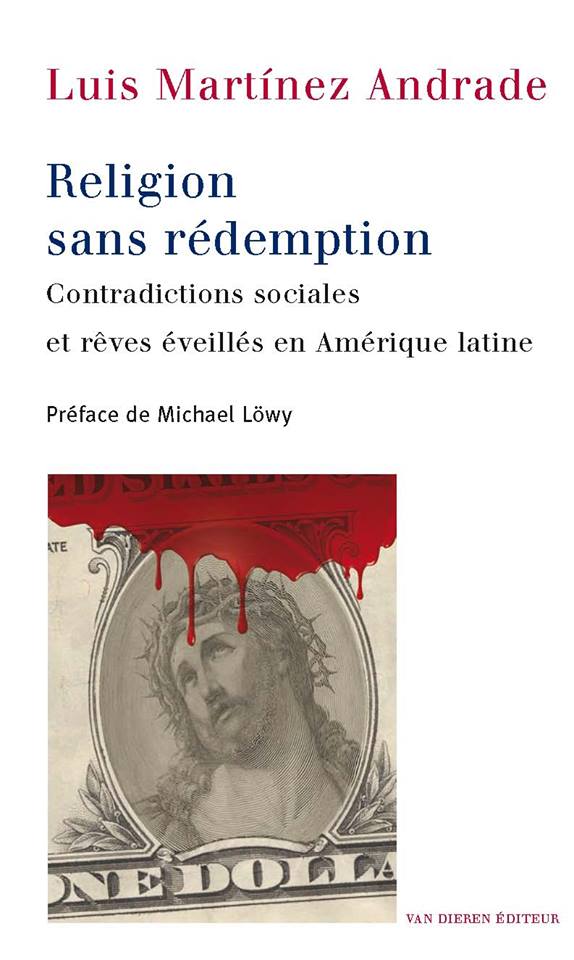
L’extrait ci-dessous est la préface de Renan Vega Cantor.
Luis Martínez Andrade, Religion sans rédemption. Contradictions sociales et rêves éveillés en Amérique latine, éd. van Dieren, 2015, 192 p., 20€.
L’ouvrage que vous tenez entre vos mains a été écrit par Luis Martínez Andrade, jeune sociologue né au Mexique mais dont l’inspiration intellectuelle s’est nourrie de la pensée critique universelle et de ce que notre Amérique a de plus abouti. Bien que jeune par l’âge et par sa passion, par la force et l’esprit polémique qui animent son style et son écriture, il fait preuve d’une grande maturité par son extrême rigueur et son sérieux intellectuel, comme le montre chacun des essais réunis ici. Comme l’auteur l’affirme lui-même, ce livre est né de la rage et de l’espoir : la rage que provoquent l’injustice, l’exploitation et l’inégalité qui caractérisent le monde d’aujourd’hui et plus particulièrement notre continent, et l’espoir, qui s’enrichit de l’esprit des « rêves éveillés » autour duquel s’articule le Principe Espérance, œuvre phare du penseur marxiste Ernst Bloch. Cet espoir est indispensable pour ne pas tomber dans le défaitisme et le scepticisme. Il alimente également les revendications de la lutte que livrent les vaincus d’aujourd’hui et de toujours dans le but d’établir un ordre social qui puisse aller au-delà du capitalisme bien réel, un capitalisme caractérisé en outre sur notre continent par la dépendance néocoloniale.
La force de pensée de Luis Martínez a déjà été saluée dans divers pays de notre Amérique, aussi bien par la publication dans plusieurs pays de ses articles et essais que par la reconnaissance intellectuelle qu’il a méritée. Il convient de souligner qu’il a obtenu le Premier Prix de la sixième édition du concours « Pensar a Contracorriente », décerné par l’Instituto Cubano del Libro, pour son essai « El centro comercial como figura paradigmática del discurso neocolonial » (Le centre commercial comme figure paradigmatique du discours néocolonial), qui constitue le deuxième chapitre de ce livre. Nous avons ici à faire à un écrivain expérimenté malgré son jeune âge, et porté par la flamme de sa tâche intellectuelle et théorique.
Les essais qui composent ce livre ne sont en apparence unis par aucun lien thématique. Néanmoins, on se rend compte avec un peu d’attention de la présence de certains fils conducteurs essentiels, dont nous parlerons brièvement ci-après.
Critique de la colonialité du pouvoir, du capitalisme et de l’eurocentrisme
L’auteur nourrit son analyse de différentes littératures, mais surtout de celle liée au système-monde capitaliste et de certains écrits postcoloniaux qui sont apparus dans notre Amérique ces dernières années. De cette façon, il propose une étude de ce continent fondée sur la thèse selon laquelle le colonialisme qui s’est imposé sur ces terres avec ce qu’on a nommé à tort la « découverte de l’Amérique » par les Espagnols est resté intact durant ces cinq derniers siècles, malgré l’indépendance du XIXe siècle sur laquelle on a tant glosé.
La conquête sanglante de 1492 a établi des formes de subordination, de domination et d’exploitation qui, dans le fond, et malgré quelques changements mineurs, sont demeurées inchangées. Parmi ces aspects, l’auteur met en évidence l’eurocentrisme, et notre statut de « périphérie du capitalisme » – fournisseuse de matières premières dans une espèce de tragédie discontinue et récemment renforcée par la signature des Accords de libre-échange avec les puissances capitalistes hégémoniques. L’étude aborde également l’implantation de la colonialité du pouvoir ; par cette ex- pression, empruntée principalement au penseur péruvien Aníbal Quijano, l’auteur fait référence à la dépendance historico-structurelle qui a modelé les sociétés latino- américaines depuis la conquête des Amériques et qui s’est fondée dès le début sur la subordination violente et symbolique des indigènes à l’absolu universel de l’Occident.
Dans cette perspective, l’auteur analyse le processus d’exclusion qui a présidé à la formation des États-nations suite à la rupture avec les métropoles européennes. Dans ces nouveaux États, en effet, la majeure partie de la population a été marginalisée et considérée comme inférieure par les classes dominantes, qui se prétendaient continuatrices du legs européen et se sont basées sur les mêmes préjugés d’une prétendue supériorité raciale et culturelle. Cette attitude a tout simplement marqué l’émergence du colonialisme interne, qui a remplacé le colonialisme des Européens, mais a maintenu la même logique de ségrégation, de domination, de racisme et d’exploitation contre les noirs, les indigènes et les métis, imposée en Amérique depuis la fin du XVe siècle.
Ainsi, à partir de la notion de « colonialité du savoir », Martínez examine les caractéristiques de l’eurocentrisme qui a vu le jour à l’époque coloniale, mais qui subsiste encore à l’heure actuelle et s’exprime dans les milieux universitaires à travers les sciences sociales, qui reproduisent la dépendance et la domination coloniales tout en employant des langages différents, voire des positions épistémologiques différentes. Prenant le contre-pied de cette perspective eurocentrique, l’auteur de ce livre affirme qu’il est nécessaire de prôner une décolonisation de ces sciences sociales pour aller au-delà des paradigmes épistémiques néocoloniaux, ce qui est indispensable au processus de libération des sociétés latino-américaines du fardeau colonial.
L’auteur se garde bien de tomber dans les réductionnismes propres à certains courants de la théorie de la dépendance qui ne faisaient qu’exalter les formes de subordination coloniale sans étudier les mécanismes de lutte et de résistance des peuples. Il faut relever que dès la constitution du colonialisme, les peuples indigènes, et par la suite les Africains réduits en esclavage ainsi que les métis, livrèrent une lutte acharnée ; et cette lutte se poursuit aujourd’hui encore dans diverses régions de notre continent.
Revendication d’une analyse de la religion en tant que cri de révolte des pauvres contre l’exploitation
Comme l’indique le titre même du livre, la religion traverse tout le livre, avec pour prémisse de ne pas seulement la considérer, ni de manière exclusive, comme l’opium du peuple (sans exclure bien entendu, la possibilité que la religion sous son aspect dominateur et oppressant continue à jouer ce rôle), mais également comme un vecteur de résistance, d’espoir, de lutte et de rédemption. Pour cela, l’auteur se base sur les apports de Ernst Bloch, qui sont nourris et complétés ici par les contributions d’Enrique Dussel, de Frei Betto, de Leonardo Boff et d’Ernesto Cardenal. En s’appuyant sur Ernst Bloch, Martínez rappelle que, pour le penseur allemand, la religion exprime un désir utopique de rédemption et est, en même temps, ambivalente, car « elle peut renforcer idéologiquement et politiquement un système d’oppression » ou encore « faire office de discours critique de cette domination ». C’est ce dernier aspect que Martínez relève dans tous les chapitres de ce livre, étant donné qu’il cherche à établir les mécanismes par lesquels, dans notre Amérique, la religion en tant que « christianisme des pauvres », pour reprendre la belle expression de Michael Löwy, devient subversive et s’oppose à différentes formes d’exploitation, de subordination et de dépendance. Vu de ce point de vue utopico-subversif, le phénomène religieux devient clairement la pierre angulaire de la lutte contre le capitalisme et l’impérialisme présents sur notre continent. Cette tendance a pu être observée au cours de la seconde moitié du siècle avec l’émergence de la théologie de la libération, qui a orienté certaines actions et réflexions critiques et révolutionnaires au Brésil et dans d’autres pays de notre Amérique.
En ce qui concerne cette autre façon de voir la religion, Martínez reprend une citation de Bloch dans laquelle il ressort que la religion ne doit pas être lue exclusivement comme étant l’opium du peuple, car « tout dépend des hommes et de la situation dans laquelle on se trouve lorsqu’on prêche la parole de Dieu ». La prédication de Thomas Muntzer, par exemple, même si elle est souvent considérée comme de la « servitude céleste », ne servait pas d’opium pour le peuple. « Si l’illumination produite par la lanterne des rêves dans le royaume des ombres est toujours fantasmagorique et toujours la même, elle dépend également de la détermination conceptuelle et de la délimitation du réel ».
L’importance théorique, méthodologique et politique de cette approche de la religion est particulièrement importante pour nous aujourd’hui si on considère d’une part, l’émergence des luttes anticapitalistes menées par des gens du peuple profondément croyants, et d’autre part, l’imposition de divers fondamentalismes, parmi lesquels celui du marché (néolibéralisme). Pour ce qui est de cette dernière question, il est vital que les nouvelles idoles de la mort, comme les appellent les théologiens de la libération, jettent le masque ! Ces idoles renforcent la domination et l’exploitation, au nom de forces « objectives » et « incontrôlables » telles que le marché (un euphémisme de notre temps pour éviter de prononcer le vrai nom de la « bête », le capitalisme), guidé par une prétendue « main invisible », qui détermine qui sont les « bons » (les capitalistes et leurs partisans, considérés comme les vainqueurs couronnés de succès) et qui sont les « méchants » du film (les pauvres et les exclus de la société, considérés comme inefficaces, improductifs, comme des ratés voués à l’échec, selon un scénario préétabli dans le style vulgaire d’Hollywood).
Pour ce qui est du premier aspect, on relève que, au milieu de l’abandon de la réflexion théorique et de la prostration politique d’une grande partie de ceux qui se présentaient comme révolutionnaires, ces croyants pauvres ont, adopté le langage du social-conformisme et du défaitisme politique. Les mêmes considèrent désormais le capitalisme comme indépassable. Au contraire, les théologiens de la libération, comme Leonardo Boff, affirment avec une lucidité impressionnante :
Toute oppression spécifique requiert également une libération spécifique. Cependant, il ne faut pas perdre de vue l’oppression fondamentale, qui est socio-économique. Les autres sont toujours des surdéterminations de cette oppression de base. L’oppression socio-économique renvoie à la lutte des classes et, avec elle, les groupes expriment leur antagonisme et leurs intérêts irréconciliables. La lutte de la femme, du Noir ou de l’Indien met en jeu des groupes qui ne sont pas antagoniques par nature […] L’ouvrier exploité dans notre système ne pourra jamais se réconcilier avec le patron qui l’exploite. Cette oppression socio-économique accentue les autres types d’oppression, car les Noirs, les Indiens et les femmes sont davantage dominés lorsqu’ils sont exploités et appauvris.
Nous avons repris cette citation de Boff, rapportée par Martínez dans ce livre, car nous pensons qu’elle éclaire l’importance de l’analyse des classes en Amérique latine. De même, montre-t-elle le sens profond de l’analyse sociale réalisée par la théologie de la libération pour percer les mécanismes d’exploitation qui entretiennent l’inégalité sur le continent, où les pauvres sont de fervents croyants.
Le capitalisme en tant que relation destructrice des corps des travailleurs et de la nature
On retrouve cette idée fondamentale à plusieurs moments de cette étude. Elle est tirée de l’analyse classique et indépassable de la critique de l’économie politique de Karl Marx, dans laquelle sont mis à nu les mécanismes centraux qui, dans la logique capitaliste, détruisent la nature et anéantissent les êtres humains, y compris physiquement. Concernant l’exploitation des travailleurs, l’auteur reprend dans son analyse la création de la notion de plus-value, utilisant sans crainte ce terme aujourd’hui banni par les tendances dominantes des sciences sociales et de l’économie dans les divers espaces de notre Amérique où se sont implantées les usines et les fabriques de la mort, où est produite la plus-value que se sont appropriée tant les capitalistes du pays que les étrangers, ce qui explique en grande partie l’accentuation des inégalités locales et mondiales entre une poignée de riches et un grand nombre de pauvres et d’indigents.
Concernant le corps, Luis Martínez se base sur des prémisses très différentes de celles que l’on retrouve dans un certain discours postmoderne et dans des études culturelles, qui se penchent sur le corps, consommateur et sensuel, de certains secteurs de la petite bourgeoisie et non sur le corps outragé des travailleurs. Par conséquent, pour Martínez, il convient de partir du domaine de la production, lieu de l’exploitation directe. C’est le cas des maquiladoras, qui aujourd’hui s’étendent comme une tache d’huile sur tout le continent :
Dans les maquiladoras, c’est dans la douleur, et parfois même dans le sang, que l’on produit les objets discursifs du récit colonial que sont les soi- disant marchandises postmodernes. La fabrique est un élément fondamental et « occulte » – tout comme l’est la valeur de la marchandise – des firmes internationales […]. Derrière les vitrines et les marques se trouve non seulement un processus d’objectivation du travail mais aussi une pratique historique de l’exploitation matérielle de la périphérie par le centre.
La reprise de l’analyse, dans les termes de la théorie de la valeur-travail, du domaine de la production, permet à l’auteur de situer les conditions d’exploitation dans lesquels sont produites les diverses marchandises qui sont achetées et vendues de par le monde. Dans ce domaine, les « centres commerciaux » jouent un rôle prédominant. Un chapitre spécial leur est d’ailleurs consacré. Ce chapitre reprend l’analyse de la corporéité à partir d’un point de vue différent, répétons-le, de celui de l’habituelle logorrhée du postmodernisme, qui exalte, de manière isolée, la question de la consommation individuelle, ignorant le caractère central de la production et de l’exploitation. Le Centre commercial est la cathédrale de notre époque. Les marchandises y défilent brillant de mille feux, comme si elles étaient vivantes et comme si elles avaient atterri dans ces vitrines grâce au souffle divin, et non grâce au travail de l’homme. Un travail, qui plus est, toujours plus dégradé et plus occulte. Dans ces centres de consommation, on a voulu effacer les différences de classe, d’où cette impression caractéristique d’asepsie, d’ordre et de discipline. Mais en fin de compte, ce qui est reproduit là-bas, c’est l’American way of life, marqué par l’esprit de classe et l’exclusion, qui transforme chaque centre commercial en un apartheid à petite échelle, c’est-à-dire en « une forme spécifique de ségrégation qui repose sur des caractéristiques soma- tiques, économiques et culturelles ».
En ce qui concerne la destruction de la nature, le second aspect néfaste du capitalisme, Luis Martínez parle des origines structurelles de l’écocide qui est en marche. Pour cela, il se base, une fois de plus, directement sur les théories de Marx en y adjoignant les idées de Bloch et les perspectives environnementales de la théologie de la libération, émanant principalement de Leonardo Boff. De Marx, il reprend l’idée de base selon laquelle le capitalisme détruit la nature en raison de l’accroissement de son processus de marchandisation et selon laquelle l’art de saigner à blanc le travailleur représente également l’anéantissement des conditions de production, autrement dit les milieux physiques et naturels. De Bloch, il reprend l’idée d’« humanisation de la nature », que Marx avait déjà énoncée dans les Manuscrits de 1844 et qui permet de rompre avec cette fausse dichotomie écocidaire entre l’humanité et la nature, comme si nous ne faisions pas partie de cette nature et comme s’il n’y avait guère de limites naturelles à l’action du capitalisme. C’est pour cela que Luis Martínez mentionne en cours de route la complémentarité et non l’antagonisme entre le Principe Espérance, défendu par Ernst Bloch, et le Principe Responsabilité, énoncé par Hans Jonas – un critique de Bloch – déjà présent chez Leonardo Boff dans sa proposition de créer une nouvelle bio-civilisation qui reposerait sur cinq piliers : l’utilisation durable des ressources naturelles limitées ; la primauté de la valeur d’usage sur la valeur d’échange ; un contrôle démocratique exercé par le peuple et non dirigé de manière totalitaire par le marché ; un ethos fondé sur la responsabilité universelle, qui préconiserait la solidarité, la compassion, l’entraide ; et la spiritualité « en tant qu’expression de la singularité de l’Homme et non en tant que monopole des religions ».
L’ouverture d’esprit et la fermeté politique d’un auteur se révèlent en grande partie dans les sources qui inspirent son travail de recherche. Ainsi, dans le cas de Luis Martínez, les sources théoriques sont diverses et multiples : différentes tendances du marxisme (Antonio Gramsci, Walter Benjamin, l’École de Francfort, Ernst Bloch, Michael Löwy), l’analyse du système-monde (Immanuel Wallerstein), la philosophie de la libération (Enrique Dussel), le post-colonialisme (Aníbal Quijano et Walter Mignolo), les études subalternes (Ranahit Guha), la théologie de la libération (Leonardo Boff et Frei Betto) et bon nombre d’autres auteurs, que nous ne citerons pas mais que le lecteur pourra retrouver dans la bibliographie très fournie à la fin de cet ouvrage.
Naturellement, il ne suffit pas de répertorier la diversité des sources bibliographiques ; encore faut-il souligner la lecture personnelle et critique qu’en fait l’auteur. À ce sujet, dans les divers essais qu’il a rédigés ici, l’auteur procède de la manière suivante. Tout d’abord, il reprend la pensée d’un auteur déterminé (comme Ernst Bloch ou Slavoj Žižek) le plus fidèlement possible. À partir de là, il envisage de nombreux aspects liés non seulement aux idées de ce penseur mais aussi aux conséquences qui découlent de ce mode de réflexion et qui touchent d’autres aspects de la pensée et de la réalité sociale de notre Amérique. Grâce à ce procédé analytique, l’auteur nous entraîne sur des chemins inattendus et surprenants. C’est le cas lorsque, par exemple, après avoir analysé certains aspects fondamentaux du Principe Espérance, il en recherche les traces dans l’œuvre du théologien de la libération, Leonardo Boff, qui affirme dans un texte tout en force et en conviction : « Je me refuse à accepter que les souffrances de millions d’esclaves, d’indigènes, de personnes humiliées et offensées de notre histoire aient été vaines. Je crois plutôt que ces souffrances ont favorisé une telle accumulation de force et une telle exigence de transformation que, finalement, l’heure est venue. Dans le cas contraire, l’histoire serait absurde, et le cynisme des plus recommandables ». C’est là que se rejoignent la mémoire historique de la lutte des pauvres et l’espoir d’un futur différent. En d’autres mots, c’est là que réapparaît la force vitale de la pensée espérance d’Ernst Bloch. Néanmoins, celle-ci n’est plus alimentée par l’Europe conservatrice que nous connaissons aujourd’hui, mais par les projets sociaux anticapitalistes qui voient le jour dans divers endroits de notre Amérique.
L’ouverture d’esprit de notre auteur lui permet de s’entretenir avec une grande partie des représentants du postmodernisme, pour affronter de façon critique les banalités postmodernes sur la fin des projets d’émancipation, le conformisme de ce courant, et en dernier ressort, son apologie du capitalisme comme s’il s’agissait en réalité de la fin de l’histoire. À ce sujet, il remet en question l’éclectisme du postmodernisme, qui réduit les diverses opinions sur la société à des “paramètres éthiques” », d’où on suppose l’acceptation de tout, car tout « peut se concevoir comme une « expérience esthétique », depuis les meurtres d’enfants dans les rues du Brésil jusqu’aux agressions d’étrangers dans un métro de Barcelone, en passant par l’aide humanitaire propre à la philosophie ONGiste ou par l’écotourisme des « bonnes consciences européennes ». Débattant du logos postmoderne, qu’il apparente à la culture New Age, Luis Martínez revendique l’importance de la raison, non pas du point de vue du bourreau, mais d’un point de vue révolutionnaire et contestataire, dans la mesure où la raison s’articule autour d’un projet de transformation sociale dont nous avons tant besoin. Nous en avons besoin, en effet, pour surmonter la crise de civilisation et l’écocide, comme c’est le cas en ce moment dans le Golfe du Mexique, résultat d’une recherche pétrolière insatiable, à laquelle nous a conduits le capitalisme et pour construire à la place une société émancipée, libérée de l’exploitation et des diverses formes de domination coloniale.
Renan Vega Cantor
Prix « Libertador al Pensamiento Crítico » 2007
Bogota, 7 juin 2010 © éditions Van Dieren.