Lire la presse en 1914 – 1918, c’est faire face à une information officiellement tronquée et aménagée, pour des raisons psychologiques aussi bien que stratégiques, qui conduisent par exemple à minimiser ou à masquer les victoires de l’adversaire, et à mettre en avant ses défaites.
C’est la guerre. Ce n’est pas moi qui le dit, mais plusieurs médias, qui s’interrogent de manière insistante sur la couverture à donner aux attentats jihadistes. Non plus, comme à l’époque des premières vidéos de décapitation, pour protéger le public d’une violence insoutenable – débat par ailleurs classique. Mais pour filtrer, anonymiser, affaiblir la communication terroriste, dont la propriété est traditionnellement de profiter de l’amplification médiatique. Après l’éditorial de Jérôme Fenoglio indiquant que Le Monde « ne publiera plus les photographies des auteurs des tueries pour éviter d’éventuels effets de glorification posthume », Libération illustre à son tour de façon frappante cette mise en retrait par le découpage des visages ou du corps des auteurs d’attentats.

Extrait de la vidéo de l’exécution de David Haines, diffusé par BFMTV, 14/09/2014.



Libération, 29/07/2016.
Malgré l’évocation des devoirs de l’information, pieusement rappelés par Laurent Joffrin, lorsque la presse s’interroge ouvertement sur ce qu’elle doit cacher, c’est qu’on a changé de régime. Comme l’expliquait ce matin Alexandra Schwarzbrod sur France Culture, ce débat s’appuie notamment sur des réactions de lecteurs, qui expriment un effet de « saturation ». On retrouve donc ici les manifestations d’une censure avouée, qui ne relève plus seulement de la marge d’appréciation éditoriale, mais d’un changement d’état plus global de la société, qui s’inscrit désormais dans la logique d’une communication de guerre.
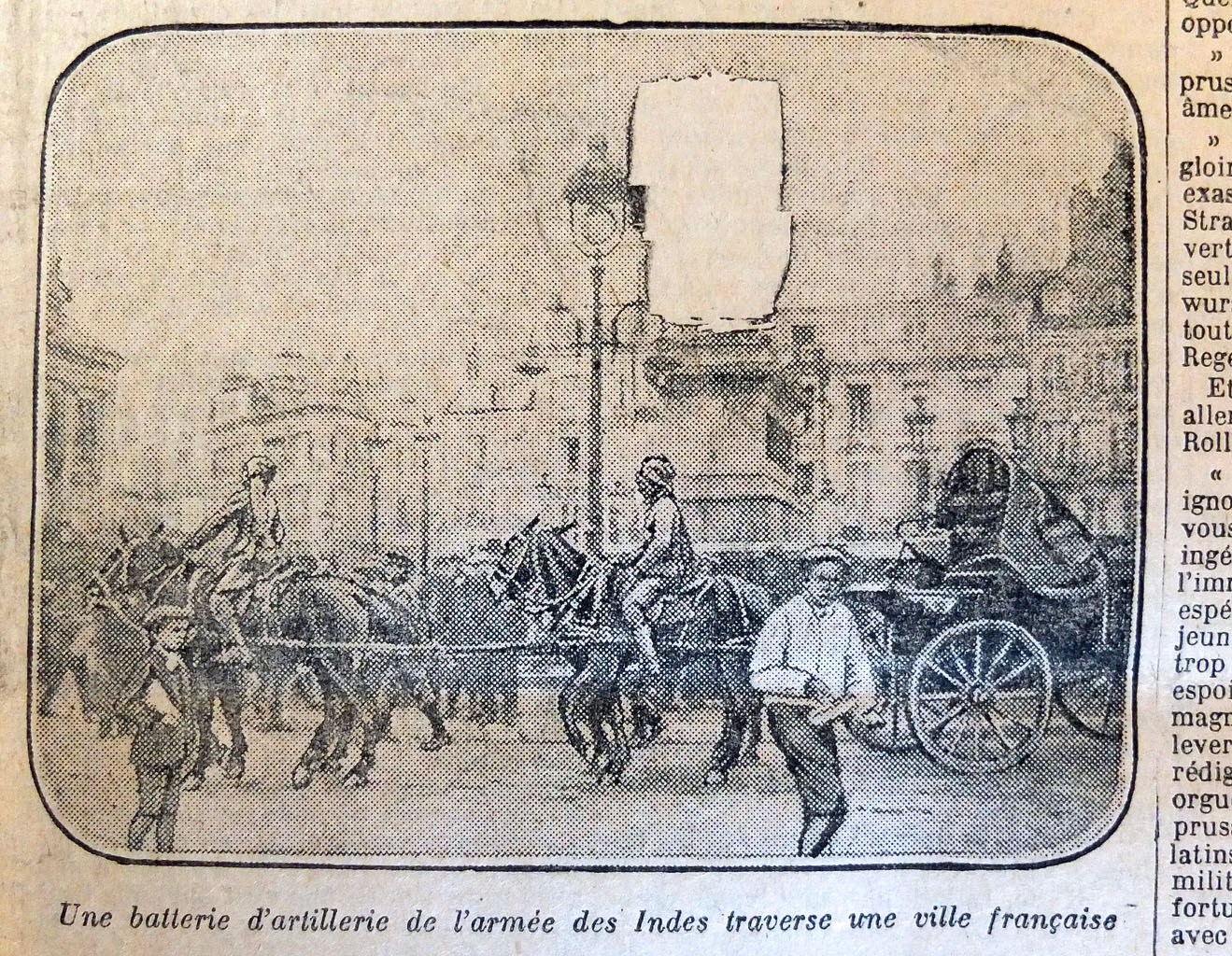
Photo caviardée, Le Journal, 19 octobre 1914.
Lire la presse en 1914 – 1918, c’est faire face à une information officiellement tronquée et aménagée, pour des raisons psychologiques aussi bien que stratégiques, qui conduisent par exemple à minimiser ou à masquer les victoires de l’adversaire, et à mettre en avant ses défaites.

Le Petit Parisien, 9 août 1914.
A l’inverse, le traitement naïf de l’actualité, amplifié par la communication gouvernementale et par la caisse de résonance des breaking news, a alimenté jusqu’à présent le paradoxe consistant à assurer la communication de l’ennemi, et à mettre en avant ses victoires à travers l’imagerie des attentats. L’absence d’une illustration des succès de la stratégie antiterroriste est rendue d’autant plus flagrante par la répétition d’une iconographie du deuil, de l’hommage ou du recueillement, dont on aperçoit les limites en termes de consolation. Tel est du moins le sentiment suggéré par le débat actuel, qui propose d’adapter le traitement médiatique à la perception d’une situation d’antagonisme hystérisé.

En conseillant de représenter désormais les terroristes affublés d’un nez de clown et de dents de lapin, un journal satirique allemand pousse à sa limite parodique ce questionnement. Comme l’écrit Joffrin, « une photo publiée ne changera rien à la stratégie des terroristes ». Ce qu’elle modifie en revanche, c’est la réception du fait terroriste pour le grand public, premier destinataire de l’information, qui marque aujourd’hui sa réticence à avaliser sans broncher la valorisation publique des attentats.


