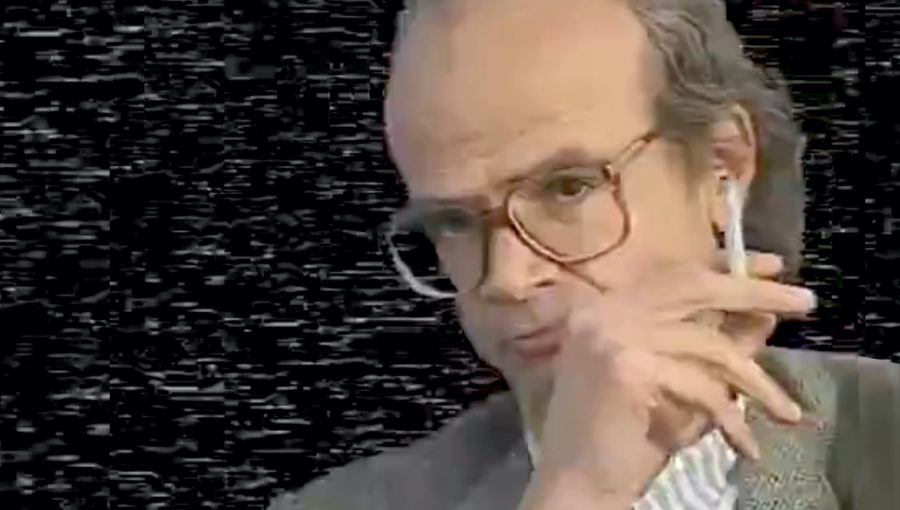Et puis c’est une machine qui, contrairement au cinéma, marche à la nervosité et non pas à l’amour : Le caméraman filme le pape comme il filmerait un extincteur.
«Il faudrait parler de la lumière froide de la télévision ; pourquoi elle est inoffensive pour l'imagination (y compris celle des enfants) pour la raison qu'elle ne véhicule plus aucun imaginaire et ceci pour la simple raison que ce n'est plus une image». Jean Baudrillard. 1980.
La rhétorique de l’image dans la presse écrite
« Après 1968, lorsque s’est ouvert le dernier chapitre du puritanisme anti-média, Libération est passé de la façon dont les gauchistes méprisaient l’image en général à un retournement à 180 degrés, pour tenter, à la suite de Barthes, de regrouper des petits sémiologues (portatifs) de tous les phénomènes médiatiques. Cet intérêt particulier pour l’image est enraciné dans l’histoire même de Libération qui prend place exactement entre la fin du vieux discours puritain « contenu-contenu » et, dans les années 80, l’attrait pour les rhétoriques d’images. On était habitué au « hard », c’est-à-dire à la propagande, on méprisait la publicité, désormais entre la propagande et la publicité, il existait une place où un journal malin pouvait s’insérer : la rhétorique d’image, l’idée que l’image c’est de la rhétorique et que cette rhétorique veut nous faire penser.
Or, la télévision produit une rhétorique tellement pauvre, tellement misérable par rapport à ce qu’a été la rhétorique à son âge d’or, qu’il suffit de la regarder avec ce point de vue là, avec ce désir là, pour y trouver beaucoup de choses. La télévision a, avait, un tel monopole de la représentation publique que longtemps elle n’a prêté aucune attention à sa propre façon de travailler. Puis, comme elle s’est vue observée sur sa pratique (surtout par Libération), elle a commencé à intégrer ce qu’on pouvait dire d’elle et les rhétoriques se sont affinées.
Sous l’impulsion de M. Cressolles et G. Hocquenghem, Libération est le premier journal qui, au début des années 80, a créé une rubrique « télévision » un peu paradoxale parce qu’elle était faite par des hommes qui aimaient la télévision c’est-à-dire qui ne jouaient ni la servilité (France-soir) ni le mépris des gens de l’écrit par rapport à l’image (Le Monde). Ce qui était nouveau c’est qu’ils regardaient la télévision sans préjugés, à la fois avec affection et méchanceté. Ce traitement de la télévision a duré quelques années puis s’est délité.
Mais Libération a joué son rôle c’est-à-dire faire admettre à tous les intellectuels, à tous les médiateurs que la télévision faisait partie de ce qui leur était imposé, de leur réalité : il fallait donc en parler. Puis l’idée s’est répandue et les hebdomadaires se sont livrés avec recyclage tardif (peut-être trop tardif !) de Barthes et Lacan. Si ce phénomène est né et s’est développé d’abord à Libération c’est que ce journal a un rapport à l’image moins puritain, moins peureux que la plupart des quotidiens. Il ne faut pas oublier, par exemple, ce qu’est l’image pour un journal comme Le Monde qui n’utilise des photos que pour illustrer une exposition de photographies !
D’une façon plus générale, si les journaux ne parlent que très peu de la télévision c’est que, par dépit, ils ne veulent pas lui rendre ce qu’elle leur a volé. La télévision a volé à la presse le journal télévisé, les rubriques, la vidéo, la mise en pages… Tout le vocabulaire de la télévision est un vocabulaire de l’écrit et pas du tout de l’image, il n’y a pas d’image à la télévision, il n’y a que de l’écrit : L’écrit au sens de lire, décrypter, tourner les pages… etc est entièrement passé à la télévision. Ce qui reste d’écrit, dans la presse quotidienne qui, en France, est peu lue et peu vendue, se trouve spolié. Or les quotidiens traitent la même matière que la télévision et aujourd’hui ne la traitent pas fondamentalement différemment. La façon de classer, de parler est la même dans les journaux et à la télévision ; les journaux télévisés de 13h et 20h sont des rendez- vous et servent de base de travail aux rédactions (même à Libération) qui confrontent leur projet avec ce que fait la télévision.

Le triomphe du décryptage
Il n’y a pas d’image à la télévision. D’abord il y a principalement des sons, de la parole. Ensuite, ce qui est donné à voir, ce ne sont pas des images, ce sont des flux visuels. Le visuel se réduit à des signaux, à une codification, à une signalisation qui suffisent largement pour le peu d’information qui est véhiculé par la télévision. De ce fait, les premières critiques de télévision dans la presse étaient très moralisantes. Il s’agissait de témoigner du moment où quelqu’un avait travaillé, avait produit un travail vivant à la télévision. Car 90% de la télévision est la gestion du travail en bout de chaîne, du travail mort au sens où Marx dit : « Le poids des morts pèse sur les vivants et les empêche de vivre ».
Et puis c’est une machine qui, contrairement au cinéma, marche à la nervosité et non pas à l’amour : Le caméraman filme le pape comme il filmerait un extincteur. On coupe dans les discours, il n’y a aucun respect de la matière. La télévision ne propose pas de l’image mais quelque chose qui est du registre du tactile. Les machines à zapper prouvent que le plaisir de la télévision est au bout des doigts. De même le zoom sert moins à regarder qu’à toucher l’oeil. L’image, disait Barthes, « c’est ce dont je suis exclu », et donc tout le travail de l’imagination, tout le jeu consiste à s’inclure dans l’image. A la télévision on est définitivement exclu, coupé de ce qu’on voit parce que toutes les médiations vivantes entre nous et l’image ont disparu : l’auteur, le travail, le langage, le temps. Il s’agit d’un mouvement général dont la télévision est le lieu, dont la publicité est la matrice (et dont le cinéma crève !).
Sur ce point, tous les médias se ressemblent : le fonctionnement médiatique aujourd’hui exige d’apprendre à lire et non d’apprendre à voir. Un enfant qui est né avec la télévision apprend à maîtriser les quelques dizaines de signaux optiques ou auditifs qui sont proposés. C’est le triomphe du décryptage, de la lecture au détriment de l’acte de voir et d’écouter. Et les journaux, de la même façon, ne savent plus apporter ce que la télévision ne donne pas. Le découpage en gros titres et sous-titres est fait pour des lecteurs qui ne liront que ça. Le découpage permet une lecture « à la carte » et s’apparente à un formatage. Dans ce travail de formatage disparaît l’expérience du téléspectateur (perçue désormais comme quelque chose d’archaïque et de parasitaire), c’est-à-dire voir et écouter.
Les journaux pourraient classer différemment les choses, bousculer la hiérarchie, moins formater c’est-à-dire laisser plus d’élasticité. Ils pourraient par exemple faire comprendre au lecteur comment se fait un journal, sortir du dogmatisme de l’information. L’information est toujours donnée comme tombant du ciel ou du téléscripteur. A la télévision on filme le téléscripteur et en fait ce que l’on filme c’est le ciel ! Quelqu’un lit les nouvelles d’un air inspiré avec des « trucs » de comédien. On a opté pour l’icône sulpicienne d’un corps solitaire, doué de parole à qui la science infuse tomberait du prompteur. Les présentateurs du journal télévisé sont stircto sensu des « speakers ». La télévision met très rarement en scène son travail qui consiste à collecter des informations et à les trier. Elle le fait parfois pour de grands événements : ainsi La 5, à l’occasion de la libération des otages à Beyrouth, avait eu le courage d’annuler tous ses programmes et montrait l’image unique du journaliste dans son studio, qui attendait. Cette chaîne avait ainsi permis aux téléspectateurs d’être non seulement dans le temps du suspense mais aussi dans le temps du travail des journalistes qui attendent que l’événement advienne. Mais d’une façon générale, la télévision comme toutes les machines dogmatiques où les vérités tombent incarnées, a tendance à ne donner que quelque chose qui à la fois ne peut pas être mis en question et qui demain sera oublié. Les journaux ont tendance à procéder de la même façon.
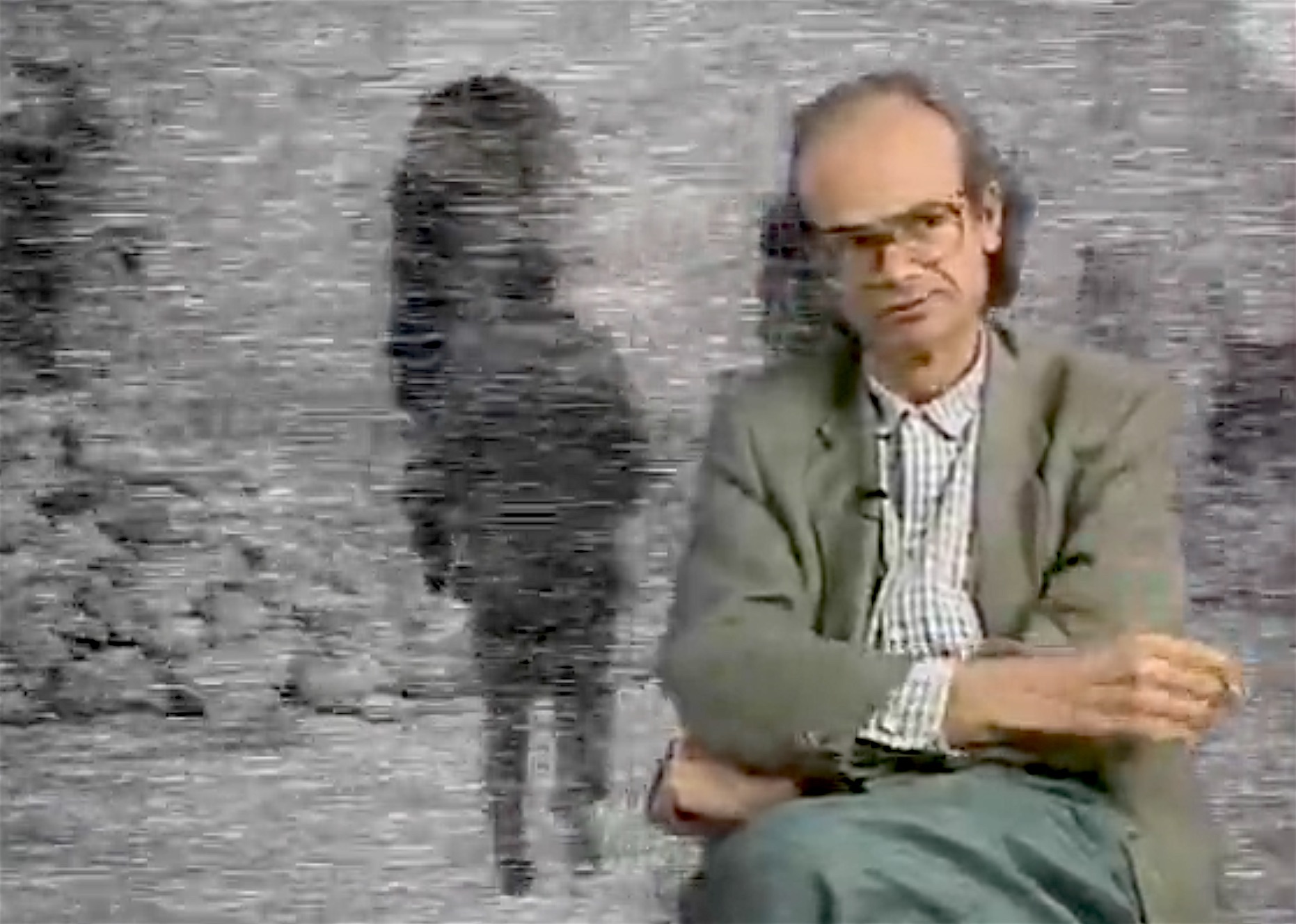
Le formatage des médias
De même, la télévision donne peu de nouvelles du monde et ne le fait que d’un point de vue villageois, mais il s’agit de moins en moins d’une spécificité de la télévision dans la mesure où les journaux copient la télévision. C’est la télévision qui donne le la, les journaux ont perdu leur capacité de faire autre chose que la télévision. Il n’y a pas de différence entre le formatage de l’information dans France-Soir et sur la chaîne 5, le fait que R. Hersant soit le propriétaire de chacun de ces deux médias n’est pas déterminant, il ne fait que symboliser une fatalité. Le documentaire a disparu et a été remplacé par la gestion des documents. Or il n’y a de documents que s’il y a des morts. C’est la loi de la télévision, qui ne donne pas de nouvelles du monde mais donne une sorte de cotation des documents, à base de cadavres. Mais le documentaires, comme a pu en faire le cinéma, n’existe plus à la télévision ; on ne voit jamais de reportage sur la vie quotidienne au Brésil ou à Costa Rica s’il n’y a pas d’enjeu dramatique et ce qui disparaît dans ce passage du documentaire au document c’est l’implication du sujet, du journaliste. Sur ce point le phénomène est le même à la télévision et dans les journaux, à ceci près toutefois que la télévision confère à cette cotation boursière des documents une ampleur et un esprit de sérieux particuliers. Il paraît aujourd’hui impensable que quelqu’un, à l’instar d’O. Welles annonçant « la guerre des mondes » à la radio à la fin des années trente, puisse utiliser une source d’information sérieuse pour jouer sur le vrai/faux.
La télévision donne une information partiale qui a besoin de la chair fraîche du document et prétend sans cesse au sérieux. Le statut de vérité auquel elle aspire ne lui vient pas de son travail mais de sa propre croyance en l’importance et en la véracité des documents : ils sont la preuve, d’une monotonie régulière, que partout ailleurs ça meurt, que partout ailleurs c’est l’horreur. Dans les journaux aussi, les reportages comme exercices littéraires tendent à disparaître. Pourtant les documentaires sont toujours célébrés, tout le monde se plaint de leur absence mais personne n’en voit plus, personne n’en fait plus.

La culture de l’écran
On est moins aujourd’hui dans une situation de l’image que dans une situation de l’écrit, mais il s’agit d’un écrit appauvri, qui peut venir sur un écran. Car on est dans une culture de l’écran, pas de l’image. Il y a de l’écran partout mais l’écran n’implique pas nécessairement l’image. Il ne l’implique qu’en tant qu’elle est facile à décrypter. L’apprentissage de cette écriture de base est très simple : on l’apprend comme autrefois on apprenait le latin pour former le futur clergé de base de la communication libre et heureuse dans les sociétés communiquantes. Ce qui n’a rien à voir ni avec la communication, ni avec la littérature.
Aujourd’hui, la valeur d’échange gagne sur tous les terrains et la valeur d’usage devient une sorte de luxe personnel qui permet, par exemple, de se payer la littérature. (Pas grâce à Pivot d’ailleurs. Pivot donne quelques bonnes informations sur les essais, rien sur la littérature. Il ne peut pas à la télévision accueillir des écrivains, et s ‘en garde bien.) L’écrit ce sont, outre les livres de N. Mamère à R. Zaraï, les logos de la télévision, la maquette d’un journal, tout ce qui nécessite du spectateur ou du lecteur qu’il décrypte. Seul ce type d’écrit très appauvri est diffusé dans les médias comme d’ailleurs tout ce qui est résumable. Ce qui n’est pas résumable, comme la poésie, plus largement la littérature ou le cinéma, n’est pas intégrable aux médias. Car le personnel médiatique est dressé à l’art de tout résumer.
La télévision ne crée rien, elle vampirise. La publicité paie la télévision, paie le cinéma, il est normal que la publicité finisse par avoir un droit de préemption esthétique. Donc le traitement du monde par la télévision est publicitaire et l’esthétique dominante du cinéma le devient. La rhétorique de l’image est très pauvre. Ce qu’a réussi la publicité c’est ramener le cinéma à son point de départ : l’enregistrement de ce qui est devant la caméra. La publicité n’a plus besoin de ruser avec la caméra, le montage, les éclairages, tout ce qui faisait le cinéma, il lui suffit de « présenter ». L’écran de télévision est une vitrine, on est passé de la représentation à la présentation. La télévision est une mythologie qui n’a rien à voir avec l’image. Elle a raté l’occasion historique de continuer ce que le cinéma avait de mieux et l’a remplacé par quelque chose qui n’est pas cher, qui est la gestion des emblèmes.
Et le cinéma et la presse se traînent derrière la télévision ; leur seule spécificité est un droit de préemption symbolique sur les médias car le drame des médiateurs est leur manque de légitimation. Tous les clergés sont à un moment dans cette situation ; il faut donc écrire un livre ou faire un film pour se trouver une origine noble. La télévision n’a jamais été aimée par personne (sauf peut-être, les premières années, par ceux qui la faisaient) ; méprisée, elle a un déficit symbolique qu’elle essaie de rattraper. Plus elle a de pouvoir dans le réel, plus elle doit rattraper ce déficit ; donc, elle s’assujettit, en les rabaissant à son niveau, la pratique littéraire ou cinématographique. Au lieu de donner des nouvelles de ce que font les écrivains ou les cinéastes, elle propulse ses propres officiants dans le rôle de para-écrivain ou para-cinéaste. C’est une histoire très triste.