
Trente ans après Le Chagrin et la Pitié, son auteur, reconnu en France et adulé aux Etats-Unis, parle de son père, et du documentaire, côté éthique et côté pratique. En esprit libre, il dispense avec humour souvenirs et piques.
Marcel Ophuls nous accueille à la gare de Pau. A 74 ans (il est né à Francfort en 1927), le cinéaste vit retiré dans un village à une quarantaine de kilomètres d’ici, face à la chaîne des Pyrénées. C’est dans cette région, en 1941, que Marcel Ophuls, avec son père, a quitté la France en train, pour rejoindre l’Espagne puis Hollywood. Longtemps, il a recherché cette voie ferrée abandonnée sur des cartes, avant de la croiser par hasard un jour en voiture.
Au cours du déjeuner qui précède l’entretien, Marcel Ophuls évoque son attachement à la France, viscéral et contradictoire, ce que son film le plus important, Le Chagrin et la pitié, a radiographié avec une densité que le cinéma n’avait jamais atteinte. Il rappelle qu’il avait souhaité adapter Uranus (mais c’est Claude Berri qui l’a fait), nous recommande vivement la lecture du Confort intellectuel, écrit en 1947 par Marcel Aymé, et insiste pour dire tout le bien qu’il pense de La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara. Quand Marcel Ophuls raconte un projet sur le conflit israélo-palestinien, il évoque la destinée singulière de l’hôtel du roi David, qui a connu des drames (un attentat) et vu passer des personnalités politiques importantes. « J’ai besoin d’idées porte manteau pour mes films », ajoute-t-il. Dans Ninotchka, Lubitsch, avec beaucoup de style et d’humour, fait tenir le conflit russo-américain, capitalisme versus communisme, dans un hôtel. Sur un porte-manteau,Greta Garbo met un chapeau insensé acheté dans une boutique parisienne très chic. Sur le porte-manteau de Marcel Ophuls, on trouve toute l’histoire du XXe siècle qui a ébranlé l’Europe et le monde : l’extermination des juifs, la collaboration et la Résistance.
■ Quand vous avez parlé à votre père de votre désir de faire du cinéma, que vous a‑t-il dit ?
Il me l’a déconseillé,pour les mêmes raisons que son père l’avait fait. Fritz Kortner, grand acteur et metteur en scène de théâtre allemand ami de mon père, disait que ce qui est tuant dans ce métier, c’est qu’on a affaire à des cancres et des experts de l’école buissonnière. Mon père ne supportait pas cela, alors même qu’il avait fui le milieu riche et s’engueulait avec son père pour qui le théâtre et le spectacle étaient une forme de prostitution. Il n’a lui-même jamais quitté cette idée. Si j’ai eu une carrière de protégé, c’est par Truffaut, qui a tout fait pour moi, mais pas par mon père. Je l’ai rencontré pour la première fois lorsque mon père m’a demandé d’assister à l’entretien que les Cahiers ont fait avec lui [[Max Ophuls avait demandé à son fils Marcel Ophuls d’assister à l’entretien que deux rédacteurs des Cahiers du cinéma, Jacques Rivette et François Truffaut, souhaitaient avoir avec lui. Il fut publié dans le n° 72 (juin 1957). Max Ophuls est mort le 26 mars 1957.]]
Max Ophuls et François Truffaut se sont remarquablement entendus. En raison du profond attachement de Truffaut pour mon père, il a conservé des liens avec moi. Truffaut a monté le film à sketchs L’Amour à 20 ans, dont il a réalisé le meilleur, uniquement pour que le fils de Roberto Rossellini et moi-même en fassions un. La Sorbonne m’emmerdait, la philo m’emmerdait, Heidegger aussi. Je venais de l’école anglo-saxonne et je ne me rendais pas compte de l’océan qu’il y avait entre les deux. J’ai donc plaqué la philosophie pour faire de l’assistanat. En revanche,mon père voulait me déniaiser avec les filles. C’est la seule protection qu’il m’ait accordée [rires]. Mais il n’a jamais voulu me prendre comme assistant. Sur Marianne de ma jeunesse de Duvivier, j’étais le seul assistant à avoir « survécu », sans doute parce que j’étais bilingue. Il était odieux, parce que sa femme était en train de mourir. J’envoyais des télégrammes à mon père où je lui demandais de me laisser partir, mais il m’avait dit que si je tenais je coup avec Duvivier, il me prendrait sur ses films.
■ Votre premier film en tant que réalisateur est une comédie avec Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo.
C’est un film modeste, mais qui, parce que j’ai l’esprit de contradiction, s’inscrivait de façon tout à fait consciente contre le petit film personnel de l’époque. Je voulais commencer par faire une comédie à l’américaine. Je n’ai pas à en rougir. Mais les Cahiers de l’époque étaient moins tolérants que moi.Il y avait une certaine contradiction à vouloir adorer Hawks et Hitchcock, c’est-à-dire le travail superprofessionnel, et ensuite faire des films dans des chambres de bonne avec des dialogues improvisés. En dehors de Truffaut et de Chabrol, les cinéastes de la Nouvelle Vague ne sont pas arrivés à surmonter cette contradiction. Contrairement à ce que dit Jean-Luc, Truffaut et Chabrol ne se sont jamais reniés, mais ont surmonté cette contradiction qui était normale au départ, parce qu’il y avait aussi la recette de Balzac dans Les Illusions perdues : il fallait se choisir quelques maîtres et essayer d’enfoncer le gros de la profession. Il y avait beaucoup d’« ôte-toi de là que je m’y mette ».

■ Dans Le Chagrin et la Pitié, tous les témoignages sont pris dans une structure de récit…
« It’s the name of the game ! » C’est ce que j’ai essayé de faire depuis trente-cinq ans. Je n’ai pas été l’inventeur du film de montage, entre les documents d’archives et les têtes parlantes, les interviews. Mais je crois avoir développé une forme de récit de non-fiction qui n’existait pas auparavant, en utilisant la même recette de base, mais sans que ce soit Mémoire de notre temps. D’abord parce que ce ne sont pas des interviews, ce sont des conversations.
■ Quelle est la différence ?
Quand vous faites des centaines d’interviews avec une centaine d’heures de tournage, vous vous apercevez très vite que les notes prises dans la voiture le matin, parce que vous avez le trac, et qu’il vous faut un filet de sécurité,comme dans Lola Montès, ne servent plus beaucoup.
Dans la forme de non-fiction que j’ai développée, je me suis aperçu, avant même Le Chagrin et la Pitié, qu’il faut être informé, documenté, savoir à qui on a affaire, mais pour le reste les questions qu’on pose sont fonction des réponses qu’on vient de vous donner. On ne peut faire cela que si on dispose de cent heures de pellicule et qu’on a trente ou quarante témoins.On peut alors, sans scénario, aller voir Albert Speer, Mendès-France, Daladier, les frères Grave, Simone Lagrange et lancer la conversation. Cela donne, à la personne qui parle, l’impression (vous savez bien que la société spectacle n’est faite que d’illusion) qu’il n’y a pas de caméra. Mais cette croyance qu’on peut oublier la caméra, même un cinéaste comme Fred Wiseman se fourvoie là-dessus. C’est une chose qu’il a dans sa tête pour pouvoir faire ses films. On n’oublie jamais qu’on est filmé. L’idée qu’un interviewer, dans ce genre de situation, piège les gens, je n’y crois pas du tout. Je peux faire prévaloir mon point de vue par le montage et, de temps en temps, être un peu ironique ou provocateur. L’essentiel est de parvenir à un récit. L’ennui avec les documentaires que je n’aime pas, que Truffaut n’aimait pas, que mon père n’aimait pas, c’est leur faiblesse de récit.
 Quand je rencontre Leacock ou les autres on se chamaille amicalement. Ce côté anti-Hollywood, anti-Fred Astaire et puritain du cinéma-vérité m’insupporte. Le seul avec qui je m’entends vraiment bien, c’est Fred Wiseman, parce qu’il considère que le documentaire est une forme de fiction, basée sur des illusions. Il n’y a aucune raison de ne pas orchestrer cette illusion : c’est comme ça qu’on arrive à toucher les gens. Laisser les choses en friche, c’est de l’amateurisme puritain. Ou alors, ça veut dire qu’Hitchcock, Lubitsch et Max Ophuls étaient des menteurs ! Cela me rappelle une conversation que j’ai eue récemment, à Hollywood, avec Richard Leacock. Je lui ai demandé pourquoi les plus grands metteurs en scène hollywoodiens comme Huston ou Stevens ont fait les plus beaux documentaires,lorsqu’ils étaient colonels dans l’armée américaine.
Quand je rencontre Leacock ou les autres on se chamaille amicalement. Ce côté anti-Hollywood, anti-Fred Astaire et puritain du cinéma-vérité m’insupporte. Le seul avec qui je m’entends vraiment bien, c’est Fred Wiseman, parce qu’il considère que le documentaire est une forme de fiction, basée sur des illusions. Il n’y a aucune raison de ne pas orchestrer cette illusion : c’est comme ça qu’on arrive à toucher les gens. Laisser les choses en friche, c’est de l’amateurisme puritain. Ou alors, ça veut dire qu’Hitchcock, Lubitsch et Max Ophuls étaient des menteurs ! Cela me rappelle une conversation que j’ai eue récemment, à Hollywood, avec Richard Leacock. Je lui ai demandé pourquoi les plus grands metteurs en scène hollywoodiens comme Huston ou Stevens ont fait les plus beaux documentaires,lorsqu’ils étaient colonels dans l’armée américaine.
■ Stevens a filmé les camps.
Pas seulement les camps, mais aussi la Normandie jusqu’à la Libération de Paris. Ce documentaire est tout simplement génial.Eisenhower ne s’y est d’ailleurs pas trompé car il l’a interdit tout de suite.
■ Pourquoi ?
Parce que ce n’était pas le point de vue officiel mais un point de vue particulier, subjectif. Stevens n’était pas le plus grand metteur en scène hollywoodien, mais il avait le sens de la structure. C’est d’ailleurs ce que m’a répondu la fille de William Wyler quand je lui ai demandé comment son père avait pu faire The Memphis Bell, un film sur les forteresses volantes, qui est une splendeur : « A sens of structure » !
Pour revenir à Leacock, je lui pose un peu la même question et lui dit qu’il n’y a pas que Wyler, Huston, Capra qui ont fait de beaux documentaires – de propagande bien sûr – mais aussi Orson Welles qui a réalisé un documentaire sur lui-même dans une salle de montage, qui s’appelle Filming Othello. Il me répond : « Mais Marcel est-ce que tu crois vraiment qu’Orson Welles est un bon cinéaste ? » [rires]
■ Pourquoi avoir fait du documentaire alors ?
Parce que j’avais fait un bide sur les Champs-Elysées avec un film avec Constantine [Feu à volonté, 1965,ndlr]. Je l’ai d’ailleurs revu il y a peu et je le trouve moins mauvais que ce que je pensais. Il faut le comparer avec ce qui est comparable,c’est-à-dire aux films de Bernard Borderie ou certains films de John Berry comme Ça va barder. Cela dit, je n’aurais pas dû le faire, parce qu’être le fils d’Ophuls pour son deuxième long-métrage sur les Champs-Elysées, même fauché,un film de série B,cela ne passait pas. En France, on ne pouvait pas. Surtout pas au moment de la Nouvelle Vague et du petit film personnel de Jean-Luc Godard ou de Jacques Demy. C’était une erreur grossière. En dehors de François Truffaut qui m’a aidé à faire mon premier film, les méchantes langues disaient que Peau de banane était un film d’acteur et, par la suite, « ce fils à papa s’est cassé la gueule ». Comme de toute façon, tous les producteurs détestaient mon père, je n’avais plus qu’à travailler pour la télévision française ou bien m’exiler.
■ Godard,dans ses Histoire(s) du cinéma, dit qu’on a cru que le cinéma pouvait tout faire, témoigner, montrer, informer, avant de constater qu’il n’a rien empêché, y compris les camps. Pensez-vous que le cinéma ne peut rien empêcher ?
Je suis d’accord avec Jean-Luc. Je ne sais pas s’il a dit ça récemment car il est quand même passé par des stades dans sa vie où il essayait de faire absolument le contraire. Mais on peut acquérir la sagesse avec l’âge. Je ne veux pas dire que Jean-Luc était con avant. Il n’a jamais été con. Même s’il dit que Hôtel Terminus est le meilleur documentaire du monde, Jean-
Luc ne sera jamais mon cinéaste préféré, parce qu’il a entraîné des générations entières dans des impasses, de fausses directions, au niveau artistique et politique. Je n’aime pas beaucoup La Chinoise, ni Week-end. Mais il est sans doute le cinéaste le plus intelligent de France, de Navarre, d’Europe, de notre génération, et c’est déjà beaucoup.
Pour revenir à votre question, s’il y a une chose que je trouve complètement vaine, c’est de croire que le cinéma est un outil pédagogique. Même cette idée très répandue que Le Chagrin et la Pitié a changé le point de vue de la France et des Français sur leur propre histoire, à mon avis c’est de la propagande « harrissédouxienne » [André Harris et Alain de Sédouy ont collaboré au Chagrin et la Pitié en réalisant des entretiens, ndlr]. Une propagande d’attaché de presse. Les gens voient ce qu’ils veulent voir dans un film.
Au cinéma, c’est le mode d’expression « instantané » qui importe, le moment où vous recevez une parole et des images auxquelles vous réagissez intellectuellement et émotivement. Mais, une fois le film terminé, vous reprenez les préjugés ou les idées que vous aviez avant. Mon père a écrit là-dessus. C’est ce que dit Noiret dans Veillées d’armes…
■ Il dit : pendant la Seconde Guerre mondiale,on disait qu’on ne savait pas pour les camps et, aujourd’hui, avec la guerre en Yougoslavie,on sait sans que cela change grand-chose. Pourquoi avoir mis Noiret au début de ce film ?
Pour le faire parler d’Anne Sinclair. Il avait eu ce coup de colère formidable en disant aux journalistes : « C’est pas vous les vedettes, c’est nous. » Noiret est une tête politique formidable. Quand il a parlé de Vichy et d’Auschwitz, je ne savais pas qu’il allait le faire. C’est lui qui, en se demandant pourquoi je venais le voir, m’a dit cela. Une fois qu’il a parlé d’Auschwitz,on se retrouve dans le film à la gare de l’Est avec des images d’archives de Danielle Darrieux qui part vers l’Allemagne. Danielle, c’est quand même l’actrice fétiche de mon père lire aussi page 60]. Par conséquent, je ne montre pas ces images de gaieté de cœur. Je le fais parce que ça nous donne aussi l’occasion de l’entendre chanter [Le Premier Rendez-vous – dans ce cas, il s’agit du premier rendez-vous avec la guerre. L’un appelle l’autre. Philippe Noiret me fait arriver à la gare de l’Est, qui me conduit à Danielle Darrieux. Et le wagon-lit m’entraîne à l’extrait du film De Mayerling à Sarajevo. Mais ils ne s’enchaînent en forme de récit que si vous vous débarrassez au départ de tout carcan.
Je voudrais revenir sur la question de la pédagogie. J’ai fréquenté Claude Lanzmann au moment de la sortie de Shoah. Je l’avais aidé un peu, car la télévision française ne voulait pas de Shoah. Il a fallu le lobby juif aux Etats-Unis et l’énorme succès auprès de lui pour que ça rebondisse en France. Un éditeur américain m’avait alors demandé un article sur Shoah, et j’avais écrit exprès : « Le meilleur film documentaire de l’histoire contemporaine », parce que je savais, étant donné que j’ai une certaine célébrité aux Etats-Unis, qu’ils placarderaient cette phrase dans le New York Times.Claude, qui auparavant était profondément agacé quand on lui parlait du Chagrin et la Pitié, m’a invité chez Lipp et m’a fait entrer dans le comité de rédaction des Temps modernes… Il s’est mis à dire que Shoah et mes films sont des récits et qu’on espère que ce sont des œuvres d’art. Il en est convaincu, moi, peut-être moins. Hier soir à la télévision, j’ai vu que Claude se laissait entraîner par Jack Lang, la main dans la main, pour faire la classe dans les lycées, avec une version abrégée de Shoah[[Une version courte de Shoah, accompagnée d’un essai, vient d’être éditée en DVD par le CNDP (Centre national de documentation pédagogique) à destination des écoles.]] C’est une constradiction, car Dieu sait qu’il a lutté contre ses producteurs, contre Simone Veil, contre la classe politique française, avec courage, pour qu’on ne coupe rien dans Shoah. Or on ne fait pas des films de neuf heures à des fins pédagogiques ! On les fait parce qu’on pense que le sujet a une opacité et une complexité qui autorisent cette durée. On ne fait pas neuf heures de récit pour aller dans les lycées porter la bonne parole. Est-ce que c’est une réponse à Godard ?
■ En partie. Mais n’y a‑t-il pas aussi un aspect pédagogique ?
Si les parents et les instituteurs n’ont pas été foutus d’apprendre aux gosses du XXe et XXIe siècles qu’il y a eu l’Holocauste, ce n’est pas à Claude et à moi de rattraper le temps et le terrain perdus. Ce serait follement orgueilleux de notre part.
■ Lanzmann a peut-être cet orgueil, vous beaucoup moins.
Je n’ai pas d’ambition pédagogique. Par contre quand vous me dites que je fais des récits, vous flattez mon orgueil.
■ N’est-ce pas être pédagogique que de faire des récits ?
C’est une manière de se faire entendre et comprendre par des spectateurs. C’est un désaccord que j’ai toujours eu avec Jean-Luc Godard. Je pense qu’il y a des tas de révolutions à faire dans le monde, mais je n’ai jamais cru nécessaire – dans ce sens, je n’ai jamais fait partie de la Nouvelle Vague – de faire une révolution dans le cinéma. Autrement, je ne serais pas le fils de mon père ! Je pense qu’il y avait le ménage à faire dans le cinéma français, c’est-à-dire essayer de substituer à la médiocrité des retourneurs de veste et des opportunistes quelque chose de mieux. Encore faudrait-il faire la différence entre opportunistes et opportunisme. Jacques Becker a fait ses premières armes sous l’Occupation, avec Goupi Mains Rouges. C’était un merveilleux metteur en scène. Et un auteur dans le sens où on le comprenait quand on parlait de la politique des auteurs. Clouzot n’a pas fait que des bons films mais Le Corbeau est très réussi. Lorsque j’apprends, par le film de Tavernier, qu’il était l’assistant en chef et l’homme de main de la Continental, je me dis que, si mon père avait su ça, peut-être qu’il n’aurait pas été l’ami de Clouzot. Par conséquent, il fallait faire le ménage mais pas de la façon dont a essayé de le faire Jean-Paul Le Chanois ou les communistes après la guerre qui voulaient interdire tel ou tel film, ou empêcher les gens de pratiquer leur métier. C’est d’autant plus dégueulasse que ceux qui faisaient le ménage avaient aussi retourné leur veste. Truffaut et les autres, Marcel Aymé lorsqu’il écrit en 1947 Le Confort intellectuel (un livre formidable, dont je vous recommande la lecture), avaient tout à fait raison de dénoncer ce genre de choses. Une fois de plus, l’esthétique et l’éthique se rejoignent.
■ Vous avez une façon très particulière de pratiquer le montage fondé sur la contradiction. N’est-ce pas déjà une manière de pédagogie même s’il n’y a pas cette volonté affichée ?
Tant mieux si les gens pensent qu’ils ont appris quelque chose. Mais ce n’est pas mon but, qui est de leur faire sentir, de les faire rire ou pleurer. Je suis un cinéaste de fiction frustré, je ne m’en cache pas. C’est peut-être ma qualité. En montrant le point de vue des uns et des autres, je pense que, par recoupement, on arrive assez vite à savoir ce que le type qui est derrière la caméra pense. Mais ce que je pense, je ne cherche pas à l’enseigner. Surtout sur des problèmes de bourreaux et de victimes. Si je me servais principalement de la pensée et de la parole des autres pour faire prévaloir mon point de vue, ce serait une forme d’impérialisme…
■ Ou de manipulation…
Le mot manipulation n’est pas forcément péjoratif. Manipulation veut dire choix. On ne peut pas faire des films sans choisir. A partir du moment où vous structurez un récit,vous faites des choix. Vous coupez quelquefois les gens en pleine phrase, vous passez de la page 3 dans la transcription de l’interview à la page 17 avant de revenir à la page 6. Vous vous sentez libre de le faire parce que vous avez l’orgueil de croire que contrairement au cinéma-vérité qui se met dans un coin pour guetter les gens…
■ Le fantasme de la caméra cachée…
Oui, c’est exactement ça. L’entretien, même s’il est coupé en petits morceaux, laisse aux gens cette liberté de dire ce qu’ils ont envie de dire ou de ne pas dire, autrement dit de donner une image d’eux-mêmes. L’officier allemand dans Le Chagrin et la Pitié est tout à fait convaincu de ce qu’il dit. Alors c’est vrai que ça marche aussi sur l’ironie. En filmant,je sais bien que la plupart des gens qui vont voir le film ne seront pas d’accord avec les vues d’un vieux schnock qui pense que porter des médailles nazies revient au même que porter n’importe quelle médaille militaire. Si je ne le savais pas, je ne pourrais pas faire ce travail. Je suis très hawksien là-dessus, je filme à hauteur d’homme. A hauteur de tête parlante. Lorsque l’opérateur fait autrement à mon insu, on s’engueule le soir.
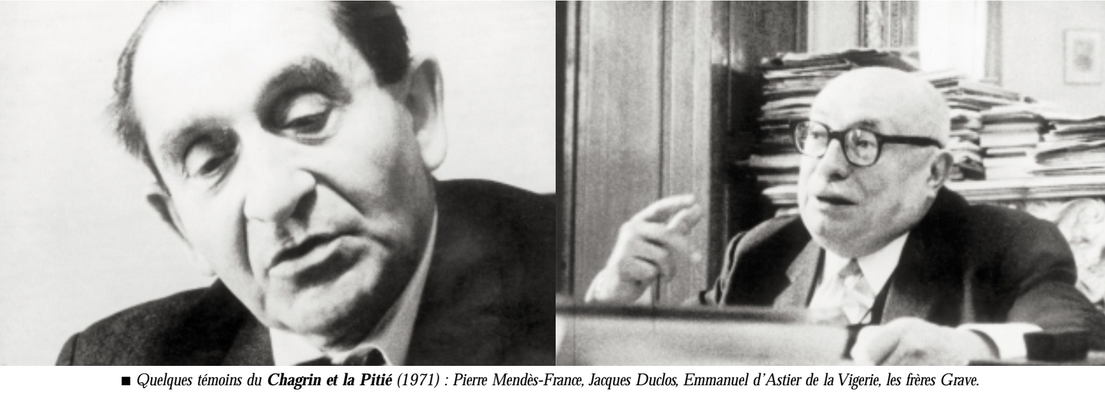
■ Dans Le Chagrin et la Pitié, quand vous filmez ce père de famille avec ses enfants, c’est vous qui avez demandé que les enfants soient présents ?
Oui, évidemment. Tout comme j’ai pris la décision de prendre le train pour Sarajevo dans Veillées d’armes plutôt que de voler. Je savais que ça me permettrait d’évoquer le film de mon père. Il faut savoir le matin d’un tournage,en sortant de l’hôtel, dans quelle direction aller, si vous avez un espoir de faire un entretien avec Marcus Wolf dont on n’avait jamais vu le visage avant. Peut-être qu’il se serait défilé. Lorsque les producteurs me demandent des scénarii, c’est qu’ils n’ont pas vu mes films. Comment aurais-je pu prévoir qu’en faisant un film sur la chute du mur de Berlin j’aurais devant la caméra le plus célèbre espion du monde, et le plus anonyme ? Dans Memory of Justice, comment aurais-je pu savoir qu’Albert Speer, l’enfant chéri d’Adolf Hitler, son dauphin, qui était un très grand criminel de guerre et un homme charmant (qui a sauvé sa tête parce qu’il était un homme charmant), avait dans ses tiroirs des prises de vues faites à (Berchtesgaden) en couleur 16 millimètres, et qu’il serait d’accord pour me les projeter ? Je le filme en train de me montrer ces enfants faisant du ski et de la luge dans la neige, et tous les grands manitous nazis en train de déjeuner à la bonne franquette avec Hitler. En plus, Speer me commente tout cela. Je lui pose des questions sarcastiques, mais tout cela est improvisé. Si ça ne l’était pas, ce serait odieux.
■ Il s’agit moins pour vous de piéger quelqu’un que de le percer à jour.
Votre cinéma consiste à faire revenir les gens sur ce qu’ils ont fait ou dit. Quelquefois, quand ils ont envie de le faire. Sur Hôtel Terminus, on est tombé sur un professeur américain en retraite, un dénommé Taylor, qui est sans arrêt coupé par sa femme qui lui dit : « Est-ce que je peux répondre à ta place ? » C’est une scène très drôle. J’avais un document où il recommandait Barbie à ses supérieurs du contre-espionnage. Il écrivait que c’était un « nazi idéaliste ». Je lui demande : « A votre avis professeur, c’est quoi un nazi idéaliste ? » Il réfléchit un instant : « J’aurais bien voulu avoir l’occasion de réécrire tout cela.» Je lui réponds : « Surtout en ce moment, j’imagine. » C’est très vache, mais ça fait partie du jeu. Il faut aussi divertir les gens. Ce type manifestement était un peu con et il s’est laissé avoir par son histoire. Il y a des moments où je sais d’avance que l’idéaliste nazi va venir dans la conversation parce que j’ai le document sous les yeux. Est-ce que c’est de la manipulation ? Bien sûr. Est-ce que c’est parce que j’ai voulu jouer au Bon Dieu… ?
■ Au justicier ?
Je ne pense pas. J’ai lu récemment un livre sur Hitchcock. L’auteur dit qu’à partir du moment ou Hitchcock a constaté que Dieu était mort, parce qu’il avait lu Nietzsche, il a fini par penser qu’il fallait bien se substituer à lui [rires].
■ C’est ce que suggère Godard dans ses Histoire(s) du cinéma : Hitchcock a pris le contrôle du monde.
C’est un peu moins drôle que ce que je viens de dire mais c’est la même chose. Ce qu’il y a de faisandé dans le récit de non-fiction, c’est que vous vous servez de personnages réels.Il est bien plus honnête et bien plus riche, subtil, coloré et vivant de payer des acteurs. Je reviens sur ce que je disais sur la nécessité de faire le ménage mais pas la révolution dans le cinéma. Pourquoi a‑t-on mis si longtemps à découvrir que Guitry et Pagnol sont de grands cinéastes,peut-être les plus grands cinéastes français, avec Renoir et mon père [rires] ? Leur référence, celle des révolutions littéraires et dramatiques, sont une perte de temps considérable.
■ C’est assez proche de ce que pense Rohmer de l’évolution du cinéma.
On peut très bien être d’accord avec les gens dont on n’aime pas les films ! [rires]
■ La grande leçon du documentaire, c’est que les gens filmés peuvent être aussi de véritables personnages. Le film de Depardon sur Giscard est instructif sur ce point.
Je n’ai pas vu le film de Depardon. Mais Leacock avait fait ça avec Kennedy. C’est la même chose que lorsqu’on fait Gimme Shelter sur les Rolling Stones. Des gens de spectacle vous feront toujours leur numéro. Kennedy et Giscard sont des vedettes de la société spectacle. Ils sont des manipulateurs en chef, autrement il n’auraient jamais pu obtenir le pouvoir. Ils sont très lucides, conscients de ce qu’ils présentent à la caméra. Ce n’est donc pas très difficile de les filmer. Si vous vous concentrez sur des vedettes, vous n’avez plus de travail de divertissement à faire, parce qu’il est déjà fait.
■ Dans Saga of Anatahan, Sternberg dit qu’il vient un moment où il faut faire les comptes. Par rapport à ce qui s’est passé en Europe au siècle dernier, est-ce une définition de votre cinéma ?
On me le reproche. Des gens comme Simone Veil disent que je suis revenu en France pour régler des comptes.
■ Faire les comptes, ce n’est pas régler des comptes.
Mes parents et moi étions en danger de mort car, en 1941, nous étions sur les listes de la Gestapo. Non parce que mon père était juif, mais parce qu’il avait réalisé des émissions de propagande. Des gens bien renseignés, mais tirant de mauvaises conclusions, pensent que j’ai voulu régler des comptes avec la France occupée. C’est d’autant plus imbécile que tous mes films, comme ceux de mon père, étaient des films de commande. J’ai fait du documentaire, parce qu’il fallait gagner du pognon. Je n’avais pas envie de faire partie des barons des Buttes-Chaumont, à l’ORTF, qui étaient de très mauvais metteurs en scène. Lorsque j’ai décidé d’entrer à l’ORTF, j’ai choisi une équipe qui me semblait un peu contestataire et anti-gaulliste. Pendant trois ans, j’ai fait des reportages pour Zoom – ce qu’on appelait à l’époque le nouveau journalisme. La soirée historique sur les accords de Munich n’était pas mon idée non plus.
■ On voulait vous demander si vous aimez la série Dream On : dans Veillées d’armes, l’extrait des Marx Brothers qui vient commenter le discours des autres rappelle le principe de cette série…
Je ne connais pas. La seule référence télégénique que je peux vous livrer c’est que depuis quelques années, je me prends à me rêver dans le personnage de Colombo.
■ Votre imperméable et votre chapeau vous rapprochent du personnage…
J’aime beaucoup son entêtement, sa façon de se retourner dans l’embrasure de la porte en disant : « Au fait j’allais oublier… » J’aime beaucoup sa fausse modestie. Aussi son côté juif, car il ne s’appelle pas vraiment Colombo. Toute cette série est une entreprise de la gauche américaine. Il s’en prend toujours aux riches, aux puissants, aux manipulateurs. Et il mène jusqu’au bout le principe hitchcockien de base qui est de donner de l’avance au public.
■ Dans Au-delà du périphérique, des partisans du Front national habitent dans la cité mais Bertrand Tavernier ne les interroge pas. Auriez-vous été les rencontrer ?
Je n’aurais pas fait le film. Bertrand le sait bien, lui qui fait du bon cinéma de fiction. Son film sur les flics L 627 a l’énorme mérite d’être pro-flics. C’est très courageux et très réussi.
■ Ne pas interroger les gens qui ont un discours lepéniste, n’est-ce pas déjà une façon de faire de la propagande ?
Je ne sais pas. Dans d’autres contextes, une conversation avec Jean-Marie Le Pen et moi aurait été tout à fait appropriée. Je voulais faire un film sur les dangers du fascisme au XXIe siècle, qui soit centré sur Jörg Haider, parce qu’il est marrant, bronzé, beau, qu’il fait du ski et qu’il est follement dangereux. Ce devait être mon idée porte-manteau. Je serais aussi allé dans le Montana, à Rome pour avoir un long entretien avec Berlusconi. J’aurais aussi fait le haut et le bas, pas seulement les politiques mais aussi les cons qui votent pour eux.
■ Les cons ?…
Oui, j’y tiens ! Ils sont généralement – contrairement à ce que veux nous faire croire la classe politique qui veut récupérer leurs votes – plus racistes et antisémites que Le Pen ou Haider. Parce que Le Pen n’est pas con du tout. Dans ce cas, il peut y avoir un échange de points de vue intéressant avec Jean-Marie Le Pen qui est extrêmement cultivé et remarquablement intelligent.Il est aussi remarquablement vulgaire. Il serait sans doute ravi parce qu’il pense que, de toute façon, il reste maître de sa parole. Comme me disait un jour Franz Joseph Strauss de sinistre mémoire : « Vous l’intellectuel juif parisien, qui venez m’interviewer pour l’ORTF, vous pouvez me couper dans tous les sens, prendre mes phrases et les mettre dans n’importe quel ordre. Mes électeurs bavarois, eux, me comprendront. » Je pense que le point de vue de Valéry Giscard d’Estaing vis-à-vis de Depardon ne doit pas être très différent. Ils savent faire passer leur message à ceux qui les intéressent. Le Pen, qui a le même âge que moi, est déjà un homme du passé, et il le sait, ce qui le rend d’ailleurs intéressant. Il serait probablement plus franc du collier (y compris sur le « point de détail », « Durafour crématoire », toutes ces fausses gaffes) et il serait parfaitement capable de s’en expliquer. J’aimerais bien le faire. Mais pas forcément autour du périph, plutôt autour de Jörg Haider.
■ On voulait souligner le fait que Tavernier filme un militant communiste, mais ne veut pas donner la parole à l’ennemi.
Là, c’est différent. On revient à la coiffeuse accusée de collaboration et qui clame son innocence dans Le Chagrin et la Pitié que Sédouy et Harris voulaient couper. C’est une forme d’autocensure. Truffaut me disait qu’on avait tous été contre la censure, qu’on avait tous signé des pétitions, pour La Religieuse de Rivette, ou même Le Chagrin et la Pitié. Et il ajoutait : « Maintenant que je vieillis, je me rends compte que la pire des censures, c’est l’autocensure. Mais je me demande parfois quelle est la différence entre l’autocensure et le sens des responsabilités. » C’est une question formidable. Essayez d’y répondre, vous ne trouverez pas. La seule réponse, c’est à la lueur de votre propre analyse du rapport entre l’esthétique et l’éthique que vous pourrez la donner.
■ Est-ce qu’il y a des choses que vous vous êtes interdit de montrer ?
Des tas de choses. Je pense que, sauf exception, il n’y a pas lieu de s’attarder sur des illustrations des camps de la mort. Que se soit avec des images d’archives ou par reconstitution. Sur la querelle autour de La Liste de Schindler avec Lanzmann, j’aurais tendance à être du côté de Spielberg qui est, au demeurant, un metteur en scène que je n’estime pas beaucoup.
La Liste de Schindler a l’exceptionnel mérite de dégager une illusion d’authenticité. Les nazis et les déportations y sont extrêmement bien filmés. Se demander s’il faut faire des films sur l’Holocauste est une fausse question. Est-ce qu’il faut cesser de faire des films sur l’amour parce qu’il y a des films porno ? Tout dépend de comment vous le faites.Ma seule critique sur le film de Spielberg est la suivante : est-ce qu’il a inventé l’histoire du train des femmes qui est détourné par erreur ? Est-ce que c’est une invention pour titiller le spectateur et l’amener jusque dans les chambres à gaz ? Ou est-
ce que c’est effectivement ce qui s’est passé ? A mon avis, quelqu’un a menti. Soit l’auteur du livre, soit Spielberg. La SS ne laissait pas dévier des trains vers Auschwitz pour ensuite laisser venir un quidam les récupérer, même si c’était un ami personnel de Göring. C’est de la folie furieuse. C’est ce qui rend le film inopérant. Mais Lanzmann a tort – et c’est mégalo de sa part – de croire qu’il est le seul dépositaire,que seul le documentaire peut traiter de la Shoah. En revanche,sur le plan esthétique et moral, il a raison de laisser parler les victimes de comment tout ça s’est passé au jour le jour.
■ On en revient au récit.
Faire un récit et rien d’autre. Artistiquement et moralement, ça me semble juste. La querelle avec Spielberg, je la trouve un peu vaine. Mais je ne suis pas un spécialiste de l’Holocauste. Je suis un enfant d’exilé privilégié. Ce sont les barbus qui ont payé à notre place, les types dans les ghettos polonais. Fritz Lang, mon père, Preminger, n’ont rien payé. Au contraire, ils ont pu apprendre des tas de choses à Hollywood. Il ne faut jamais oublier qu’il y a à apprendre à Hollywood. Même encore aujourd’hui. 
■ Pourquoi n’avoir jamais réalisé un film sur le conflit israélo-palestinien ?
Tout le monde me pose cette question. C’est une question, excusez-moi, que je trouve un peu suspecte. Cela implique que je vais chercher des poux dans la tonsure des autres, et pas dans ceux de « mon peuple ». Premièrement,ce n’est pas mon peuple. D’autre part, pendant des années, après ce séjour éclair que j’ai fait en Israël et en Palestine, mon idée a toujours été de faire la chronique de l’Hôtel du Roi David (j’ai toujours besoin d’idées porte-manteau pour mes films). Parce que c’est là qu’avait éclaté la bombe en 1947 qui avait décidé les Anglais à partir et à laisser tout le monde se débrouiller. Leur QG était dans cet hôtel de Jérusalem qui existe toujours et qui d’ailleurs est très beau.
C’était une bombe qui avait été posée par des Israéliens de droite, Begin et Shamir. Ils avaient envoyé un gars dans les cuisines de l’hôtel pour faire éclater la bombe. Un membre de l’Intelligence Service, chargé de la sécurité de l’Hôtel du Roi David, a écrit un livre passionnant là-dessus. On pouvait faire des passages en arrière et des passages en avant, parce que les filles et petits-fils des standardistes arabes, palestiniens, qui ont sauté avec cette bombe sont aujourd’hui à l’OLP, au Fatah, au Hezbollah, etc. Cela ne veut pas dire que le conflit israélo-palestinien soit de la faute des juifs. Le croire, c’est faire abstraction du fait qu’après la guerre, ni le Canada, ni la France (voir Exodus de Preminger), ne voulaient les accueillir. Sadate est allé à l’Hôtel du Roi David, Kissinger aussi. Celui qui a posé la bombe vivait encore à l’époque de ce projet de film, c’était un paisible citoyen de Tel-Aviv qui, chaque fin de semaine, prenait sa voiture pour aller à l’Hôtel du Roi David. Ça m’aurait aussi donné l’occasion de faire un petit tour du côté d’Aloïs Brunner, d’aller voir les amis de Werner von Braun qui étaient protégés par Nasser.
■ La question du conflit est liée à ce que vous traitez dans vos autres films, peut-être un peu moins Veillées d’armes, qui traite de…
Veillées d’armes aussi. Pourquoi croyez-vous que la révolte contre la purification ethnique ait été faite principalement par des gens comme Bernard Henri-Levy, Finkielkraut, Glucksman, eux qui signaient des pétitions et mouillaient leur chemise parce qu’ils disaient que ce qui se passait en Bosnie était une nouvelle forme d’hitlérisme. Ce n’est pas par hasard si, à un moment dans Veillées d’armes, le type qui me demande mon nom, à qui je réponds Marcel, me dise : « Ah oui,comme l’autre juif, Marcel Proust. »
■ Est-ce que vous avez vu le procès Barbie à la télévision ?
Non, je l’ai vu en réalité. J’ai passé les deux tiers de mon temps au balcon. Un procès n’est pas un récit, sauf quand il est mis en scène par Hitchcock, Billy Wilder, ou Preminger dans Anatomy of a Murder (le courtroom drama est quelque chose de formidable). Les procès sont faits par des juges et des avocats, qui sont rarement de formidables metteurs en scène. Simone Lagrange [déportée d’Izieu à 13 ans, survivante d’Auschwitz, NDLR] ou les époux Aubrac, sont forcément dans Hôtel Terminus, mais pour le reste, c’est un film « autour » de Klaus Barbie où, par la force des choses,il joue l’Arlésienne parce qu’il était en prison. C’était aussi un escroc. C’est intéressant de le montrer. Cela n’est pas dans le procès.Le matin sur ma table de montage, j’imitais André Malraux : « Entre ici Jean Moulin ! » On récupère des individus qui ont peut-être souffert jusqu’à la mort pour en faire des statues et des légendes officielles. Toute ma carrière s’oppose à cela. Le procès est une décision de Robert Badinter. Mais il me semble aussi absurde de faire de la pédagogie avec la justice qu’avec le cinéma. La pédagogie est une énorme responsabilité, et un métier passionnant qui doit être laissé à ceux qui ont le contact direct et quotidien avec ceux dont on essaye de faire l’éducation.
■ Dans vos films, on n’assiste pas à la fabrique de héros.
Là-dessus, je suis un peu puritain ou moraliste,comme mon père. Mais je crois à la possibilité d’héroïsme et donc de héros. Je crois aussi à la possibilité de sainteté,pas forcément selon les règles du Vatican. Il y a eu des saints dans les villages. La vie ne vaudrait pas la peine d’être vécue s’il n’y avait pas la possibilité de cette sainteté. Comment dire avec Sartre qu’il y a des salauds si on n’est pas en même temps prêts à envisager la possibilité de l’héroïsme et de la sainteté ? Je pense que mes films le font.
■ Dans vos films, la France est un vrai personnage.
Oui, je pense qu’il y a des identités nationales. Dans mes films, bien sûr qu’un village français ne ressemble pas à un village bavarois. Les aéroports ou les musiques d’ascenseur se ressemblent, c’est déjà assez grave.On ne va pas en plus essayer d’éliminer les particularités qui font les différences entre des cultures auxquelles nous sommes très attachés.
■ Le montage de vos films est fondé sur la contradiction. On peut vite ridiculiser quelqu’un…
A question abstraite, réponse concrète. Je suis assis derrière Sophie Brunet, qui est devenue la monteuse de Tavernier. Nous sommes devant ce qu’on appelle l’ours, qui fait 16 ou 20 heures (parce que 200 heures de rushs on ne peut pas les mettre devant une table de montage). On fait un découpage écrit, à la main.Très rapidement, les monteuses font le son synchro et mettent tout ça ensemble. Les journalistes de télévision font souvent des ours car ils n’ont pas le temps de faire du numérotage. Le premier ours du Chagrin et la Pitié, qui était tout à fait visible, faisait 16 heures. On se trouve à un moment donné devant deux éléments qui marchent ou ne marchent pas.A ce moment-là, le critère n’est absolument pas d’ordre moral, il est de l’ordre du show-business.
Est-ce que Finkielkraut vient à point nommé pour discuter d’Anne Sinclair et du journalisme ? Est-ce que, entre Noiret et Finkielkraut, on arrive à mettre en lumière ce qu’Edwy Plenel appelle le « journalisme de fréquentation », qu’il rend coresponsable, par leur superficialité et leur façon d’aller chercher les informations chez les puissants, des morts et des réfugiés de la Bosnie ? Est-ce qu’on essaye de l’illustrer ou pas ?
■ La morale n’intervient pas du tout dans ces choix ?
Pas à ce stade-là.Parce que la morale doit être faite bien avant. Dès le départ.
Propos recueillis par JEAN-SÉBASTIEN CHAUVIN et CHARLES TESSON, le 11 février à Pau, retranscrits par J.-S. C.
Publié dans Les Cahiers du Cinéma 566, mars 2002, page 50 – 58
Source de l’article : Documentation Marcel Ophuls
Réponse à Marcel Ophuls, par Claude Lanzmann (2002)
Notes :

