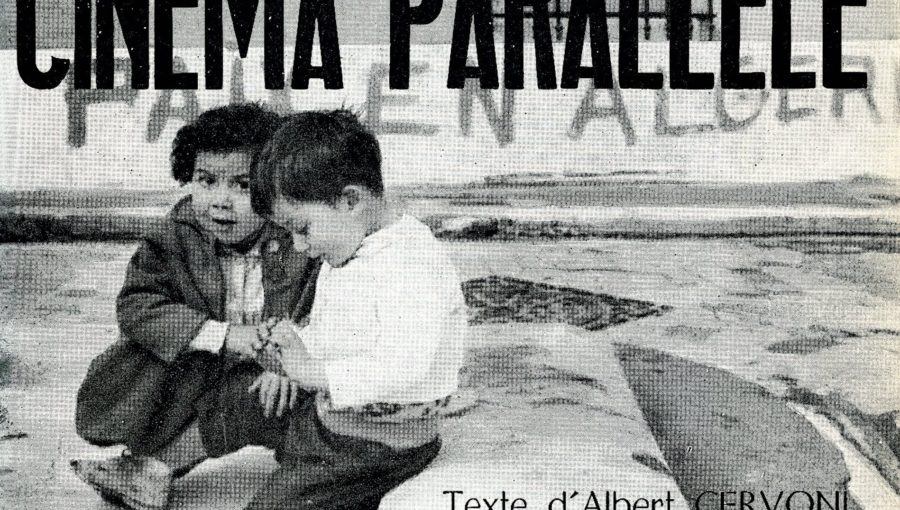La préoccupation la plus aigüe est la survie du cinéma parallèle. Né sous l’effet de la guerre d’Algérie, il ne faudrait pas qu’il disparaisse avec elle.
La notion de cinéma parallèle gagne du terrain ; elle est à l’ordre du jour. Si l’on veut essayer de l’appréhender dans ses contours exacts, il importe avant tout de ne l’envisager que par rapport aux expériences antérieurement parcourues par le cinéma français. En particulier, pour comprendre cette geste, dans un certain sens exaspérée, il faut se souvenir de cet enfant mort-né, de cet avorton novateur, de cette fausse-couche avant-gardiste que fut la « Nouvelle Vague ». Mais il faut aussi se souvenir que les épithètes que nous venons d’énumérer ne doivent aucunement effacer ni l’apport relatif justement signifié par ce même phénomène ni ce qui l’avait conditionné, le « cinéma de papa », le cinéma de bonne recette financière, le cinéma de DUVIVIER au stade de « Marie-Octobre » ou de « Boulevard » — ce n’est pas le DUVIVIER de la bonne cuvée, celui de « La Belle Equipe », œuvre populiste au temps du Front Populaire —, le cinéma de Marcel CARNÉ au niveau des « Tricheurs » trichés — ce n’est pas le CARNE qui illustrait DABIT, le CARNÉ d’« Hôtel du Nord » ou du « Jour se lève ».
RÉFORMISME CINÉMATOGRAPHIQUE
Il faut surtout se souvenir des structures générales du cinéma français, structures de capitalisme moyen, de capitalisme d’initiative individuelle. Un film pour se financer en France, a besoin d’une dizaine de millions au départ, auxquels viennent s’ajouter les fonds avancés par d’autres producteurs et les prêts bancaires. Pour mieux comprendre ce mécanisme, il peut être utile de confronter ce système avec le système américain. Un film américain se rentabilise déjà sur son seul marché national ; et l’audience d‘un film de dialogues angle-saxons s’étend en outre à un marché fort étendu. Tout apport nouveau est donc un apport complémentaire, une rentrée de fonds « superflue ».
On comprend mieux, dans ces conditions, que la machine à fabriquer des saucisses qu’est Hollywood, selon la formule même d’Erich von Stroheim, vise au profit maximum et, éventuellement, y mettre les moyens de la super-production. Le film français est généralement d’ambition, de moyens et de budget plus réduits. Mais ce qu‘il perd en ressources spectaculaires, le film français tente de le rattraper par cette individualisation qu’autorise mieux l’initiative française, l’initiative individuelle prise par un producteur engageant un réalisateur qu’il connait nommément, plutôt que le système américain, étonnant laminage par lequel le « directeur » (director) se retrouve soudain devant un
scénario sur lequel il n’a exercé aucun contrôle, aucune influence. Nous savons par le témoignage de Vladimir POZNER, entre autres, qu‘il n’est pas à Hollywood de scénaristes mais des bureaux de scénarii, ou les manuscrits circulent d‘un auteur à l’autre au point que le syndicalisme américain a prévu une estimation par pourcentage de la part prise par un écrivain à l’élaboration du film. C’est ainsi que lorsque « La loi du Seigneur » fut présenté à Cannes, pour y recevoir, hélas!, un grand prix sous forme de Palme d‘Or, l‘ancien scénariste, victime des lois maccarthystes, Mike WILSON, qui avait essayé d’imprimer une autre signification au texte Original remanié “a la demande de W, WYLER, put arguer des 50% de création littéraire que lui avait reconnu son syndicat, malgré son inscription sur les listes noires, ce qui constituait, malgré tout, une belle preuve d’honnêteté de la part de ses collègues, si résignés soient-ils par ailleurs, aux impératifs politiques du « mode de vie américain ».
Ayant a ouvrir un marché plus réduit, et a s’y investir plus complètement, tout film français tend à accueillir le public maximum, à ne pas effrayer certes, mais aussi a se présenter avec cette individualité relative qui le distingue du colosse préfabriqué made in Hollywood. Donc, face au film standard, modèle CARNÉ ou DUVIVIER 1936, modifié 1952 – 53, tel un bon vieux lebel rectifié en fusil semi-automatique 1907 – 1915, ou 24 – 29 pour les fusils-mitrailleurs, fut risquée une entreprise relativement hardie, une sorte de réformisme cinématographique se cantonnant dans les limites du « possibilisme ».
ENTREPRISE MYSTIFICATRICE
Il ne s’agit pas d’aligner directement des expériences s’exerçant sur des plans bien différents, de la balistique à l’esthétique, et de taxer CHABROL de social-démocrate. Il reste que la « Nouvelle Vague » a été une tentative de réformer le cinéma français, de le rénover sans bouleverser, « sans radicalise » ses structures, une tentative d‘aménager le régime existant, de s’en accommoder dans une mesure assez comparable à celle où d’autres tentèrent d’«amender » le capitalisme, de lui faire franchir « progressivement » des étapes, non révolutionnaires et « évolutives ».
Cette entreprise fut mystificatrice, dans la mesure où elle prétendit se présenter non comme une réforme de circonstance mais comme une entreprise définitive, une solution catégorique. Socialement, les 40 millions d’anciens francs hérités par CHABROL d’une tante qui mourut fort à propos pour permettre la réalisation du « Beau Serge », les ressources confortables de la famille MALLE, limitèrent le champ de vision, et pas nécessairement la sincérité subjective des auteurs en question. La limitation à un univers de fils de famille, en proie à des problèmes
plus concrets, les problèmes du couple entre autres, que ceux qu’évoquaient les films de la période antérieure, s’explique autrement que par des intentions. La « Nouvelle Vague » a décrit son horizon ; peut-on lui reprocher de ne pas l’avoir dépassé ?

LA MODE CHANGE
Mais de ces quelques trois années, dont la signification fut déformée par la mode à laquelle se prêtèrent si volontiers les échotiers de la « grande presse », qu’est-il resté, en définitive, sinon un résultat essentiellement négatif ?
La « Nouvelle Vague » n’aura peut-être pas, en soi, apporté grand-chose, sinon la preuve de l’impossibilité de revenir en arrière, de reconduire le cinéma des prostituées aguichantes et moralisatrices, le cinéma « faisant le trottoir », selon l’excellente formulation de Marcel MARTIN. Le bilan tracé par la « Nouvelle Vague » c’est simplement celui de faillite du « vieux » cinéma. Et l’impossibilité d’une régénération au sein du « système ». Certes, des tentatives marginales, œuvre de laboratoire, à la limite de l’exception, ou des tentatives d’expression sociale directe comme « Le Bonheur est pour Demain » d’Henri FABIANI, purent se frayer une voie fort peu royale et rarissime.
Mais l’exception n’établit nullement la règle ! Et pour la moyenne la « Nouvelle Vague », soit donna des signes d’agonie, dans les blockaus des distributeurs trop prudents après quelques échecs, soit se résorba, tel un acné juvénile, par l’intégration aux formules plus traditionnelles. C’était simplement le constat de l’impuissance absolue de réaliser un cinéma autre qu’un cinéma d‘exception, ou un cinéma de pauvre.
CHABROL, lui-même, le vérifia lorsque, citant le budget d’«A double tour », il fixait un effectif de millions bien supérieur à celui qu’avait coûté « Le Beau Serge », et même « Les Cousins ». Après avoir malicieusement invoqué la certitude qu’avec « C.B. de MILLE, ç’aurait été encore plus cher », il invoqua des raisons plus concrètes : « Tu comprends, un film en 1,85, en couleurs, revient plus cher qu’un film standard en noir et blanc. » C’était, dans tous les sens du terme parler d’or, et évidence que le cinéma ne pouvait s enfermer dans les limites d‘un genre, fût-ce le « film d‘auteur ».
Lorsque les films « Nouvelle Vague », passés de mode, commencèrent à languir dans les bureaux de distribution, la preuve fut définitive. On ne pouvait, sauf exception, s‘affranchir sans « radicalisation » du vieux cinéma ; Il fallait trouver de nouvelles voies, à moins de se contenter d’un très relatif replâtrage.
Le cinéma parallèle alors s’imposa, au moins comme direction de recherches, et justement pour franchir ces zones interdites que la « Nouvelle Vague » n’avait même pas essayé de franchir. Mais la logique concrète aidant, le cinéma parallèle eut à repenser obligatoirement bien d‘autres domaines que sa seule thématique, les domaines de la distribution et de la production.
8 FÉVRIER 1962
Le cinéma parallèle, ce sont d’abord des films. Ils sont peu nombreux : quelques bandes d’actualités sur les évènements du 8 février 1962, sur d’autres manifestations généralement liées à la protestation contre la guerre d’Algérie et ses effets, un court-métrage, « J’ai huit ans » et un long-métrage, « Octobre à Paris ». Ce sont là les seuls films appartenant de façon catégorique et absolue au cinéma parallèle parce que les seuls qui ne peuvent être envisagés, ni à la production, ni à la distribution, dans les cadres habituels de la cinématographie.
« Les Canuts » de Bernard CHARDERE, les films marseillais de Paul CARPITA ou « La Fille de la Route » du lillois Louis TERME, peuvent avoir, plus ou moins, échappé aux règles normales de la production ; ils n’en essayent pas moins de réintégrer une distribution normale, d’affronter des compétitions officielles comme Tours, de solliciter et d’obtenir souvent un visa de censure et de se proposer comme une marchandise aux exploitants.
En revanche, « Octobre à Paris », ou « J’ai huit ans » ne sont pas des films interdits. Ce sont des films en marge de la légalité parce que leurs auteurs savaient très bien que la légalité ne tolérerait pas l’acuité des sujets retenus, la violence avec laquelle ils passaient outre les tabous. « Octobre à Paris » ne fait, pas plus que « J’ai huit ans », la moindre démarche pour obtenir une récompense officielle dans un festival soumis à la légalité du pays producteur, la France.
On ne présente pas ces films aux distributeurs, aux exploitants. Ils ne sont pas faits pour ça. Et c’est bien ce caractère obligatoirement limité, que commande leur clandestinité, qui justifie leur caractère catégorique. D’une part, il n’y a personne a ménager : ni censure, ni producteur, ni public car ce que l’on recherche le plus ce n’est pas un public très étendu, mais un public actif, responsable, tenant à s’informer — quitte à courir dans une salle médiocre ou l’on s’entasse au prix de nombreuses précautions : inv1tations individuelles, interdiction de sortir de la salle en cours de projection, évacuation progressive des bobines déjà projetées afin de limiter les dégâts en cas d’arrivée inopinée de la police venant opérer une saisie —. D’autre part, le public étant restreint, ce que l’on perd en audience, il faut justement le regagner en intensité, en totalité pour que l’effort n’ait pas été vain, pour que la volonté d‘information attire, malgré les difficultés, le public le plus exigeant, celui qui constituera le plus riche terrain d’investissement social et politique, celui à qui toute vérité est bonne a dire.

LES BIDONVILLES D’« OCTOBRE A PARIS »
Il ne s’agit pas d’entrer, ici, dans la critique de détail des films du cinéma parallèle, mais seulement d’esquisser quelques considérations générales. Le plus important n’est pas que « J‘ai huit ans » soit esthétiquement la réussite la plus rigoureuse, la plus intransigeante dans son refus de l’effet, se contentant d’illustrer de dessins d’enfants des commentaires spontanés, maladroitement dits et improvisés devant le micro, ni que la qualité technique d’«Octobre à Paris » soit excellente et souligne que le cinéma parallèle doit, autant que possible, disposer des garanties apportées par la qualification personnelle et ne pas se contenter d‘amateurisme, ni qu’«Octobre à Paris » soit encore plus convaincant lorsque son réalisateur a intégralement respecté les exigences formelles du cinéma-vérité, lorsqu’il s’est contenté d’enregistrer des confessions parfois tâtonnantes, parfois maladroites et presque incompréhensibles pour des français mais obligatoirement authentiques ; alors que quelques scènes reconstituées, la préparation de la manifestation du soir sanglant d’Octobre, la sortie des bidonvilles, ont été visiblement reconstituées et risquent d’enlever au film de son crédit, de son caractère de témoignage direct, incontestable.
En effet, si seulement des photos de journaux illustrent la descente calme et pacifique des manifestants algériens dans les rues de Paris, la répression sauvage, c’est bien parce que les conditions de clandestinité du film d’abord, mais surtout de la préparation de la manifestation avaient imposé le secret absolu. Les opérateurs n’avaient pas été prévenus, rien n’était plus normal, l’enjeu était trop essentiel, le risque trop grand, et ils ont dû se contenter de reprendre des documents fixes et publics. Comment admettre alors qu’ils aient été prévenus plusieurs jours à l’avance pour assister à une réunion de préparation à la manifestation ?
Tout cela compte, tout cela doit être strictement jaugé car l’efficacité du cinéma parallèle dépend naturellement aussi de la qualité de son exécution, de la sûreté et de la rigueur de ses méthodes mais le plus important est certainement qu’une brèche ait été ouverte, par laquelle il faut déboucher sur l’approche de quelques critères.

RÉALITÉ DE LA CONDITION OUVRIÈRE
La préoccupation la plus aigüe est la survie du cinéma parallèle.
Né sous l’effet de la guerre d’Algérie, il ne faudrait pas qu’il disparaisse avec elle. Certes l’intransigeance de la censure et des structures commerciales rendait alors plus impérative la nécessité d’entreprises marginales, anormales.
Mais bien d’autres interdits demeurent, bien des sujets défendus, de la réalité de la condition ouvrière, à de nombreux problèmes moraux ou sociaux, sur lesquels le conformisme bourgeois jette un voile pudique. L’essentiel, si le cinéma parallèle veut vivre, c’est surtout qu’il polarise les efforts militants et qu’il ne prenne ses risques que pour des sujets en valant effectivement la peine. Un cinéma militant tenant compte des interdits, s’arrêtant à mi-chemin, semble, dans les conditions de notre actualité immédiate au moins, être dans la plupart des cas décevant et constituer un gaspillage inutile (pas toujours parce que, même nanti d’un visa, « Les Canuts » n’est pas de ces films qu‘aurait accepté de produire un producteur commerçant ; de plus un cinéma militant peut aussi assumer, parmi ses tâches, celle de former des équipes, de les qualifier techniquement, au contact des professionnels participant à l’effort commun). Un cinéma extra-légal, par contre, complétera beaucoup plus certainement les manques à gagner enregistrés par le cinéma légal et commercial, quel que soit le parti intelligent et courageux qu’arrivent parfois à en tirer des professionnels obstinés à se servir de leur métier pour exprimer, même dans les rets de la
censure et de la commercialisation, le monde réel.
JAMAIS UN CINÉMA DOMINANT
Mais c‘est à cette étape que se posent gravement les problèmes de diffusion. Tout film, même assuré des appuis bénévoles les plus dévoués, les plus désintéressés, signifie malgré tout une mise de fonds. L’évolution des techniques de tournage, les caméras portatives et insonorisées, les micros portatifs ont certes multiplié les possibilités d’enregistrement et facilité le financement par l’allègement du matériel, en même temps qu’elles facilitent un tournage toujours plus ou moins clandestin et donnant, par un caractère d’information directe, saisi au Vif, une garantie d’authenticité concrète.
Même réduit, même pouvant être couvert par des prêts ou des dons individuels, le budget de financement de tels films ne peut être placé à fonds perdus, sous peine que chaque entreprise risque d’être la dernière. Il faut que l’argent rentre pour permettre la poursuite d’autres tentatives. Pour cela, il faut bien que les réseaux de réalisation se doublent d’un réseau de distribution et, là, les organisations populaires qui supportent mal les limitations officielles à la liberté d’expression et d’information, toutes les organisations populaires, partis, organisations diverses, syndicats ont un rôle des plus importants à jouer.
L’expérience a, en effet, prouvé que la clandestinité empêchant une trop large publicité, contraignant à des précautions multiples pour le transport des copies, la création de centres de diffusion s’imposait. En effet, on imagine mal des « distributeurs » du cinéma parallèle attendant que tel ou tel « client » vienne se présenter à leurs bureaux pour leur commander une copie, pour une seule projection, et prenant le risque d’expédier le film par la poste. Par contre, si la diffusion du cinéma parallèle se décentralise, si les organisations en particulier achètent des, copies au lieu de les louer, elles auront le constant souci de rentabiliser, matériellement et idéologiquement, leur achat, d’entreprendre des démarches nouvelles auprès de leurs organismes subordonnés, auprès d’organisations voisines.
De meilleures garanties de sécurité pourront être respectées : un seul transport, effectué par un militant, suffisant pour transférer la copie du lieu de production au heu de consommation.
Il serait naturellement fou de se leurrer d’illusions. Le cinéma parallèle ne sera jamais, quels que soient les progrès qu’il accomplisse sur tous les plans, un cinéma dominant ; il ne pourra jamais être qu’une échappée relative aux conditions générales d’asservissement du cinéma et de tous les moyens d’information. Mais il peut et il doit demeurer, en marge du cinéma légal qui ne manque ni de la possibilité, ni souvent de l’ambition d’accomplir très valablement sa mission, un secteur restant entièrement libre de toute contingence intellectuelle, morale, de toute contrainte sociale et politique.
Ce serait déjà un acquis essentiel, une zone préservée pour maintenir les consciences les plus attentives, pour les mobiliser et éclairer leur action d’une connaissance impossible à réaliser par d’autres moyens.