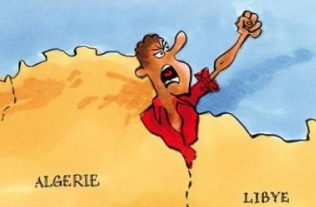2011 marque le surgissement des peuples arabes sur la scène politique, une profonde prise de conscience que l’ordre ancien ne peut se maintenir, que les pays arabes ne peuvent rester à l’écart du monde
Il y a trois ans, à la surprise générale, aussi bien de la part des intellectuels arabes enfermés dans leurs tours d’ivoire que des experts occidentaux qui pontifiaient sur la passivité des masses arabes ainsi que sur leur peu d’aspiration au changement et à la démocratie, le peuple égyptien, à la suite du peuple tunisien, descendait dans la rue et mettait à bas en quinze jours une dictature qui paraissait inébranlable. Le caractère pacifique des changements intervenus, certes avec des martyrs mais sans massacres à grande échelle, a étonné le monde.
Trois ans plus tard, le scepticisme et la déception ont repris le dessus, beaucoup d’intellectuels arabes et nombre de spécialistes européens et américains dissertent sur « l’hiver islamiste », sur l’arriération des masses — en Egypte, par exemple, certains se demandent sérieusement s’il faut accorder le droit de vote aux analphabètes —, sur le « complot occidental » et sur l’impossibilité de changer ce monde arabe. Ils reprennent même le slogan des anciens régimes, « mieux vaut les militaires que les islamistes ».
Avec le recul, comment analyser ce qui s’est vraiment passé en Tunisie comme en Egypte au début de l’année 2011 ? Etait-ce une révolution ? La facilité avec laquelle sont tombés les présidents Ben Ali et Moubarak a créé l’illusion : leur chute n’était qu’une première étape. On pourrait même ajouter que si ces deux présidents sont tombés si aisément c’est parce que… les régimes sont restés en place. Autrement dit, l’essentiel de la classe dirigeante en Egypte et en Tunisie a compris qu’elle pouvait sacrifier les deux raïs sans remettre en cause ses privilèges. Les grandes fortunes et les hommes d’affaire, souvent corrompus, l’« Etat profond », la haute bureaucratie, se sont résignés à accepter le départ de dictateurs devenus gênants, justement pour tenter de garder leurs prébendes, afin d’éviter une révolution de plus grande ampleur.
Cela nous amène à une réflexion sur la différence entre la situation dans ces deux pays et en Syrie. Là, le président Bachar Al-Assad a réussi à convaincre une partie essentielle des classes au pouvoir que sa chute entrainerait non seulement la perte de leurs privilèges, mais aussi leur liquidation physique. Pourquoi Assad a‑t-il réussi là où Ben Ali et Moubarak ont échoué ? De nombreux facteurs ont joué, et d’abord la détermination brutale du pouvoir qui s’est soudé, après quelques hésitations, autour du chef. Mais la militarisation de l’insurrection, l’arrivée de combattants djihadistes étrangers, l’incapacité de l’opposition à « rassurer » les minorités et une partie des élites ont facilité les manœuvres d’Assad et lui ont permis de se draper dans les oripeaux de « la lutte contre les djihadistes ».
Au pays du Nil, la victoire représentée par le départ du président Moubarak ne marquait pas la disparition de l’Etat ancien. La réforme en profondeur de celui-ci, en premier lieu du ministère de l’intérieur, la réponse aux aspirations de justice sociale de la population (que l’on se rappelle le rôle des grèves ouvrières aussi bien en Tunisie qu’en Egypte), nécessitait une stratégie à court et moyen terme. Or, non seulement les forces d’opposition ont été incapables de formuler un programme réaliste — au-delà de l’invocation incantatoire du modèle nassérien en Egypte, modèle impossible à imposer dans les conditions actuelles (en tous cas aucune force n’a expliqué comment, dans les conditions actuelles, elle comptait appliquer ce modèle) —, mais elles n’ont pas su définir une stratégie de transformation progressive de l’appareil étatique qui aurait permis d’épurer les principaux responsables de l’ancien régime tout en « amnistiant » les autres. C’était une des forces et une des faiblesses du mouvement de janvier-février 2011 : il n’avait pas de programme défini.
Si on compare ce qui s’est passé dans le monde arabe aux grandes révolutions de l’histoire qu’a connues le XXe siècle, il faut remarquer qu’il n’existait (et qu’il n’existe toujours pas) dans le monde arabe ni parti politique, ni idéologie capable de mobiliser les masses (comme en Russie en 1917 ou en Iran en 1978 – 1979) pour briser l’ancien appareil d’Etat et en édifier un nouveau, pour faire du passé table rase. C’est un constat. Certains le regretteront, d’autres s’en réjouiront, mais c’est une réalité qui ne changera pas dans les années qui viennent. Et les révolutions arabes ressembleront plus à un processus, avec des avancées et des reculs, qu’à un bouleversement majeur avec un « avant » et un « après ».
Dans ce processus, les Frères musulmans égyptiens, qui ont participé aux mobilisations de janvier-février 2011, se sont comportés, pour l’essentiel, en force conservatrice, cherchant à trouver des compromis avec l’ancien régime, que ce soit la direction de l’armée ou de la police. Il est ironique que ce soit le ministre de l’intérieur nommé par le président déchu Mohammed Morsi qui orchestre la brutale répression contre les Frères. Une fois arrivé au pouvoir, et malgré les promesses faites aux forces révolutionnaires pour obtenir la victoire au second tour de l’élection présidentielle, Morsi a poursuivi dans cette voie, encouragé, il faut le reconnaître, par les hésitations et les atermoiements de l’opposition représentée par le Front de salut national, par le rapprochement entre celle-ci et les forces de l’ancien système. Au final, par leurs erreurs et leur sectarisme, les Frères musulmans ont même réussi à réhabiliter l’ancien régime aux yeux de nombreux Egyptiens, qui ont fini par justifier le coup d’Etat du 3 juillet.
Mais, malgré l’appui dont ont bénéficié au départ les militaires, malgré la répression (ou à cause d’elle), il est clair que le nouveau gouvernement, simple façade du pouvoir militaire, aura du mal à établir de solides assises. D’autant que ni dans le domaine économique et social (le pays ne vit désormais que grâce à l’aide saoudienne et celle du Golfe) ni sur le plan des libertés — la loi sur les manifestations qui réduit à néant ce droit chèrement acquis par les Egyptiens en témoigne — le pouvoir ne répond aux demandes de la révolution de janvier-février 2011.
A partir de ce constat assez sombre, on pourrait être amené à penser que ce qui s’est passé dans le monde arabe n’est pas une révolution, voire même que c’est un « complot occidental » pour déstabiliser la région. En fait, l’année 2011 marque le surgissement des peuples arabes sur la scène politique, une profonde prise de conscience que l’ordre ancien ne peut se maintenir, que les pays arabes ne peuvent rester à l’écart du monde, que les Etats doivent respecter leurs citoyens, lesquels ont des droits inaliénables. Au-delà des avancées et des reculs, c’est une transformation majeure.
Dans un ouvrage célèbre, Le gauchisme, la maladie infantile du communisme (1920) Vladimir Ilitch Lénine décrivait ainsi une situation révolutionnaire : « C’est seulement lorsque “ceux d’en bas” ne veulent plus et que “ceux d’en haut” ne peuvent plus continuer de vivre à l’ancienne manière, c’est alors seulement que la révolution peut triompher. » Si l’on s’en tient à ces critères, la situation dans le monde arabe reste révolutionnaire.
par Alain Gresh
Soure de l’article : blog du diplo