 Entretien de Stéphanie Dongmo avec Léonora Miano
Entretien de Stéphanie Dongmo avec Léonora Miano
Quel besoin aviez-vous de rassembler des conférences que vous aviez données entre 2009 et 2011 en un recueil ?
J’ai la chance d’être très lue par des étudiants de par le monde, qui travaillent sur les littératures francophones ou d’Afrique. Ils me posent souvent des questions auxquelles répondent ces conférences. Elles ont été données dans des contextes où elles n’étaient pas accessibles à tout le monde, c’était une manière de les partager. Ce sont des conférences qui, à certains égards, parlent un peu de moi et c’est le bon moment dans mon parcours pour me dévoiler un peu plus, même si je reste prudente. Ça reste quelque chose de modeste comme entreprise mais j’espère que ce sera utile.
C’est quoi, habiter la frontière ?
C’est une manière poétique de définir mon identité qui est faite d’un assemblage des choses, puisque je suis en relation avec des mondes différents. Pour les Occidentaux, la frontière c’est là où la porte se ferme, un lieu de rupture, l’endroit qui protège de l’autre. Pour moi, la frontière est un lieu de médiation, là où on rencontre l’autre. Le meilleur moyen de l’habiter c’est d’accepter que ma part européenne et ma part africaine soient constamment en relation. Quand on vient d’un pays comme le Cameroun qui a été traversé par plusieurs nationalités européennes différentes, qui a deux langues officielles, où le côté disparate des populations et de leurs cultures est très visible, où il y a tellement de langues locales dont aucune n’est dominante qu’on est obligé de parler des langues étrangères pour se faire comprendre, la logique du mélange pour créer l’identité est plus évidente. On est obligé d’être dans une démarche qu’Édouard Glissant aurait appelé de “créolisation”. Je crois que ma sensibilité frontalière vient de là.
Finalement, est-ce que tous les hommes n’habitent pas la frontière dans le sens où la pureté culturelle n’existe pas ?
Je crois ça. Mais quand on parle d’hybridité et d’héritage, même culturel, on se rend compte que c’est toujours les populations non blanches qui le reconnaissent plus facilement. L’Europe ne reconnaît pas encore qu’elle aussi a été modifiée dans sa rencontre avec d’autres peuples, même si elle les a dominés. Les Européens boivent le café alors que le café ne pousse pas en Europe. Donc, dire que j’habite la frontière ne fait pas de moi quelqu’un de particulier, on est dans un monde de la multi-appartenance.
Vous écrivez que l’urgence en Afrique n’est pas la politique ou l’économie, mais plutôt de développer une conscience forte de soi. Mais comment le faire lorsqu’on a subi la traite négrière, l’esclavage, la colonisation et aujourd’hui encore le néocolonialisme ?
Aux États-Unis aujourd’hui, on se rend compte que quand on parle des minorités, on n’évoque même pas des Amérindiens qui sont dans leurs réserves. L’Afrique n’en est pas là. Elle a été très blessée, elle a elle-même enfanté certains de ses bourreaux, mais elle a fait la preuve de sa solidité. Il faut se pardonner d’avoir été défait et prendre conscience de ce qui nous reste de beau. Je ne tais pas certaines horreurs qui ont pu se jouer dans nos espaces mais l’horreur est humaine. C’est très important de se regarder avec un peu d’amour. J’ai l’impression que certains Africains s’imaginent que l’Afrique est née avec la colonisation. On n’a pas de mémoire, il faut résoudre ce problème-là. Évidemment, il ne revient pas aux gens qui essaient de survivre au quotidien de le faire, mais aux politiques.
La représentation du Noir en France est très présente dans vos textes. C’est quoi être noir dans la France d’aujourd’hui ?
Ça dépend pour qui. L’Afrique, en dépit de toutes ses meurtrissures, donne une force que ceux qui ont grandi ici n’ont pas toujours eue, parce qu’elle nous permet de consolider notre individualité de manière plus affirmée. Quand on grandit dans une situation de minorité et qu’on ne voit jamais le reflet de soi-même nulle part, je crois que ça fragilise beaucoup. Ce n’est donc pas un hasard que, par exemple, dans le domaine de la littérature, les voix noires qui émergent soient des gens qui ont grandi en Afrique ou aux Antilles, mais pas sur le sol hexagonal. Il reste qu’être Noir en France c’est, pour la plupart, d’être marginalisé. Il n’y a pas de communauté noire, les Noirs n’ont pas pris l’habitude de se fédérer pour faire des choses concrètes ensemble.
Quel regard portez-vous sur le débat sur le droit de vote des étrangers non communautaire en France ?
Est-ce que je peux dire ce que je pense vraiment ? Si je me pose la question de savoir si je veux que les Chinois votent au Cameroun ? Je dis non. Pourquoi est-ce que ce que je ne veux pas pour le Cameroun, je le voudrais pour la France ? J’ai l’impression que ce débat est un pis-aller, une manière finalement de ne pas favoriser l’acquisition de la nationalité française. Il y a plein de gens qui vivent ici depuis trente ans, qui ont des enfants Français, qui demandent la nationalité française et ne l’obtiennent pas, mais qui vont pouvoir voter aux élections locales. En simplifiant l’accès à la nationalité française pour des gens qui le veulent, il ne sera plus question du vote des étrangers.
Et quel regard portez-vous sur un autre débat en cours en ce moment, le racisme anti-Blanc ?
C’est une question intéressante parce que ça nous obliger à nous poser la question c’est quoi le racisme. Le racisme, c’est quelque chose qui est sorti de la pensée blanche qui a décidé un jour qu’elle allait catégoriser l’humanité en races, qu’elle allait même les hiérarchiser, qu’il allait y avoir des catégories qui sortiraient du genre humain et ça a été les Noirs. L’Occidental les a agressés en prenant pour argument cette différence. Je ne sais pas si les Blancs subissent ça. Quand on parle du racisme anti-Blanc aujourd’hui, on parle des gens qui vont insulter un Blanc dans la rue. Mais est-ce qu’on est dans un pays où un Blanc peut avoir du mal à se loger parce qu’il est Blanc, où il peut avoir du mal à trouver un travail parce qu’il est Blanc ? Je ne crois pas.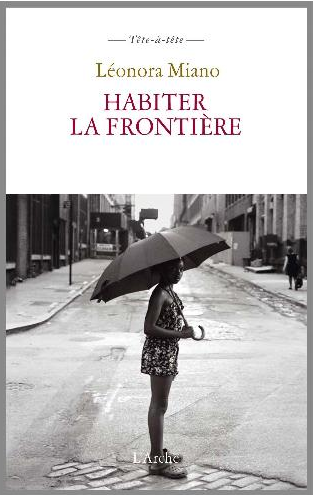
Vous venez justement de recevoir le Prix Seligmann contre le racisme pour Écrits pour la parole, paru en janvier chez L’Arche. Quel sentiment vous inspire cette distinction ?
Ça m’a surtout touchée pour ce texte-là parce que quand il a été monté au théâtre récemment, il a été taxé de raciste. Ce prix vient nous mettre du baume au cœur. C’est une parole qui est très libre et souvent inhabituelle. En lisant le communiqué de presse du prix Seligmann, j’ai eu le sentiment qu’il y a des gens qui pouvaient comprendre ma démarche et l’objectif derrière. Évidemment, ce n’est pas pour bêtement agresser les gens, c’est pour entamer une conversation que ce pays n’a pas forcément envie d’avoir mais qui me semble nécessaire.
Léonora Miano, Habiter la frontière, L’Arche Éditeur, novembre 2012, 144 pages

