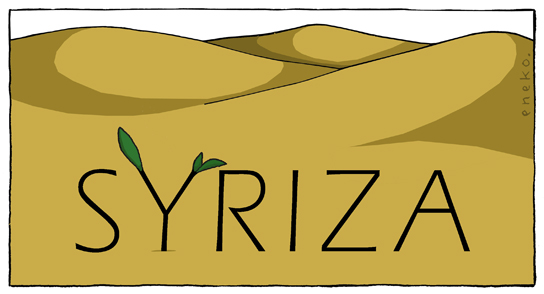Dossier consacré à la situation politique ouverte en Grèce par la percée de Syriza lors des élections du printemps.
Texte écrit par Stathis Kouvelakis pour le numéro 14 de la revue Contretemps.

La percée de Syriza lors de la dernière séquence électorale en Grèce, qui l’a portée jusqu’au seuil du pouvoir gouvernemental, constitue un tournant de la situation européenne. C’est en effet la première fois dans toute l’ère néolibérale, et plus particulièrement depuis le début de l’actuelle crise capitaliste, que les secteurs populaires abandonnent massivement les partis traditionnels, et avant tout la social-démocratie, et se tournent majoritairement vers un parti de la gauche radicale. Plus largement, c’est la première fois dans l’Europe de l’après-guerre qu’un parti à gauche de la social-démocratie, pour l’essentiel issu de la matrice communiste, a postulé en tant que tel au pouvoir, en dehors d’une logique d’alliance avec le courant socialiste ou d’un « compromis historique » avec le parti systémique majoritaire.
Le « laboratoire grec » devient ainsi non seulement celui de la « thérapie de choc » néolibérale, doublée d’un déni de démocratie, appliquée à un pays d’Europe occidentale, ou encore le lieu de mobilisations d’une ampleur et d’une durée inconnues depuis les années 1970, mais aussi le terrain où se déploie la première tentative d’envergure d’une alternative politique radicale au néolibéralisme dans le Vieux continent. Tout se passe en un sens comme si, avec un temps de retard, les réalités sociales mais aussi politiques de l’Amérique latine débarquaient dans notre région, sans doute mâtinées de la dynamique insurrectionnelle et nationale des printemps arabes. Athènes est d’ailleurs bien plus proche du Caire que de Berlin.
Les textes rassemblés dans ce dossier tentent d’apporter des éclairages sur cette situation nouvelle et sa signification, qui va bien au-delà du cas de ce petit pays périphérique du sud-est européen. Vue de Grèce, l’un des éléments les plus frappants depuis le début de l’actuelle crise est en effet le sentiment croissant d’être au centre de l’attention internationale. Pendant la campagne électorale, les dirigeants européens, mais aussi les banquiers et leur contingent d’experts, ne se sont du reste guère privé de s’immiscer dans le débat politique grec, usant de l’intimidation et du chantage afin de dissuader les électeurs de voter pour Syriza. En contrepoint, Syriza a riposté en invitant à ces meetings des représentants d’autres partis de la gauche radicale, essentiellement européenne. Ainsi, le dernier meeting, qui s’est tenu à Thessalonique, a vu Alexis Tsipras et Gaby Zimmer, de Die Linke, prendre la parole. Ce qui a toutefois davantage frappé les esprits, c’est surtout le passage à Athènes ces deux derniers mois de plusieurs figures intellectuelles de premier plan du marxisme et du radicalisme européen et nord-américain. Tariq Ali, Leo Panitch, Slavoj Zizek et David Harvey ont attiré des foules considérables, à une échelle sans doute bien plus importante que celle de leur pays d’origine. Et ils ne se sont pas privés de parler et d’intervenir directement, eux aussi, dans le débat grec, offrant un soutien déterminé à Syriza et leur analyse plus large de la situation du pays. Ce sont eux qui, plus que tout autre personnalité directement politique, ont réussi à faire passer le message que la gauche radicale internationale avait les yeux tournés vers la Grèce et se rangeait de façon quasi-unanime derrière celui qui en portait l’espoir, c’est-à-dire Syriza.
Le point d’orgue fût sans doute atteint le 3 juin lors de la réunion publique animée par Slavoj Zizek et Alexis Tsipras dans la cour intérieure d’une annexe du musée Benaki. Plusieurs milliers de personnes s’y sont entassées, dans une atmosphère électrique, combinant ferveur et amitié, pour écouter le dialogue entre le philosophe slovène, qui a développé avec son brio habituel les idées présentées dans le texte de la London Review of Books inclus dans ce dossier, et le dirigeant de la gauche radicale grecque, qui a fait preuve de son aisance et de sa capacité à se saisir des perches que lui tendait son interlocuteur. Quant à David Harvey, les conférences qu’il a données dans le cadre de la semaine qui lui était consacré par l’université Harokopio d’Athènes se sont transformées en lieu de discussion de la situation politique et de la façon dont le travail du géographe marxiste pouvait servir à en penser les enjeux. L’entretien traduit dans ce dossier en retrace certains aspects.
Il y là matière à réflexion à la fois sur le rôle politique des intellectuels mais aussi sur les dimensions intellectuelles inhérentes à toute conjoncture politique haute. Pour le dire autrement, une situation politique d’exception constitue en elle-même un événement théorique, susceptible d’aimanter et de transformer les forces intellectuelles agissantes du moment. Ce sont donc à quelques premiers aperçus d’un tel processus qu’invitent en fin de compte les éléments de réflexion qui sont ici rassemblés.
A lire (ou à relire) :
Sauvez-nous de nos sauveurs. Plaidoyer pour Syriza
Article de Slavoj Zizek, intitialement paru dans le n° 11, vol. 34, du 7 juin 2012 de la London Review of Books.
Imaginez une scène d’un film dystopique qui décrirait notre société dans un futur proche. Des vigiles en uniforme patrouillent dans des centre-ville à moitié désertés traquant des immigrés, des délinquants et des sans-abri. Ceux qui tombent entre leurs mains sont maltraités. Ce qui apparaît comme une image fantaisiste tirée d’un film hollywoodien est la réalité de la Grèce d’aujourd’hui. A la tombée de la nuit, des nervis vêtus de noir du mouvement néofasciste et négationniste Aube Dorée – qui a obtenu 7% des voix aux dernières élections et le vote, dit-on, de la moitié des policiers athéniens – patrouillent dans les rues et tabassent tous les immigrés qu’ils trouvent sur leur chemin : Afghans, Pakistanais, Algériens. Voici comment l’Europe est défendue en ce printemps 2012.
Le problème avec la défense de la civilisation européenne contre la « menace immigrée » est que la férocité de la défense menace davantage la « civilisation » que toute présence de musulmans. Avec des amis préposés à sa défense tels que ceux-là, l’Europe n’a pas besoin d’ennemis. Il y a un siècle, G. K. Chesterton a défini en ces termes l’impasse à laquelle se trouve confrontés ceux qui critiquent la religion : « les hommes qui commencent par combattre l’Eglise pour le salut de la liberté et de l’humanité finissent par laisser tomber la liberté et l’humanité pour pouvoir combattre l’Eglise… Les partisans de la sécularisation n’ont pas détruit des choses divines ; ils ont toutefois détruit des choses séculières, si cela peut les consoler ». Nombreux sont les libéraux qui veulent combattre le fondamentalisme anti-démocratique avec un acharnement tel qu’ils finissent par jeter par-dessus bord la liberté et la démocratie si cela leur permet de combattre le terrorisme. Si les « terroristes » sont prêts à détruire ce monde par amour d’un autre, nos combattants de la cause antiterroriste sont prêts à détruire la démocratie du fait de leur haine de l’Autre musulman. Certains d’entre eux aiment tellement la dignité humaine qu’ils sont prêts à légaliser la torture pour la défendre. Il y là une inversion du processus par lequel les défenseurs fanatiques de la religion commencent par attaquer la culture contemporaine sécularisée et finissent par sacrifier leurs propres valeurs religieuses dans leur volonté d’éradiquer des aspects de cette sécularisation qu’ils haïssent.
Mais les défenseurs anti-immigrés de la Grèce ne sont pas le principal danger : ils sont juste le produit dérivé de la véritable menace, la politique d’austérité qui est la cause des difficultés de la Grèce. Le prochain tour des élections grecques aura lieu le 17 juin. L’establishment européen nous avertit que ces élections sont cruciales : c’est non seulement le sort de la Grèce mais peut-être aussi celui de l’Europe tout entière qui est en jeu. Une issue, la bonne selon eux, serait de poursuivre le douloureux mais nécessaire processus de rétablissement au moyen de l’austérité. L’alternative, si le parti « de gauche extrême » Syriza l’emporte, serait un vote pour le chaos, pour la fin du monde (Européen) tel que nous le connaissons.
Les prophètes de malheur ont raison mais pas au sens où ils l’entendent. Les critiques de nos institutions démocratiques déplorent que les élections n’offrent pas de vrai choix : à sa place, ce que nous avons c’est un choix entre un parti de centre-droit et un parti de centre-gauche dont les programmes sont quasiment interchangeables. En Grèce, le 17 juin il y aura un vrai choix : l’establishment (PASOK et Nouvelle Démocratie) d’un côté, et Syriza de l’autre. Et, comme c’est presque toujours le cas quand un vrai choix est possible, l’establishment est emporté par la panique : le chaos, la pauvreté et la violence s’ensuivront, disent-ils, si le mauvais choix l’emporte. La simple possibilité d’une victoire de Syriza est censée avoir provoqué des sueurs froides sur les marchés mondiaux. La prosopopée idéologique est à son point culminant : les marchés parlent comme s’il s’agissait de personnes, et ils expriment leur « inquiétude » pour ce qui risque de se passer si les élections n’aboutissent pas à la formation d’un gouvernement disposant d’un mandat qui lui permet de poursuivre l’application du programme d’austérité et de réforme structurelle concocté par l’Union Européenne et le FMI. Les citoyens grecs, eux, n’ont guère le temps de s’inquiéter de telles perspectives : ils sont suffisamment de raisons d’inquiétude au sujet de leur vie quotidienne, qui sombre dans une misère inconnue en Europe depuis des décennies.
De telles prophéties s’avèrent autoréalisatrices, elles engendrent la panique et, de ce fait, entrainent les conséquences dont elles étaient censées nous écarter. Si Syriza gagne, l’establishment européen espérera que nous tirerons la dure leçon de ce qui arrive quand on essaie de briser le cercle vicieux de la complicité mutuelle entre la technocratie bruxelloise et le populisme anti-immigré. C’est pourquoi, dans l’un de ses récents entretiens, Alexis Tsipras, le dirigeant de Syriza, a insisté sur le fait que, si Syriza gagne, sa première priorité sera de combattre la panique : « le peuple surmontera la peur. Il ne pliera pas, il ne cèdera pas au chantage ».
Syriza est face à une tâche quasiment impossible. Sa voix n’est pas celle de la « folie » de la gauche extrême mais celle de la raison contre la folie de l’idéologie du marché. Dans sa volonté de l’emporter, Syriza a banni la peur de la gauche de prendre le pouvoir ; il a le courage de vouloir en finir avec le chaos causé par autrui. Il lui faudra pour cela pratiquer une combinaison extra-ordinaire de fidélité aux principes et de pragmatisme, d’engagement démocratique et de capacité à agir de façon rapide et déterminée quand cela sera nécessaire. Pour avoir une chance minimale de succès, il aura besoin d’une manifestation pan-européenne de solidarité : non seulement d’un comportement digne de la part de tout autre pays européen mais aussi d’idées plus originales, comme celle de la promotion d’un tourisme de solidarité cet été.
Dans ses Notes vers une définition de la culture, T. S. Eliot a remarqué qu’il y a des moments où le seul choix possible est celui entre l’hérésie et la non-croyance. En d’autres termes, la seule façon de maintenir une religion vivante dans une telle situation est d’accomplir une scission sectaire. Telle est la position de l’Europe actuellement. Seule une nouvelle « hérésie » — que Syriza représente en ce moment – est en mesure de sauver ce qui mérite d’être sauvé de l’héritage européen : la démocratie, la confiance dans le peuple, la solidarité égalitaire etc. L’Europe que nous aurons si Syriza est tenu en échec sera une « Europe aux valeurs asiatiques », qui n’ont, bien entendu, rien à voir avec l’Asie mais tout à voir avec la tendance du capitalisme contemporain à suspendre la démocratie.
C’est ici que réside le paradoxe qui est au cœur des « élections libres » de nos sociétés démocratiques : on est libre de choisir à condition de faire le bon choix. C’est pourquoi quand le mauvais choix l’emporte (comme quand l’Irlande a rejeté la constitution européenne), il est traité comme une erreur, et l’establishment exige immédiatement la réitération du processus « démocratique » pour corriger l’erreur. Quand Georges Papandréou, alors premier ministre, a proposé un référendum sur le mémorandum proposé par l’UE en novembre dernier, le référendum en tant que tel a été rejeté en tant que mauvais choix.
Il y a deux récits principaux à propos de la crise grecque dans les médias : le récit allemand-européen – les Grecs sont irresponsables, paresseux, dépensiers, fraudeurs etc., ils ont besoin d’être contrôlés et d’apprendre la discipline financière – et le récit grec : notre souveraineté nationale est menacée par la technocratie néolibérale imposée par Bruxelles. Quand il est devenu impossible d’ignorer le sort du peuple grec, un troisième récit est apparu : les Grecs sont maintenant présentés comme des victimes nécessitant de l’aide humanitaire, comme si une guerre ou une catastrophe naturelle avaient dévasté le pays. Même si tous ces récits sont faux, le troisième est le plus dégoûtant. Les Grecs ne sont pas des victimes passives : ils sont en guerre contre l’establishment économique européen, et ce dont ils ont besoin c’est de solidarité dans leur lutte, car cette lutte est également la nôtre.
La Grèce n’est pas une exception. C’est l’un des principaux terrains où est mis à l’épreuve un nouveau modèle socio-économique dont le champ d’application est potentiellement illimité : une technocratie dépolitisée dans laquelle des banquiers et autres experts sont autorisés à détruire la démocratie. En sauvant la Grèce de ces soi-disant sauveurs, nous sauvons également l’Europe elle-même.
Le 25 mai 2012
Traduit par Stathis Kouvélakis

Syriza ou le miracle grec
de Stathis Kouvelakis
Ce miracle s’est-il d’abord produit ? Certes, Syriza a raté, à 2,5 points derrière la Nouvelle Démocratie (droite), la première place et la majorité relative. Un gouvernement pro-Mémorandum s’est formé, qui associe la droite, les débris du PASOK et, dans l’indispensable rôle de l’alibi de « gauche », la dite « Gauche Démocratique », à savoir l’ancienne aile droite de Syriza qui a quitté le parti il y a deux ans. Cette victoire s’explique avant tout par un climat d’hystérie et de peur entretenu par les médias grecs et les forces systémiques tel que le pays n’en avait pas connu depuis la période qui a suivie la guerre civile. Les dirigeants européens, Hollande et Merkel en tête, n’ont pas hésité à prêter main forte aux partis pro-mémorandum et à intervenir ouvertement dans la campagne électorale grecque, brandissant le spectre de l’expulsion de la Grèce l’eurozone en cas de victoire de la gauche radicale.
Face à cette formidable conjonction de forces hostiles, internes et externes, Syriza a tenu seul, crucialement dépourvu d’alliés, même critiques, sur sa gauche. Sa proposition d’un gouvernement unitaire des forces de gauche anti-austérité s’est heurtée au refus catégorique du PC grec (KKE), qui a axé sa campagne sur la dénonciation de Syriza et des « illusions » créées par son « opportunisme ». Il n’en a pas été autrement de la coalition d’extrême-gauche Antarsya, qui n’a eu de cesse de dénoncer le radicalisme supposé insuffisant des propositions de Syriza et de mettre en avant la sortie de l’eurozone et de l’UE comme objectifs immédiats d’une issue « anticapitaliste » à la crise. Ces deux formations ont certes été humiliées dans les urnes, perdant respectivement la moitié et les deux-tiers de leur électorat1, mais le mal était fait. Et la leçon est claire : même si la force la plus unitaire se voit massivement récompensée, et le sectarisme lourdement sanctionné, la division des forces populaires ne peut que conduire à multiplier les occasions ratées.
Le scrutin du 17 juin a prolongé et radicalisé les tendances apparues lors de celui du 6 mai. Il laisse apparaître un pays coupé en deux, la polarisation politique recoupant largement le clivage de classe. Syriza vient largement en tête sans les quartiers populaires des grandes villes ainsi que, dans une moindre mesure, dans les villes de province aux traditions anti-droite. Dans les zones ouvrières, Syriza approche les 40% des voix, et accentue sa percée de mai, tout en confortant sa première place dans toutes les classes d’âge de moins de 55 ans et toutes les catégories de la population active (chômeurs inclus) à l’exception des agriculteurs et des indépendants-patrons de l’industrie et du commerce. La droite, si elle obtient au niveau national le deuxième score le plus faible de son histoire (le record négatif étant celui de mai dernier), remonte de façon spectaculaire dans les quartiers de classes moyennes et aisées, ainsi que dans les aires conservatrices des provinces. Sa campagne de peur anti-Syriza, agrémentée d’une forte dose de discours raciste et sécuritaire, lui a permis de regrouper l’électorat conservateur qui s’était dispersé lors du scrutin de mai dans de multiples petits partis néolibéraux ou d’extrême-droite, à l’exception des néo-nazis d’Aube Dorée, qui ont retrouvé à l’identique leur score du mois dernier.
Cette victoire de la droite et de ses alliés pro-mémorandum risque pourtant de s’avérer une victoire à la Pyrrhus. Avec 27% des suffrages, et une dynamique conquérante, Syriza constitue désormais une force d’opposition qui est en mesure de rendre la vie difficile à l’actuel gouvernement. Un gouvernement qui n’a pas d’autre choix que de poursuivre dans la voie du désastre et de mettre en œuvre de nouvelles mesures d’austérité et de démantèlement de ce qui reste d’Etat – pas seulement social mais d’Etat tout court. Les tâches qui attendent la formation centrale de la gauche radicale n’en sont pas moins redoutables : surmonter le hiatus considérable entre sa réalité organisationnelle –limitée et largement tournée vers la jeunesse et le salariat diplômé – et son audience électorale, construire des liens durables avec les secteurs ouvriers et populaires qui ont placé en elle ses espoirs, engager un processus surmontant l’actuelle division entre composantes au sein de la coalition, structurer une opposition dynamique dans les mobilisations et les réseaux de solidarité et d’entraide qui essaiment dans une société qui lutte quotidiennement pour la survie. Enfin, dépasser ses limites actuelles en construisant un rapport politique productif avec les autres forces de la gauche radicale, ouvrant ainsi la voie à une sortie par le haut à la grave crise interne dans laquelle leur sectarisme les a entraînés.
Quoi qu’il arrive par la suite, on peut d’ores et déjà affirmé que Syriza a remporté une victoire de portée historique. Sa percée a montré qu’ en un sens « tout était possible » pour la gauche radicale, plus exactement qu’il était possible pour une force qui regroupait jusqu’à récemment autour de 5% de l’électorat de devenir l’expression majoritaire des couches ouvrières et populaires et de postuler au pouvoir gouvernemental. C’est en cela que consiste le vrai « miracle » de Syriza, dans la démonstration que l’horizon de la radicalité de gauche n’est pas celui de l’éternelle « résistance », du « contre-pouvoir » ou de la préparation d’un mythique « grand soir » mais celui d’une voie concrète vers la conquête du pouvoir et le changement social. Les expériences latino-américaines, de l’Unité Populaire chilienne au MAS bolivien, rattrapent le Vieux Continent, plaçant la gauche de transformation dans une nouvelle étape de son histoire, celle où, pour les classes subalternes, la victoire est à nouveau à l’ordre du jour. Pour elles, le XXIe siècle vient peut-être seulement, enfin, de commencer.
“Syriza est un mouvement emblématique”
entretien avec David Harvey
David Harvey s’est trouvé en Grèce du 20 au 27 juin dans le cadre de la semaine qui lui était consacrée par les départements de géographie et d’urbanisme de l’université Harokopeion du Pirée. Il a accordé cet entretien, publié le 24 juin 2012, au quotidien grec de Syriza Avghi.
Aux élections du 17 juin, Syriza est arrivé en deuxième position à l’échelle nationale mais il était en tête dans le grand Athènes, le principal centre urbain, où vit un peu moins de la moitié des habitants du pays. Comment expliquez-vous ce résultat compte tenu du fait que la droite était largement en tête dans les quartiers aisés, tandis que les partis centristes, tout comme les couches intermédiaires, se sont affaissés ? Faut-il recourir davantage à la géographie marxiste ?
Oui, il nous faut certainement davantage de géographie marxiste. Je n’ai pas une vision d’ensemble des données démographiques mais, compte tenu de la dynamique de la situation, le plus probable est que les centres urbains soient davantage touchés par la crise que la province, où sans doute une forme d’autosuffisance alimentaire semble possible.
Dans la périphérie de la Grèce le chômage est cependant très élevé.
Oui, mais les structures sociales de ces régions, où les gens travaillent souvent à leur compte, où le coût de la vie est moindre, font que la population est moins dépendante des services sociaux qui ferment actuellement. Peut-être même que ces électeurs ont craint, comme on me l’a rapporté, que Syriza ne leur confisque leur maison… Je n’ai pas les données en main pour faire une estimation de la situation, je raisonne donc sur la base de ce qui s’est passé en Argentine au début des années 2000, où le chômage énorme affectait essentiellement les grandes villes. La province était moins touchée. Les conséquences de la crise ont d’une façon générale surtout affecté les habitants des zones urbaines. Quand on regarde la carte des résultats électoraux en Grèce, on remarque que Syriza a obtenu ses meilleurs résultats dans les grandes villes, à Thessalonique , au Pirée, dans les quartiers ouvriers d’Athènes. Cette inégale répartition spatiale des effets de la crise n’a rien d’inhabituel, mais il nous faut davantage de données pour donner des réponses plus précises.
La gauche radicale considère que la crise est systémique. Est-ce également votre avis ? Y a‑t-il, et si oui dans quelle mesure, des spécificités de la crise grecque ? Pour les néolibéraux tout est dû à la taille et à la structure du secteur public.
Il y a certainement des caractéristiques qui sont propres à la Grèce, telles que le système fiscal, le niveau des inégalités et la dissimulation de la dette pratiquée pendant plusieurs années. Tous ces facteurs ont aggravé la crise mais en aucun cas je ne dirai qu’ils l’ont provoquée. La crise est bien systémique, il n’y a aucun doute là dessus. Une multiplicité de raisons, toutes liées au fonctionnement du système capitaliste, explique pourquoi le choc a été si violent et aussi pourquoi il s’est manifesté de façon si inégale selon les pays.
Certaines régions du monde n’ont pas été sérieusement affectées par la crise. Ce cycle, car il s’agit d’un cycle parmi d’autres de la crise, n’a pas touché l’Amérique latine de la même façon que l’Europe. Eux ont été frappés par la crise des années 2001 – 2002 et ce qui s’est passé c’est que, une fois la crise passée, ils ont pris conscience du problème. L’Argentine par exemple a réglé la question de sa dette, qui atteint actuellement à peine 7% de son PIB, alors que la dette allemande atteint 80%… A l’époque, plusieurs pays qui ne disposaient pas de réserves de devises ont été davantage touchés, par exemple dans le sud-est asiatique.
A un niveau plus général, ce qui a débuté comme crise de l’immobilier, liée aux subprimes, est devenu crise bancaire. Comme il a fallu sauver les banques, la crise est devenue une crise de la dette publique et les pays qui ne disposaient pas d’excédents, et qui étaient par ailleurs confrontés à d’autres problèmes, se sont retrouvés d’emblée dans une posture difficile. Mais, une fois de plus, chaque cas est particulier.
Celui de l’Espagne par exemple découle d’une crise de l’immobilier et non d’une crise de financement de la dette publique comme en Grèce. Relevons toutefois qu’en Grèce, les dépenses publiques étaient également liées à l’immobilier, aux travaux publics et à la spéculation foncière. La dette a gonflé de façon significative lors de la préparation des Jeux Olympiques de 2004. Il y a une longue histoire désormais de villes, et parfois même de pays, qui se retrouvent ruinés suite à l’organisation de JO. Nous pouvons donc en conclure que la crise est systémique, mais que d’autres facteurs entrent en ligne de compte, qui façonnent et accentuent la forme que prend la crise sans en être la cause.
Le thème de l’une des conférences que vous avez donnée à Athènes est celui des « villes en tant que lieux de résistance et d’espoir ». L’un des principaux mots d’ordre de la droite grecque lors des dernières élections était de « reconquérir nos villes », d’en chasser les immigrés, les manifestants, etc. A qui appartiennent les villes en fin de compte ?
Le droit de chacun, individu ou groupe, à la ville est un enjeu du rapport de forces. Divers groupes réclament leur droit : des spéculateurs immobiliers, des traders de la bourse, des entrepreneurs… Et, bien entendu, lorsqu’il s’agit de sécurité, diverses tentatives populistes essaient de tirer profit de la situation, en promettant le rétablissement de l’ordre et la « reconquête des villes ». Il y a diverses versions de ces tentatives. Il y a les versions de droite mais il y a aussi celle des mouvements sociaux à l’échelle mondiale, par exemple le mouvement féministe ou celui qui réclame le droit de circuler la nuit (reclaiming the night). Eux aussi mettent en avant la sécurité, mais d’une autre façon. Ce droit est donc toujours un enjeu de négociations, de rapports de force.
La question est le droit de qui on décide de soutenir. En ce qui me concerne, je suis en faveur du droit de la population à faible revenu qui fait marcher la ville. Cette population a le droit de décider à quoi doit ressembler la ville qu’elle fait fonctionner et qu’elle rend vivable au prix de durs efforts.
L’éboueur, le commerçant, le serveur qui va livrer au riche sa tasse de café, la femme qui garde les enfants de la bourgeoisie, tous ces groupes n’ont aucun droit de participer aux décisions et pourtant ils subissent tous les inconvénients liés à la vie dans une ville dotée de moyens de transports et de possibilités de logement insuffisants. Je désire fortement voir apparaître un mouvement qui revendique la ville et qui représentera ceux qui sont marginalisés face à ceux qui disposent de tout le pouvoir économique, mais non le droit, de décider.
Pensez-vous que l’Europe pourra un jour se dégager de l’emprise des politiques néolibérales ? Les peuples européens sont ils prêts à exiger un autre système, qui s’écartera de la voie des privatisations, de la financiarisation et de la gestion de la crise que met actuellement en œuvre l’establishment européen ? La zone euro et l’Union Européenne sont-elles viables ?
Voilà de nombreuses et importantes questions ! En ce qui concerne le néolibéralisme, la réponse dépend de la manière dont il est défini. Pour moi le néolibéralisme est un projet de classe visant à concentrer la richesse entre les mains d’une couche très mince grâce à la financiarisation et aux autres moyens que vous avez mentionnés. Telle est en gros la définition du néolibéralisme depuis la fin des années 1970 et il constitue une constante des programmes d’ajustement structurel mis en œuvre par le Fond Monétaire International, qui visent toujours à sauver les institutions financières au détriment des populations.
Dans le monde de Keynes, on parlait de redistribution en faveur des pauvres et non en faveur des riches, comme c’est le cas depuis 30 ans. Et ce processus n’est nullement affecté par la crise. Durant ces cinq dernières années de crise mondiale les riches n’ont cessé de s’enrichir. Ce qui s’est passé en 1982 au Mexique avec le programme d’ajustement structurel se produit actuellement en Grèce. Vous rétribuez les détenteurs de titres de la dette, qui eux n’ont rien à payer, tandis que la charge incombe à la population.
Ce n’est donc pas la fin du néolibéralisme mais sa poursuite avec des moyens barbares. Tant qu’il n’y aura pas de prise de conscience de la nécessité de renverser ce modèle, je ne pense pas que sa dynamique sera altérée. Cette prise de conscience commence seulement à se faire à une échelle plus large. Au Chili, le mouvement étudiant a compris que si Pinochet est parti, le « pinochetisme » est toujours en place et c’est à cela qu’il faut s’attaquer. Les Britanniques se sont débarrassés de Thatcher mais pas du thatchérisme.
Je pense que Syriza est en Grèce une force politique qui comprend qu’il ne s’agit pas de se débarrasser des travers les plus gênants du modèle néolibéral mais du modèle lui-même. C’est la raison pour laquelle Syriza est un mouvement emblématique pour toute l’Europe. Nous avons vu en effet de nombreuses manifestations dans les rues d’Europe, les Indignés en Espagne, le mouvement des places en Grèce, mais c’est la première fois que nous voyons émerger de cela une force politique qui est mesure d’offrir une direction. Il faut étendre cela partout en Europe.
Quelque chose de cet ordre s’est produit, dans une certaine mesure, au Chili avec le mouvement étudiant, un sondage récent a indiqué que 70% de la population soutient la mobilisation. Dans la mesure où un parti s’approche du pouvoir et gagne en expérience politique, il est en mesure de formuler un discours alternatif au modèle néolibéral. Ce qui me semble si encourageant dans la percée de Syriza c’est que c’est la première fois que quelque chose de ce genre se produit en Europe.
Nous avons vu des partis socialistes ou sociaux-démocrates traditionnels, comme le PS en France, bouger mollement, nous voyons les travaillistes britanniques évoluer très timidement dans le sens d’une prise de distance avec le modèle dominant. Tout cela est positif mais personne de ce côté là ne s’est jusqu’à présent opposé avec détermination au néolibéralisme.
(Traduction de Stathis Kouvélakis)