Dans les milieux militants « gauchistes », la librairie Quilombo est connue comme le loup blanc. Normal : c’est l’endroit parfait pour dénicher un bon bouquin politique ou des publications peu relayées ailleurs. Comme elle fête ses dix ans et qu’elle est tenue par des amis, on s’est dit qu’on allait leur donner la parole. Copinage ? Peut-être, mais pour la bonne cause. D’autant qu’ils ont des choses à dire.
Source de l’article : article 11

la librairie Quilombo, 23 rue Voltaire, Paris (France)
Photo par Formes Vives. Les autres clichés qui illustrent cet entretien sont de l’amie Sam
De l’extérieur, l’endroit ne paye pas de mine, malgré des vitrines engageantes. Engoncée dans la façade d’un immeuble quelconque de la peu animée rue Voltaire, dans l’Est parisien, la petite librairie Quilombo cache bien son jeu. Une fois la porte passée, elle se révèle chaleureuse et animée. Loin de l’image un peu tristounette que se coltinent parfois les lieux militants. Des gens passent – amis, quidams du quartiers, militants –, flânent entre les rayons s’arrêtent le temps de feuilleter quelques bouquins et de tailler la causette avec Bastien ou Jacques, les deux employés à mi-temps qui se partagent les jours d’ouverture. Une petite expo de graphistes inconnus au bataillon (Formes Vives ? C’est qui, ça ?[[À ceux qui n’auraient pas compris le clin d’œil : les aminches de l’atelier Formes Vives ont mis en page – avec le typographe Thibaud Meltz — la version papier d’Article11. Ils seront toujours à la manœuvre pour notre retour en kiosque en février.]]) égaye les murs de ses affiches colorées, tandis que le comptoir accueille des piles de flyers en pagaille. Home sweet home, ou presque.
À l’image de la librairie Publico[Située rue Amelot, pas loin de la Place de la République, Publico est la « principale » librairie anarchiste de Paris, gérée par la FA.]], Quilombo est le genre de lieux qui donne l’impression d’avoir toujours été là et d’être durablement enraciné dans le paysage. Sans doute parce qu’on a pris l’habitude d’y passer régulièrement et qu’elle dépanne régulièrement quand on cherche un bouquin politique et qu’on ne veut surtout pas passer par la FNAC ou – encore pire – par Amazon. Pourtant, la librairie fête seulement ses dix ans et sa survie reste – sur la longueur – incertaine : les temps sont durs pour les libraires indépendants et exigeants ; Quilombo ne fait pas exception à la règle. Une bonne raison, entre autres, pour se rendre aux festivités de soutien organisées par la librairie pour ses dix ans, ce week-end ([programme à découvrir sur le site de Quilombo). Une bonne raison, aussi, pour se procurer le beau journal que les piliers de la librairie ont édité spécialement pour l’occasion.

Retour sur l’histoire de la librairie et ses problématiques avec Cédric – l’un des fondateurs de Quilombo[Cédric est par ailleurs le fondateur des belles [éditions L’Échappée. Il vient même d’y publier un livre, L’Emprise numérique. Comment Internet et les nouvelles technologies ont colonisé nos vies.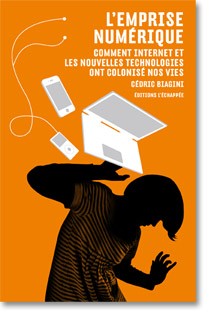 ]] – ainsi que Bastien et Jacques, libraires de choc.
]] – ainsi que Bastien et Jacques, libraires de choc.
.
Comment s’est lancé Quilombo ?
« Quilombo a ouvert en octobre 2002, mais le projet avait été conçu en 1997 – 98 ; il nous a fallu quelques années pour réussir à le monter réellement. Nous nous sommes lancés à quatre, l’équipe a depuis changé à plusieurs reprises – des gens sont partis, d’autres sont arrivés. Au départ, tout le monde était bénévole : il a fallu attendre deux-trois ans pour que nous décrochions notre premier emploi aidé – il s’agissait de Gildas, qui a fait partie de l’aventure un bon moment.
L’idée de départ était de créer une librairie-boutique – on ne savait pas trop comment se positionner – liée au CICP, le Centre international de cultures populaires. L’endroit, aussi connu sous le nom de 21ter rue Voltaire, est un haut lieu parisien de la contestation — ça fait une trentaine d’années qu’il existe — et regroupe 80 associations, de solidarité internationale essentiellement, qui y ont leurs locaux. Il y a aussi des salles où sont organisés des débats, des discussions et des réunions. Dès la conception du projet, nous avions envie de former une sorte d’annexe publique à ce lieu, ouverte sur l’extérieur, où les gens puissent passer quand ils en ont envie.
Nous avons finalement pu loger Quilombo grâce au CICP. Nous n’avions pas assez de garanties pour pouvoir louer nous-mêmes un local et c’est seulement par le biais du centre que nous y sommes parvenus. Nous avons clairement eu de la chance. C’est là le principal obstacle se posant à qui veut monter un tel projet sur Paris : difficile de dénicher un endroit qui soit à la fois accessible financièrement et qui ne soit pas trop mal situé, histoire que le lieu tourne et trouve son équilibre. Une sacré gageure.
Aujourd’hui, une librairie qui se lance doit ainsi bénéficier de fonds propres assez importants et d’une garantie conséquente pour pouvoir louer des locaux. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle un certain nombre de librairies ferment actuellement en centre-ville : les loyers sont devenus trop lourds. Quant à ceux qui font le choix de ne pas s’implanter au centre, ils courent le risque de ne pas vendre assez de livres pour survivre. Dilemme.
Bref, ce local déniché grâce au CICP, nous l’avons aménagé entièrement, mais très modestement — en tout cas au départ. Nous avons construit tous les meubles, comptoirs, tables, avec l’aide d’un copain nommé Gilles, qui a un CAP de menuiserie. Au fil des années, on a réussi à rendre le lieu de plus en plus agréable et ouvert sur le quartier. Au début, la vitrine était assez fermée, elle donnait à la librairie un côté « ghetto militant ». À l’époque, l’endroit était très marqué politiquement et les gens du quartier n’osaient pas trop pousser notre porte ; on vendait alors bien plus de tee-shirts et de matériel militant qu’aujourd’hui.

Cela paraît tout bête, presque inutile à mentionner, mais notre nouvelle vitrine a vraiment bouleversé nos rapports avec l’extérieur. Depuis qu’elle a changé, les gens viennent plus facilement. Les habitants du quartier n’achètent pas forcément des livres ultra-politisés, mais plutôt des bandes dessinées, des illustrés, des romans ; ils peuvent ensuite découvrir le reste. On ne demande pas mieux : c’est tout à fait raccord avec cette idée que nous avions au départ de ne pas nous retrouver enfermés dans les ghettos ultra-militants.
Nous souhaitions ouvrir la librairie à un champ plus large, donner une visibilité à toutes les formes de critique sociale, à l’ensemble du spectre de la contestation. Des livres altermondialistes aux ouvrages anars, en passant par des bouquins de pure théorie marxiste.
On avait aussi la volonté, et on l’a toujours, de mettre en avant les revues. Ailleurs, y compris dans les librairies militantes, elles ne sont la plupart du temps pas réellement mises en valeur. On a ainsi un certain nombre de revues en vente, dont Le Monde Libertaire, Courant Alternatif, Offensive, Z, Article11, CQFD… Bref, des gens dont on se sent proches. Mais il y a aussi des publications beaucoup plus généralistes comme Altermondes, Politis, XXI, Six Mois, Feuilleton – ces revues un peu nouvelles qu’on appelle d’un vilain mot : mooks.
En dix ans d’existence, nous avons senti monter progressivement cette envie d’être davantage accessibles. Nous nous sommes d’ailleurs de plus en plus imposés comme une librairie au sens premier du terme ; dans le même temps, la quincaillerie militante (tee-shirts, broches, etc.) s’est fait plus discrète. Aujourd’hui, nous sommes considérés comme une véritable librairie. Politique et engagée, mais une librairie. Certains estiment même qu’on tend à devenir une librairie indépendante généraliste — ce n’est pas tout à fait vrai : les essais, l’histoire, les sciences humaines et sociales constituent toujours le gros de ce que nous proposons. Mais il est juste de souligner que nous avons peu à peu ouvert les rayons. D’abord à la bande dessinée, puis à la littérature. Dans ces domaines, on fonctionne au coup de cœur : quand quelque chose nous plaît, on le met en avant. »
Dans les milieux militants, certains ont dû vous reprocher cette inflexion plus « généraliste » ?
« Pas l’évolution en elle-même. Par contre, une petite minorité a pu nous reprocher dès le début – et on l’entend encore aujourd’hui – d’être des « sociaux-traîtres » parce qu’on vend les livres au lieu de les donner. Sur ce point, il n’y a pas grand-chose à répondre… Cela dure depuis que les librairies politiques existent, il suffit de lire ce qu’écrit Maspero pour se rendre compte de la bêtise de tels propos et… des vols qui en découlent.
De toute façon, c’est habituel : dès qu’on essaye de faire vivre un lieu, un espace, les reproches ne tardent pas. Logique. Certains peuvent par exemple regretter qu’on vende tel ou tel livre. D’ailleurs, les membres de Quilombo ont tous un droit de veto à ce niveau – chacun de nous peut refuser qu’un livre particulier soit en rayon.
Ce que nous défendons dans le métier de libraire, et auquel nous restons très attachés, c’est justement la revendication d’une forme de subjectivité. Nous n’appartenons pas à une organisation politique et nous ne défendons pas non plus une ligne politique, même si évidemment nous avons des affinités avec certaines, notamment avec tout ce qui est critique anti-industrielle. Mais nous tenons à notre liberté, celle d’avoir en rayons des livres qui n’auraient pas forcément leur place dans un lieu strictement militant. Nous mettons ainsi en avant des éditeurs de bande dessinée indépendants, comme l’Association ou les Requins Marteaux, parce que leur manière de faire des ouvrages, de les penser, nous semble parfois beaucoup plus radicale que certaines pratiques s’affichant comme politiquement puristes. Il s’agit de défendre une certaine vision du livre et de l’édition, des savoir-faire, un état d’esprit.
Nous avons aussi eu envie de nous ouvrir à la littérature, qui est finalement une composante importante de la résistance. Au regard de la numérisation de toutes les sphères de nos vies, elle s’affirme de plus en plus subversive, en elle-même, indépendamment même de ses contenus. Elle joue sur la sensibilité, sur des formes fictionnelles à contre-courant de la multiplication des informations et des données, sur des formes d’écriture complexes et avancées. C’est aussi une manière de se sortir de la société capitaliste dans laquelle nous vivons.
C’est pour les mêmes raisons que nous avons ensuite eu envie de nous intéresser à la littérature jeunesse. Là-aussi, il se passe des choses très intéressantes. Au départ, nous avons sélectionné des ouvrages dont les thématiques portaient sur la remise en cause des discriminations, sur la sexualité ou le racisme. Puis, le spectre s’est élargi. Nous nous sommes alors intéressés à la créativité, à l’inventivité, aux manières de raconter un récit, à la fabrication.
En littérature, BD ou littérature jeunesse, notre sélection est forcément un peu « serrée », limitée quantitativement ; ce n’est pas un problème. Alors que l’idéologie numérique envahit tout, et que s’impose cette idée que tout doit être immédiatement disponible, chacun devant avoir accès à un maximum de données, nous pensons que la subjectivité est une façon d’aller à rebours. Faire confiance dit beaucoup sur le rapport humain : une société où chacun se sent libre et égal est aussi une société où chacun doit être capable de faire confiance à l’autre, à des gens ayant les compétences, le temps de lire, la formation adéquate, pour opérer une sélection, des choix. C’est le modèle inverse d’Amazon, le rejet de la réduction du commerce à sa dimension la plus utilitariste et la plus capitaliste. Nous regrettons parfois que nos locaux soient si petits, mais cela nous permet de faire des choix qu’on assume et qu’on est capables de défendre. »

Et l’aspect économique des choses ?
« Dès le départ, nous portions une envie de professionnalisation : quand on avait imaginé le projet, en 1998, l’un de ceux qui l’a porté, Philippe, était au chômage, et on voulait qu’il puisse en vivre. Cela nous distingue d’autres librairies très politiques – à Lyon, par exemple, la Gryffe, un très beau projet, ne tient que sur des bénévoles ; le danger, c’est que les gens s’essoufflent forcément un peu à la longue.
Aujourd’hui, la librairie fonctionne sur deux emplois aidés à mi-temps, qui arrivent à terme, ainsi que sur l’investissement de deux bénévoles. Depuis le début, la librairie a tourné surtout grâce à des emplois aidés ; les choses se compliquent actuellement, notamment pour Jacques dont le poste, un CUI-CAE, est arrivé à échéance le 31 octobre.
Au départ, nous avions calculé qu’il nous fallait 30 000 euros – 200 000 francs de l’époque – pour ouvrir Quilombo. Nous avions donc lancé une souscription, récoltant finalement 4 000 euros. Beaucoup moins que ce dont nous pensions avoir besoin.
Bref, on a ouvert avec très peu d’argent. Et les copains, les aides, les coups de main se sont révélés essentiels pour nous permettre de tenir. C’est la magie du système D : nous avons mis la main à la pâte, nous avons fabriqué les meubles, nous nous sommes contenté d’un éclairage au néon tout pourri pendant très longtemps et nous avons au départ fonctionné en dépôt avec les éditeurs. Tout ça s’est finalement construit très progressivement ; nous avons par exemple mis trois-quatre ans à ouvrir des comptes chez les diffuseurs. Au final, il nous a fallu dix ans pour avoir un lieu agréable et dans lequel on se sente bien. »
Quilombo sort chaque année un catalogue fourni et détaillé[[La version 2011 de ce catalogue est à télécharger ICI.catalogue_2011_flash_bd‑2.pdf]], qui est un excellent outil militant…
« Il représente pour nous un gros boulot : le catalogue fait 80 pages et compte autour de mille références. Nous commençons à bosser dessus en juin et il sort en novembre. C’est du travail, mais cela relève aussi de notre quotidien de libraires, notamment quand il s’agit de repérer les sorties chez tel ou tel éditeur. Dans le cas des petits distributeurs, c’est beaucoup plus facile ; nous sommes par exemple habitués à travailler avec Les Belles Lettres, ils nous connaissent bien et on les connaît bien. Chez les gros distributeurs, c’est plus délicat : c’est à nous de surveiller leur catalogue et de sélectionner les ouvrages qui auront leur place dans notre librairie. Une fois le travail de repérage mené à terme, nous effectuons un choix ; il est alors temps de s’atteler à la rédaction des présentations qui seront insérées dans le catalogue.
Ce projet s’est construit progressivement. L’idée au départ était de faire un catalogue de vente par correspondance. Mais quand nous avons commencé à l’étoffer, nous nous sommes rendus compte que cela allait bien au-delà de l’aspect commercial. Aujourd’hui, il s’agit de présenter une bibliographie – assez large mais pas exhaustive – de ce qui est paru sur l’année écoulée en matière de critique sociale et politique, à la fois chez des gros et des petits éditeurs. Dans le même temps, nous conservons dans le catalogue les bouquins de référence pour quelqu’un s’intéressant à un thème en particulier, par exemple l’histoire du mouvement libertaire, la Commune de Paris ou la Révolution espagnole. Il s’agit au final d’un mélange de nouveautés et de classiques. Chaque année, nous renouvelons un tiers des entrées.
Nous ne lisons évidement pas tous les ouvrages en question, nous ne poussons pas le stakhanovisme jusque-là. Mais nous les connaissons tous d’une certaine manière. Nous arrivons à peu près à les situer, nous en connaissons le thème, le point de vue, l’auteur, l’éditeur… bref, nous savons où nous mettons les pieds.
C’est d’ailleurs quelque chose qu’on a toujours eu en tête au cours de ces dix ans : le rôle de l’éditeur. Nous accordons une grande confiance à certaines maisons. Nous nous reposons donc sur un certain nombre d’éditeurs que nous allons suivre, parce que nous considérons qu’ils font un travail de qualité ; a contrario, il y a d’autres éditeurs dont on estime qu’ils ne font pas toujours ce travail de sélection de manière rigoureuse. Ce rapport de confiance établi avec certaines maisons s’est concrétisé par une rubrique qu’on a lancé sur notre site : « l’éditeur du mois » – qui est en fait plutôt l’éditeur du trimestre, vu qu’on est souvent débordés [rires]. On le choisit, on le contacte et on lui envoie un questionnaire qui va nous servir à rédiger un texte de présentation sur lui, sa maison, les parutions, sa ligne éditoriale, etc. On publie le texte en question sur le site et on met cet éditeur à l’honneur dans la librairie, avec une table réservée à ses publications. Enfin, on organise un apéro avec lui – même s’il faut avouer que ces rendez-vous n’ont pas toujours un grand succès et ne mobilisent pas des masses les lecteurs. »
Ces rendez-vous, les débats organisés, les apéros… C’est important pour votre survie, non ? Cela vous différencie justement des lieux sans âme ou de la vente en ligne…
« Bien sûr. Mais cela n’a rien d’extraordinaire : une grande partie des libraires sont désormais dans le même cas. À part les très grosses échoppes, tous les libraires indépendantes sont désormais obligés de faire « vivre » un lieu. C’est une très bonne chose, parce que c’est aussi la vocation de la librairie, mais il faut en avoir la force : c’est épuisant. Pour compenser les baisses de ventes, de plus en plus de libraires ferment ainsi plus tard et ouvrent le dimanche ; et ils sont obligés de multiplier les activités pour faire venir les gens. Aujourd’hui, le libraire indépendant qui se contente de faire ses heures et de ne rien organiser ne peut plus s’en tirer.
De toute façon, et indépendamment de la situation des autres librairies, il nous semblait évident d’animer le lieu en mettant en place des débats ou des projections de films, puisque nous étions militants et politiques. Depuis notre création, nous en organisons environ un toutes les trois semaines, et ils ont parfois un certain succès : quand Howard Zinn est venu, il y avait de 150 à 200 personnes[Article11 avait effectué un compte-rendu de cette intervention d’Howard Zinn ; il est à [lire ICI.]] ; un débat « moyen » rassemble de 50 à 80 personnes, dont une bonne part de fidèles.
Enfin, nous organisons aussi des expositions – nous devons en être à la cinquième ou sixième. La première s’est tenue autour du livre Marge(s), paru chez Libertalia. Nous avons ensuite fait quelque chose avec Le Passager Clandestin autour du travail photographique de Rogerio Ferrari sur les Sahraouis. Il y a eu ensuite un retour sur le travail de Jean-Marc Dumont, avec les Bracolleurs, puis une exposition autour du film « Tous au Larzac ». Et enfin, place à Formes Vives, que vous connaissez bien et qui expose en ce moment une sélection de ses travaux – le vernissage est prévu pour le 6 décembre[[Les copains de Formes Vives en parlent dans ce billet ; les bougres font les choses bien, ils ont même sorti un flyer pour l’occasion : ]]. Cela permet aussi de faire vivre le lieu, d’attirer des gens qui sont davantage séduits par le côté graphique et n’ont pas forcément l’habitude de se rendre dans des lieux politiques militants. Encore cette logique d’ouverture. »
]]. Cela permet aussi de faire vivre le lieu, d’attirer des gens qui sont davantage séduits par le côté graphique et n’ont pas forcément l’habitude de se rendre dans des lieux politiques militants. Encore cette logique d’ouverture. »

Les librairies politiques ou indépendantes sont-elles confrontées aujourd’hui à de grosses difficultés ?
« Beaucoup de librairies ferment en ce moment – une quarantaine ont tiré le rideau l’année dernière – mais d’autres ouvrent – plus ou moins une trentaine l’an passé. Le truc, c’est que celles qui ferment sont les librairies de taille moyenne, tandis que ce sont de plus petites structures qui ouvrent. C’est une logique propre au capitalisme : il y a de la place pour des structures gigantesques, type Amazon ou Google, et pour des niches – affinitaires, groupusculaires, etc… Mais les structures qui sont très largement malmenées – à tous les niveaux, au-delà de la librairie – sont celles de taille moyenne.
Les travailleurs indépendants peuvent actuellement réussir à s’en sortir, les multinationales aussi, mais les PME-PMI souffrent largement. Le problème, c’est qu’une société dans laquelle on peut s’épanouir, vivre de façon agréable, doit essentiellement compter des structures de taille moyenne. Or, ce sont justement celles-ci qui se retrouvent fragilisées. Cela vaut aussi pour les librairies – il faut d’ailleurs noter que les grosses chaînes types Fnac, si elles vont moins bien, tentent de se repositionner aujourd’hui sur la vente de tablettes, de matériel informatique et de contenus numériques.
Dans ce mouvement d’ouvertures-fermetures, il faut aussi souligner qu’un certain nombre de librairies ont ouvert en banlieue ces dix dernières années. Ainsi que dans des villages. C’est une bonne nouvelle, évidement. Mais les gens qui s’en occupent sont souvent dans des situations très précaires et passent par les emplois aidés ; bref, ils ne vont malheureusement pas tous réussir à tenir, il faudra faire un bilan dans quelques années.
Dans le même esprit, notons que le milieu libertaire se montre très dynamique : ces dernières années, beaucoup de lieux dédiés au livre ont ouvert, des infokiosques, des bibliothèques, et les salons du livre libertaire ou indépendant se sont multipliés. C’est bien évidemment un phénomène intéressant, même s’il faut se poser la question de la niche et du ghetto : est-ce que les gens qui lancent ces lieux sont dans une perspective d’ouverture vers un quartier ou vers un village, ou bien s’adressent-ils surtout à un petit noyau militant ?
Dans tous les cas, cela s’inscrit dans un mouvement plus large. Celui d’un net regain politique ou militant par rapport aux années 1980 et 1990, qui ont quand même été assez difficiles. A l’orée des années 2000, en parallèle à l’essor du mouvement altermondialiste, s’est affirmé un net intérêt pour les littératures critiques. On a même vu les gros éditeurs s’emparer de ces thématiques – les éditions Mille et une Nuits ont créé leur collection autour d’Attac, Fayard a publié nombre de bouquins altermondialistes… Bref, un dynamisme certain. Dans lequel se sont engouffrés un certain nombre de gens aimant les livres, qui ont créé leurs structures et maisons d’édition. D’une certaine manière, Quilombo fait partie de cette vague.
Cette dernière commence à la fin des années 1990 – entre autres avec la création des éditions Agone, en 1998. Quand nous avons ouvert Quilombo, il y avait d’ailleurs deux éditeurs qui se vendaient très bien et que les gens nous demandaient en permanence : Agone et l’Insomniaque. Au fil des années, de nouvelles maisons sont alors apparues : Aden, L’Échappée en 2005, Libertalia, Les Prairies Ordinaires, Amsterdam, etc… Parmi celles-ci, certaines ont choisi des distributeurs compétents, ce qui a permis à leurs livres d’être présents dans des librairies plus traditionnelles. Ça a changé pas mal de choses. Il y a quinze ans, les Parisiens devaient aller à Publico, la librairie anarchiste, pour dénicher des livres engagés introuvables ailleurs ; aujourd’hui, la plupart de ces ouvrages sont disponibles chez tous les libraires indépendants. Ces éditeurs sont à l’évidence mieux diffusés et sont beaucoup plus présents. »
Ce dynamisme des années 2000 s’est-il essoufflé ?
« Il a au moins évolué. Ces derniers temps s’est par exemple faite jour une dynamique autour des revues ; la presse militante a évolué, votre version papier en est une illustration, tout autant que Z, Offensive, CQFD. La presse militante s’est ainsi largement améliorée. Pour un temps, du moins, puisque nous nous trouvons peut-être déjà à la fin de ce cycle : au niveau de la presse, on sent que ça fatigue, les gens qui y participent disent un peu partout que c’est dur. Article11 est en pause prolongée, CQFD tire de plus en plus la langue, Z paraît épisodiquement. Reste Offensive, qui ne marche pas trop mal.
Côté édition, par contre, il n’y a pas eu grand-chose ces derniers temps. Entremonde est sans doute la maison la plus récente et a l’air très sérieuse. Mais les éditeurs qui se sont lancés au cours des années 2000 ne se portent pour la plupart pas très bien ; la situation est délicate. Et même les maisons qui s’en tiraient le mieux souffrent.
Se pose enfin la question du livre numérique. Avec un réel manque de résistance et de discours critique au regard des enjeux. Pour les grandes enseignes, qui sont dans une logique d’industrialisation, c’est finalement normal : elles basculent toujours dans le sens du vent. De même pour certaines grosses librairies – par exemple, Dialogue à Brest – qui s’éloignent de plus en plus de leur métier originel pour devenir de vraies entreprises ; elles aussi prennent le train du numérique et comptent se positionner dans ce secteur. Elles pensent aller dans le sens de l’innovation et y voient une source de profits.
Enfin, un certain nombre de libraires, dubitatifs au départ, ont fait l’autruche, tablant sur l’idée que le numérique allait mettre des dizaines d’années à s’installer et se berçant de l’illusion qu’il n’y avait pas d’inquiétude à avoir. C’était complétement négliger les forces en présence : les grands de l’internet, Google et Amazon notamment, et les autres géants de l’électronique rêvent de faire passer tout le monde sur tablette. Ils en ont les moyens, à la fois opérationnels et financiers.
Dans le monde, le mouvement a été très rapide ; en France, pour ces thuriféraires, cela ne va pas assez vite, d’où la multiplication des discours à la « la France est en retard sur le numérique ». Et certains de ces libraires qui ont fait l’autruche se réveillent aujourd’hui, se disant qu’ils vont vendre des tablettes et des fichiers pour compléter leurs revenus.
Sur ce point, nous nous plaçons évidemment dans une culture de résistance ; d’ailleurs, Quilombo participe au collectif Livres de Papier qui regroupe des professionnels du livre (éditeurs, libraires, correcteurs, graphistes, bibliothécaire…) réfractaires au nouvel ordre numérique7. On nous dit, à propos du numérique : « C’est le sens de l’histoire. » Peut-être qu’en effet, c’est là que l’histoire va aller. Sauf que l’histoire est impulsée par des forces politiques, économiques et idéologiques auxquelles nous comptons bien nous opposer. Nous n’avons pas l’intention de nous adapter au monde que leurs laboratoires nous préparent ! »
*
En rapport sur Article11
De la nécessité du Livre… et des Libraires — Escale à Sarrant
Raphaël (éditions Agone) : « Il vaut mieux prendre le temps »
Notes

