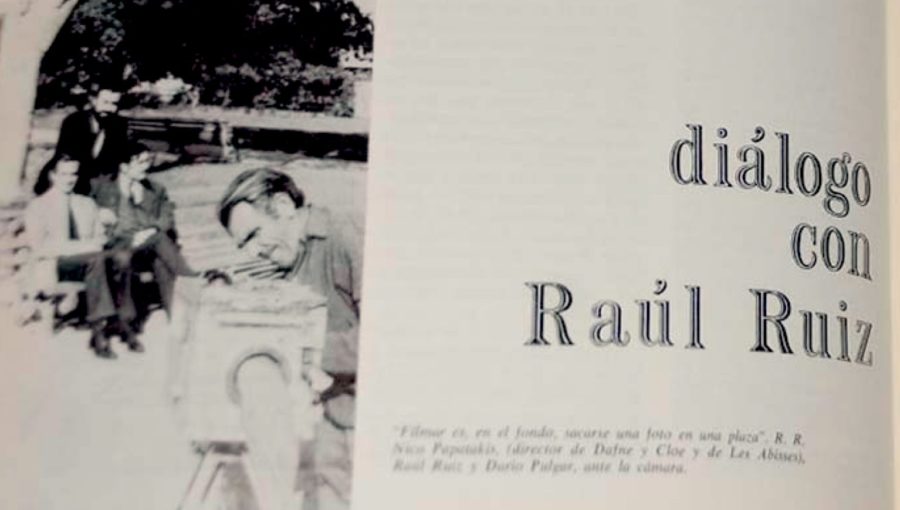Culture et subculture dans le cinéma
Transcription d’une conversation entre Enrique Lihn, Federico Schopf [poète et essayiste chilien né en 1940.] et Raul Ruiz. Dans ce dialogue, les auteurs discutent à propos du concept d’engagement dans les arts et plus particulièrement dans le cinéma et la culture du sous-développement à partir des commentaires sur le film de Saul Landau Fidel et El Chacal Nahueltoro, Miguel Littin. Concernant Littin, l’article traite de la controverse qui est généré entre les concepts de culture et subculture dans ce film, le questionnement, tandis que, par le dialogue Lihn, Schopf et Ruiz posent les différents thèses au sujet du film.
« Filmer c’est, au fond, se faire prendre une photo sur une place. » R.R.
LIHN : Je vais te proposer d’aborder trois thèmes, d’abord de parler du film Fidel de Saul Landau, puis, à propos de ton travail avec lui, et finalement j’aimerais connaître ton opinion sur Le Chacal Nahueltoro.
RUIZ : Je vais d’abord te dire quelque chose de Fidel. J’ai eu trop d’infos avant de le voir, Darío Pulgar, qui a travaillé dessus, m’a raconté toutes sortes d’histoires de coulisses et à part ça, j’ai eu quelques préjugés contre ce genre de prophète du nouveau cinéma, qui est la caméra du cinéma direct. En théorie, ce genre de film devrait être une seule prise qui dure du début jusqu’à la fin du film, rien de plus qu’une projection de l’idéal de Sabatini : un film qui suit un homme toute une journée où qu’il aille, sans raconter rien de spécial. Je pense que le cinéma direct aujourd’hui présente, au moins deux graves problèmes. Il a tendance à tomber tôt ou tard, dans la “play within the play” : celui qui est filmé doit faire allusion au fait qu’il est filmé, et à celui qui le filme, au fait qu’il s’agit d’un film et que ce film traite, aussi, de quelqu’un qui est en train de le tourner, et ainsi de suite. Il y a un jeu de miroirs, la constatation mélancolique que la réalité est difficile à pénétrer et à transcrire.
LIHN : Et crois-tu que Saul Landau as pu surmonter ces limitations du cinéma direct ?
RUIZ : Je pense qu’il a eu le bon sens de se référer à tout moment au fait qu’il tournait un film sur Fidel Castro, où il s’agissait de montrer le rôle qu’il remplit au sein de la révolution cubaine et de le clarifier autant que possible avec ce film.
Je disais qu’il y a deux limites du cinéma direct, l’autre étant spécifiquement cinématographique, il te limite quant à la construction du langage cinéma. Autrement dit, le travail cinématographique mène à la possibilité de créer des idéogrammes, de telle sorte que les éléments contenus dans un cadre se renvoient les uns aux autres et ont tendance à une certaine abstraction progressive. Ainsi, des images très concrètes expriment, prises dans leur ensemble, des idées abstraites. Le cinéma direct comme postulat nie cette possibilité qui me semble précieuse.
LIHN : Pourrais-tu illustrer en ce qui concerne le film de Landau, comment dans celui-ci cette possibilité n’est pas résolue ?
RUIZ : Je ne pense pas que Landau se soit posé ce problème. Comme un bon gringo, il est très pragmatique. Il a vu quelque chose à Cuba en relation avec la figure de Fidel, et il s’est limité à le montrer et à le clarifier.
Revenant à l’idée d’Eisenstein, vous mettez sans aucune explication un bol de soupe et un visage. Celui qui voit cela tend à voir une relation entre les deux puisqu’ils sont juxtaposés. L’idée est que cette relation est plus abstraite que les éléments eux-mêmes. Un spectateur dit : ce type est affamé, il invente une anecdote, il crée une histoire. Dans le pire des cas, il dit : un homme regarde la soupe ou bien un homme est proche d’un bol de soupe. En tout cas, c’est plus abstrait que ces deux images en elles-mêmes. L’idée d’Eisenstein était que cette première abstraction, dans un film plus long augmente progressivement, ce qui permet la possibilité de créer un langage capable d’expliquer et de développer, par exemple les idées du Capital et être en même temps universel et dépasser toutes les limites de la langue parlée.
Opposé à cette conception du cinéma il y a l’idée que celui-ci est comme une fenêtre, qui montre des choses et plus encore, c’est-à-dire qu’il ne montrera que le fragment d’un événement, ce qui implique un cinéma qui ne se divise pas en idéogrammes, mais plutôt en événements, toujours — par la nature même du cinéma — forcément incomplets.
Contre l’intention d’Eisenstein de travailler le cinéma en tant que langage, le néoréalisme a compris que les choses doivent parler d’elle-même et que le cinéma devait être fidèle à l’événement. Sous cet angle, le cinéaste, s’il reste fidèle aux événements, il n’a rien à dire sur eux, il doit se limiter à les transcrire. Ceci est la base fondamentale du cinéma direct, un cinéma comme un art total que, puisque son ambition est de dupliquer le monde.
Ces différentes façons de voir le cinéma coexistent toujours : comme un dédoublement du monde, comme un art d’intégration totale de tous les arts en tant que langage, en tant que spécificité. Le problème est de ne pas confondre les différents niveaux.
Landau as beaucoup utilisé la technique du cinéma direct et dans le montage même il a pu surpasser ces limites. Il fait un cinéma qui montre des faits très concrets, des événements qui sont expliqués. Il crée un langage qui au lieu d’être un ensemble de signes est un ensemble d’événements, cet ensemble présente une structure fermée, qui à son tour est le film. Cette structure n’est pas un modèle de Cuba, mais représente un point de vue sur la révolution cubaine. Les événements, qui se signifient les uns aux autres comme des signes, sont coincés les uns avec les autres, formant une structure très solide.
Dans Fidel, je vois dans toute la première partie l’exaltation du leader. Dans la deuxième partie, les événements montrent la persistance du sous-développement à Cuba, et dans la troisième partie, après t’avoir déprimé avec le second, il te propose la signification de la lutte.
Landau a travaillé avec Wright Mills à Cuba, il a été son secrétaire et ensembles, ils ont parcouru l’Union soviétique dans les six derniers mois de la vie de W.M. Il se réfère même à Saul Landau dans « Listen, Yankee : The Revolution in Cuba » et les « The Marxists ». Grâce à W.M., je crois que Landau est resté obsédé par l’idée de ce que signifie l’empire et le sous-développement.
Le film Fidel a été tourné dans sa première version d’une heure pour la chaîne culturelle de San-Francisco, qui se dédie, disons, à faire des reportages sensationnels. Avec ces matériaux, Landau a produit la version finale. J’ai rencontré Landau l’année dernière au Festival de Viña del Mar, et il a vu mon film Trois tristes tigres [[Premier Long-métrage de Raul Ruiz (1968) 1h 45min.]] une série de symptômes très clarifié du sous-développement, l’exemplification de ce qui est proposé en théorie dans Mémoires du sous-développement, un film qu’il admire beaucoup.
Comme je vis dans le sous-développement, je n’ai pas assez de recul pour savoir si cela est effectif. Je crois que Landau a même discuté avec Fidel Castro sur l’idée de tourner un film sur un pays en développement et il semble même que le Chili avait été spécifié. Pour utiliser une formule : un pays qui ne sois pas le Vietnam de service, où la lutte donnée soit à un niveau plus quotidien, de sorte que les éléments du sous-développement ne soient pas si évidentes, mais un peu plus allusif.
Nous travaillons [Que Hacer ? — Saul Landau, Raul Ruiz, Nina Serrano, 1970 — 90 minutes] avec un thème très ouvert. Un personnage américain, un “Peace Corp” style Kennedy, un promoteur du plan laboral du genre Alliance pour le progrès, même renforcé par l’idée que les conservateurs ont fait échouer la politique de l’Alliance, et d’autre part, un Chilien qui arrive à Cuba afin de participer à la révolution après avoir été marginalisé chez lui et où il ressent le besoin de retourner pour se joindre au combat. Cet enchevêtrement de voyages sentimentaux devrait nous donner une sorte d’autoportrait du Chili, dans une perspective du sous-développement.
Pour faire le film nous utilisons des éléments du cinéma direct. Par exemple, des acteurs de délibération qui travaillent principalement sur base d’improvisations avec des vrais protagonistes. Nous nous en tiendrons aux faits, la situation actuelle au Chili fera que l’intrigue du film varie de jour en jour. Un coup d’État nous ferait changer l’argument, et qui changerait dans un autre sens, si Allende sortait. En dehors de cela, le film est construit comme un dialogue entre deux équipes de tournage. Landau s’occupe de l’équipe américaine et moi de la Chilienne. Il filmera certaines situations de son point de vue avec ce personnage nord-américain et moi, l’univers des personnages que plus ou moins je sais gérer, ce sous-monde, ce temps mort du sous-développement. J’apporte le temps mort. Quant au montage, nous n’utiliserons pas nos voix, mais celle de commentateurs qui précisent nos positions et disent : « Ceci as réussi, ça non, mettons ces éléments ou bien ceux-là ». Et à part ça il y a le niveau des chansons.
À propos du film El chacal de Nahueltoro [[El chacal de Nahueltoro. Écrit et réalisé par Miguel Littin en 1969. Inspiré d’un fait réel, le film retrace l’histoire de José del Carmen Valenzuela Torres, accusé de meurtre. Le paysan analphabète a en effet assassiné en état d’ébriété la femme qui partageait sa vie, et les enfants de celle-ci. À travers son procès, apparaissent l’enfance, le quotidien, la marginalisation sociale du Chacal qui découvre en prison la possibilité de vivre autrement.]]
Je crois que Le Chacal illustre certaines idées que nous avons soulevés dernièrement, avec mon équipe de travail. Les préoccupations que soulève Littin de manière plus ou moins intuitive sont précieuses. Son problème est peut-être de ne pas les amener à ses conséquences ultimes, de poursuivre l’idée de faire des films en 35 mm, d’un certain format et pour un certain public. La dualité des propos lui rendent difficile le succès dans son travail. Le terrain choisi est non seulement très riche, mais un domaine clé pour faire du cinéma. Mais ce n’est pas possible avec les formats existants, ce cinéma doit être travaillé entièrement en dehors de la chaîne de distribution commerciale.
Par ailleurs, Littin a exprimé dans ses déclarations qu’il avait senti l’existence d’une culture différente de la culture officielle, de personnes ayant une autre échelle de valeurs, ce qui est précieux pour notre travail dans le cinéma.
LIHN : ¿La sous-culture ?
RUIZ : Nos préoccupations portent principalement sur la tentative d’essayer de contourner les limites de la notion de sous-culture. Il faudrait éliminer la partie ‘sous’, et, bien sûr, la partie ‘culture’.
LIHN : Est-ce que Littin réussi‑t’il à intégrer officiellement les différents éléments de cette culture ?
RUIZ : Il ne gère pas le sens des règles du jeu. Notre idée, en bref, est qu’il existe une culture de résistance, entendu comme des choses aussi fondamentales que d’apprendre à lire, et ainsi de suite. Dans certains domaines, il y a une agression qui provoque une résistance, qui se manifeste par une grande capacité à oublier : celui du militaire, par exemple, qui apprend à lire dans l’armée. Tout d’abord, le rejet ou la résistance à l’agression culturelle, puis, une assimilation d’elle-même comme la meilleure forme de défense ou de camouflage. Autrement dit, un rejet progressif fausse tous les éléments de la culture, mais pas d’une manière suffisamment forte comme pour que les autres le remarquent. Il en résulte une sorte de vie culturelle parallèle. En concluant qu’il existe cette gradualité, vous vous rendez compte qu’il y a un refus, mais en même temps, toute une manière de s’assimiler qu’il fait possible que ces gens (chacun d’entre nous à un degré différent en dernière instance) puissent vivre simultanément à l’intérieur et en dehors de la culture. Alors, ce n’est pas de la sous-culture, mais la culture qui devient la résistance. Cela ne fournit pas des valeurs contre les autres, c’est l’ensemble des techniques conçues pour résister à l’agression culturelle.
LIHN : Et cette résistance est résolue dans une distorsion des éléments culturels assimilés.
RUIZ : Oui, c’est la technique la plus évidente, la parodie, la parodie de la parodie. Littin a vu une culture différente de la culture officielle, mais il a simplement appliqué l’idée de sous-culture. S’il avait été un peu plus loin, il aurait compris que son personnage a été dompté en apprenant à lire et à écrire, il a agi comme la grande majorité des Chiliens qui subissent cette agression culturelle, en l’acceptant et en la rejetant, en l’intégrant et en repoussant la culture officielle. S’il avait saisi la cohérence de cette attitude, il ne se serait pas égaré dans la méconnaissance du caractère du chacal. Cela est premièrement, condamnable, et d’autre part, il inspire de la pitié, et vous avez à choisir entre ces deux possibilités : soit vous le répudiez et vous vous dites que c’est bien qu’il soit tué, ou bien il inspire de la pitié et vous vous dites que c’est mal de le tuer. Littin a hésité entre ces deux possibilités. Je pense qu’il a d’abord commencé par une métaphore, celui d’un être en marge d’une culture comprise, a priori, comme bonne. La métaphore d’une personne d’un niveau animal, l’auteur d’une aberration qui attire l’attention de tout le pays, cette personne est intégrée au milieu pour lui faire comprendre quelle est l’ampleur du crime qu’il a commis, et pour faire affirmer la civilisation qui l’avait précédemment rejeté. Au moment où il accepte l’ampleur de son crime, il devient un être humain sacrifiée — et il y a là une dualité critiquable.
LIHN : Mais il devient un être humain selon les directives d’une culture officielle que le film met question, non ?
RUIZ : C’est le problème du travail sur le terrain. Tout en travaillant là-bas, Littin a constaté que les faits modifiaient la métaphore. Ils ont noté que le type ne s’était jamais vraiment intégré complètement, et que la culture à laquelle il avait été assimilé était critiquable de tous les points de vue, un monde rejeté non seulement par lui sinon en puissance par le spectateur, puis il a cherché à intégrer ces données qui contredisaient le schéma précédent. Le résultat fut la superposition de deux films : d’un côté, la métaphore, et de l’autre, le document. Je pense qu’il n’est pas parvenu à les intégrer parce qu’il n’a pas eu d’approche au problème de la culture en termes réels. Il n’a pas réussi à surmonter la séparation entre culture et sous-culture, c’est l’opposition commune entre la culture autochtone et la pénétration culturelle, tout ce qui est limité à ces schémas.
D’une part, il faudrait créer une crise une série de concepts qui semblent très clairs, et qui ne le sont pas vraiment, c’est-à-dire l’idée de la culture et de la sous-culture. D’autre part, le travail de terrain est plus méthodique. Très peu de choses pouvaient se faire dans les conditions dans laquelle à travaillé Littin avec une caméra sans son direct, avec un budget très restreint et sans l’intention ou la capacité de rester plus longtemps sur le terrain.
SCHOPF : On peut se demander quelle est la thèse générale du film : que la société introduit des personnages dans ses structures afin de les condamner en réponse à eux-mêmes ? Le Chacal opère comme un symbole de cette contradiction monstrueuse, par lequel la société juge certains criminels qu’il a lui-même créé. Ma question est de savoir si ou non les images illustrent cette thèse ?
RUIZ : Non, cette métaphore a été soulevée et les faits ont été modifiés ; en les intégrant ces modifications au modèle, le film s’est dispersé car il conservait les modèles primitifs.
SCHOPF : Maintenant, je dirais que ce que Raul Ruiz s’est proposé, à notre connaissance, ce n’est pas l’exact opposé de ce qui est proposé dans ce film. Ce que Ruiz nie c’est le point de vue à partir d’où le film a été exécuté, et qui consiste à ajuster les images pour certains concepts. Cela consiste à utiliser le monde des perceptions comme la vérification de certaines affirmations à l’égard non seulement de la vie en général, mais le monde des images. La thèse de Raul est que le monde des images dépasse l’ensemble des concepts qui définissent habituellement le champ visuel et, d’autre part, ce monde prétend avoir des vertus de conscience par rapport aux images et les mobilise en une sorte de réseau conceptuel qui tendrait enfin arrêter l’histoire au détriment de l’histoire, accumulant une série de répression latérale. C’est justement ce qu’il voudrait essayer de montrer.
Nous avons donc, le rejet du système de concepts avec lequel on tente habituellement de comprendre le domaine de la vie et, deuxièmement, d’admettre que les images de cette vie il y a des excès par rapport aux concepts, qui au moment d’être exposées cinématographiquement, nous montrer la fausseté et le caractère de distorsion des concepts relatifs à la vie et les images de cette vie.
LIHN : Dans ce que Schopf dit, il y a une exagération qui illumine le problème, mais dans le même temps, le dépasse et l’affaiblit, car il ne s’agit pas simplement de réfuter chaque vision conceptuelle pour le bénéfice d’une libération complète de l’image. Ce que nous dit Raul, c’est qu’il tente de mettre dans son propre code ou formaliser par les éléments du langage cinématographique les éléments de la sous-culture. Il cible une zone en conflit configuré par le rejet d’une culture officielle, et la volonté de récupérer, je suppose les valeurs qui bougent derrière cette attitude de rejet.
SCHOPF : Je ne dis pas qu’à partir de ce que les images montrent dans le cinéma que Raul prétend faire qu’on ne peut pas remplacer une déclaration sur la réalité de l’autre. Les images ne conduiront pas à une catastrophe perceptive, mais plutôt l’inverse. Je pense être d’accord avec Ruiz sur la libération des philosophies et des idéologies dominantes à l’égard de ce domaine de la vie et les images conduisent nécessairement à la démonstration de l’excès de sens par rapport à ces idéologies qu’il y a dans la vie même. C’est le sens que Ruiz veut montrer et dénommer cinématographiquement. L’excès de sens qui est, d’abord, la démonstration du grand refus dans les gestes et les actes de la vie quotidienne par rapport aux idéologies répressives. L’excès de sens qui conduirait à la proposition d’une autre manière, un autre raccordement entre le concept et l’image, la théorie et la praxis.
CINEMA ET POLITIQUE
RUIZ : Je ne comprends pas très bien l’expression de cinéma politique, à ce propos, je me souviens de certaines classifications : le cinéma direct, le cinéma-pamphlet, le cinéma idéologique à la manière de La hora de los hornos [[La hora de los hornos (1968, 3h10, L’heure des brasiers) de Fernando Solanas et Octavio Getino, membres du groupe Cine-Liberación. 200 heures d’entretiens enregistrés durant deux années, pour aboutir à un documentaire en trois volets : “Néocolonialisme et violence”; “Acte pour la libération”, divis à la fois en deux grands moments “Chronique du péronisme (1945 – 1955)” et “Chronique de la résistance (1955 – 1966)”; “violence et libération”.]], et le cinéma utopique, à partir de faits réels, conforme l’espoir d’un peuple. Ce que je fais, c’est du cinéma politique dans un autre sens. Pour moi, faire un film est un acte politique, je suis contre l’idée du cinéaste comme un employeur, ou contre l’idée de Godard que chacun doit pouvoir faire des films et qu’ils devraient êtres conçus dans les assemblées générales. Ce parlementarisme est très stérile, car à l’heure de placer une caméra, c’est Godard qui la place. Donc, les dix heures de discussion antérieures ont été inutiles. Je crois dans un film collectif sur un autre niveau, sur un niveau musculaire. Il s’agit d’élaborer un ensemble d’instincts, des comportements qui conduisent à travailler ensemble comme une sorte d’orchestre du cinéma, dans lequel vous jouez une partie tout en écoutant simultanément. Mais à part ça, l’opportunité de mettre en lumière — surtout dans le cas du Chili — la culture de la résistance m’enthousiasme.
Mon idée est que les techniques de résistance culturelle forment un langage non-verbal dont la seule possibilité de les formaliser et de les élever à un niveau idéologique — j’utilise ce mot avec beaucoup de réserve –, c’est à travers le cinéma. Ces techniques décantées, se commentent entre elles, elles forment un tout, plus que des syntagmes, des stylistiques. De l’art à mi-chemin. L’art de boire un verre, de dire santé, de l’abnégation, enfin. Ces stylistiques peuvent seulement être enregistrées par le cinéma, ils résistent à être décrit car ils ne sont pas verbales, c’est un langage non verbal. Cette culture existe, nous existons et existe aussi l’acte de filmer qui nous unit avec cette culture. En ce sens, l’acte de prise de vue, pour moi, est un acte politique. Filmer est un pont, un contact très fort à travers des gestes aussi vieux que de se prendre en photo sur une place. Filmer c’est, au fond, se faire prendre une photo sur une place.
LIHN : Naturellement, ça conditionne la façon de filmer, non ?
RUIZ : Bien sûr que oui. Cela implique une première conséquence : nous devons créer un climat dans lequel filmer soit possible, pour que les stylistiques puissent venir à la surface. Ensuite, cela implique une idée différente de la mise en scène, qui vous fait changer radicalement la structure des choses. La formule est assez simple. On travaille sur la base d’un premier modèle, un ensemble d’opinions ou des choses que nous avons imaginées, après avoir choisi un lieu et une situation générale, nous faisons ce que l’on appelle une histoire. Ce modèle précédent, renforcée et enrichie, nous l’amenons sur le terrain où les choses commencent à nous arriver pour la première fois. Nous commençons à enquêter et il y a un autre type de situations qui se produisent qui confirment le modèle précédent ou le modifient, ou remettent en question la structure. Ces trois types de situations nous conduisent à rejeter, à mettre en œuvre ou à le modifier. Il s’agit d’éviter cette tentation et de maintenir chacune des observations à se tenir à ce qu’ils sont, de simples observations, jusqu’à ce qu’ils prennent corps. Lorsque le nombre et l’ampleur de ces observations tendent de leur propre poids à se séparer du modèle original pour en former un autre…
Et voici l’acte de bravoure : ce nouveau modèle qui surgit naturellement de l’observation s’oppose au premier modèle, c’est-à-dire que le premier n’est pas écarté. Les deux sont utilisés comme des pôles opposés et les événements progressent dans la mesure où, régulièrement espacés plus ou moins équidistants, créent une tension entre ces deux modèles. Les modèles ne sont pas un film A et un film B, mais des schémas qui sont en dehors du film. Ce dernier est au milieu des événements mis en tension entre les deux modèles. Cela pour parler de structure dramatique. Puis il y a le problème de la mise en images. Travailler plus comme le photographe d’une place qu’un paparazzi. Établir des relations entre le cameraman et les acteurs, essayer un certain type de film en vers, disons.
Pour donner un exemple dans cette pièce il y a un espace créé naturellement par le déplacement quotidien des gens. Ces lignes sont compilées et de cette compilation tu sors une série de mouvements de caméra, mais tu ne les appliques pas dans la zone dans laquelle ces déplacements se produisent et tu ne respecte pas son ampleur. Tu l’utilises de n’importe où dans la pièce et tu construis une situation qui se produit dans toute la pièce. Supposons qu’il y a sept mouvements de caméra, avec n’importe quelle lampe tu commences à bouger la caméra selon les sept mouvements, lorsque tu arrives au septième, tu recommences, et ainsi de suite, en faisant entrer dans cet espèce de moule, de manière forcé, des événements qui nécessairement sont transgressés. C’est ce que je veux dire par travailler un film en vers.
LIHN : Le langage cinématographique que tu martèles semble vouloir éliminer le récepteur, les signes d’attention dirigée vers le spectateur, ça me rappelle une approche surréaliste par rapport au langage, quand ils disaient que c’était erroné de le considérer comme un outil de communication. Cela servirait plutôt à sonder certaines zones de la réalité, difficile d’accès, et aussi pour une utilisation dans un sens négatif, de rejet du langage au sein même du langage. Les procédures techniques que tu as développé pour régistrer cette culture de rejet semble être si hermétique et dupliquer le rejet au niveau de la forme.
RUIZ : Autrement dit, la méthode est compatible avec le matériel qu’il prétend extraire. Le fait qu’il est destiné à aller au-delà du groupe dans lequel il va filmer, le rends plus cohérent. Finalement, cela a à voir avec les prophéties de Borges. Je m’en souviens d’une : dans le futur, chacun sera son propre Dante et son propre Shakespeare, personne ne va nous lasser à l’avenir avec de grandes visions. J’appelle cette attitude, la politique, parce qu’il s’agit de sortir l’intellectuel de son statut de privilégié et enlever à l’activité artistique le caractère de discipline, de science ou d’usine. Eh bien, encore une fois le surréalisme : l’art doit être fait par tous.
CINEMA DE RECHERCHE
RUIZ : Je vois dans le cinéma, actuellement, deux attitudes très claires. Tout d’abord, les films à thèse qui réfléchit sur la signification du cinéma, plus précisément celui de Godard soutenu par la revue Cahiers du Cinéma.
D’autre part, il y a une tendance à voir le film du point de vue de la découverte de situations nouvelles et uniques. Cette seconde approche a une limitation claire. Quelque part, Valéry parle du choc qui signifie que la mention “terra incognita” [[Documentaire « Mondo Cane » (Monde de chien) de Gualtiero Giacopetti, 1962.]] ai disparu des cartes, il n’y a plus de territoires à découvrir. Le cinéma a déjà découvert la terre, les principaux lieux ont été vus aussi par les cas les plus abjects, comme celui de Giacopetti, et les six ou sept dernières années avec l’émergence des premiers films du Tiers-Monde. Il y a alors, l’autre chemin.
Maintenant, pour proposer ma position de travail, je voudrais utiliser un autre schéma, qui se réfère à l’Amérique latine. Ici, je vois trois tendances clairement définies. D’une part, une sorte de cinéma citoyen, qui pose des problèmes concrets en Amérique latine, et montre les moyens de les résoudre. C’est le cas de La hora de los hornos [[L’heure des brasiers, de Fernando Solanas]]. Un film didactique. D’un autre côté je vois, en particulier au Brésil, un cinéma de la métaphore qui tend à créer des situations qui synthétisent ou bien fournissent la clé du pays. Et enfin, le type de films que nous essayons de faire, d’enquête, dans le sens de la recherche des clés nationales. Lorsque tu tourne une situation, tu la complètes, la résout. C’est l’idée du cinéma de recherche.
Notre travail a une histoire, mais dans le domaine de la sociologie et de l’anthropologie : le cinéma de Jean-Rouch, le Musée de l’Homme, le cinéma des Canadiens. Ce genre de cinéma n’oserait jamais inclure la fantaisie, de considérer l’art comme un jeu. Il y a l’idée de faire des choses sérieuses, ce qui dynamite finalement les chances de ce cinéma.
Je vais parler d’une expérience liée à ce genre de cinéma, je ne sais pas de qui elle est, ou pas exactement d’où. Un groupe de cinéastes est allé à un village de pêcheurs, ils ont pris un pêcheur et l’ont fait parler durant des jours. Le tournage a duré plusieurs jours. Puis tout ce matériel, sans aucun montage, a été montré dans le village de pêcheurs que le pêcheur a mentionné constamment. Les pêcheurs ont vu le film et le village a changé, bien que je ne sais pas dire quel genre de changement est survenu. En tout cas, c’était une tentative du cinéma d’influencer la réalité, en établissant un lien entre l’activité cinématographique et les faits réels, qui n’aurait pas eu lieu sans le cinéma.
LIHN : Au moment où vous utilisez le cinéma pour influencer le processus de la réalité, ne se pose‑t’il pas un problème éthique ? Comment et sur quelle base pourrait-il influencer ce qui se passe ?
RUIZ : Cela je me le proposerais après avoir fait des films durant un bon bout de temps, et en attendant, je ne suis pas sûr que j’influence vraiment.
LIHN : Mais est-ce que tu désirerais que ce genre de film soit résolu, par les acteurs-spectateurs, comme une prise de conscience.
RUIZ : Cette expression me fait un peu peur, généralement on se réfère à d’autres choses quand il s’agit de prise de conscience. Par ailleurs, il ne s’agit pas que les gens qui font certaines choses disent, “je fais cela”. Il s’agit que ces gestes deviennent des langages, réfléchissant, par eux-mêmes, à travers le cinéma qui pourrait les définir. J’ai le soupçon que la culture de résistance cache une grande capacité de subversion, et ne peut devenir telle qu’à travers le film terminé.
LIHN : Subversion dans quel sens ?
RUIZ : Dans le sens le plus Bretonnien [[André Breton (1896 – 1966), écrivain, poète et théoricien du surréalisme.]] du terme.
LIHN : Si vous aviez à mettre cela en subversion politique, contre qui tu l’aurais adressé ?
RUIZ : Il ne s’agit pas de le mettre en termes politiques.
LIHN : Tu travailles avec Landau…
RUIZ : Mais çà c’est autre chose. Nous rendons compte de notre militantisme et de notre manque de militantisme, c’est une sorte d’introspection idéologique de toute notre équipe. Savoir où nous en sommes, et essayer de le clarifier par la voie du cinéma, nous croyons que par la même activité cinématographique peut se produire en nous une entente, et cela est précieux.
JE SENS QUE LE MARXISME M’ECLAIRE UNE SERIE DE CHOSES
RUIZ : …et je ressens le besoin de militer dans le camp marxiste, je me sens marxiste, mais je n’ose pas dire que je le suis parce que je ne connais pas assez le marxisme. Mais il y a surtout un problème de jeux de mots dans les déclarations de principe que je n’aime pas. Je n’ai aucune raison de rejeter tout ce qui contribue et m’aide à interpréter la réalité dans laquelle je bouge. Ce qui est clair, c’est qu’un certain nombre de problèmes politiques ont émergés à partir de l’activité cinématographique.
SCHOPF : Je dirais que personne ne peut vivre, d’un point de vue de conscience continue, comme marxiste ou existentialiste. Pour ce faire, cette vision devrait devenir le sens commun d’une société et le marxisme est très loin de l’être, au moins à l’égard de notre société chilienne. Maintenant, je trouve que l’approche que Raul pose, avec les réponses quotidiennes, face à l’agression de la société capitaliste, peut coïncider naturellement avec la pensée marxiste et devrait même correspondre avec dans la mesure que la pensée est adaptée à la réalité. Ceci est notre espoir. C’est-à-dire qu’il se situe dans un point de vue primaire sur le choix des idéologies, sans forcément être en désaccord avec les propositions d’une certaine pensée, concrètement la pensée marxiste au sujet de notre société. Ce qui est décisif, il me semble, est que les gens ne développent pas leur vie à partir de la conscience. La chose importante est la postulation d’un système parfaitement cohérent, qui est antérieure à la construction consciente de ce système, qui, cependant, est présent dans chacun des gestes et des attitudes, des comportements irréfléchis des habitants de notre pays.
La présence de ce système se trouve, par exemple, dans les bureaux publics, nous devons comprendre qu’il y a une construction de clôtures qui vous permet d’arriver toujours en retard au boulot. Tout un système dans son ensemble le justifie, officiellement, qu’un employé d’un bureau public arrive toujours à dix au lieu d’arriver à neuf. Si le système officiel serait opérationnel, il apporterait une sorte de frustration. Par exemple, si un employé irait encaisser un chèque et le chèque serait prêt, si à un type on lui a dit qu’à neuf heures et demie passe le bus et que le bus passe, tout cela conduirait au chaos au niveau de l’inconscient d’un chilien moyen.
RUIZ : J’ai parlé du rejet progressif, c’est en cela que consiste, relativement, ma divergence avec Landau. Il insiste à considérer ces failles du comportement comme des échecs ou des accidents. Il y a un comportement rationnel, qui consiste à aller au boulot, arriver à temps et faire bien son travail. Ou, directement, on refuse ce boulot pour détruire ce qu’il signifie. Les demi-mesures sont des indices du sous-développement, c’est son point de vue, et en partie celle de Wright Mills et de la grande majorité des sociologues marxistes qui interprètent le Tiers Monde. Je suppose que le schéma est valable et as l’avantage d’être très clair, de sorte qu’à partir de lui vous pouvez rapidement cataloguer tous les événements qui sont mis en avant. Mais il a l’inconvénient de créer, à partir du point de vue des résultats de nos recherches, une sorte de gel émotionnel. C’est-à-dire qu’il est impossible de ressentir de la sympathie pour ceux qui n’ont pas pris une décision, pour ceux qui sont victimes du sous-développement, par conséquent, pour nous tous à différent degré.
Mais prenons quelqu’un qui participe à la lutte politique jusqu’à ces dernières conséquences, un militant du MIR. On peut facilement le détecter — et Landau a prouvé dans le film Fidel — une vingtaine ou trente caractéristiques d’un habitant du Tiers-Monde, sous-développé, c’est-à-dire un certain nombre d’incohérences dans le comportement. Il y a une cohérence générale et vingt gestes qui la contredisent. Pour Landau, cette contradiction est un choc et aussi pour la plupart des sociologues marxistes et intellectuels de la gauche européenne. Ceci est soulevé dans Les Damnés de la terre, de Fanon. Nous les êtres du Tiers Monde, dans la mesure où nous participons à ces incohérences, nous les assumons et la pratiquons, nous sommes condamnés, c’est-à-dire, en dehors de l’évaluation, nous ne pouvons être libres, nous ne sommes pas en mesure de sortir de ce monde, nous sommes condamnés. Le fait que nous soyons classifiés ainsi nous conduit émotionnellement à avoir une certaine tendance à rejeter ces interprétations.