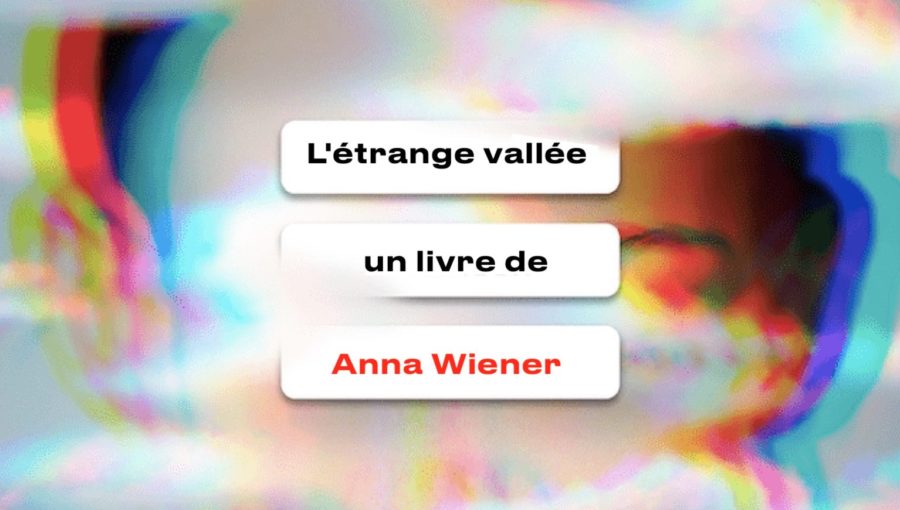Après avoir travaillé dans l’Eldorado des startups, l’écrivaine Anna Wiener démolit la culture de Google & Co : « Ils disent qu’ils veulent améliorer le monde. Mais pour qui ? » Interview
La Silicon Valley, plus que la nébuleuse géographique qui la délimite, est un état d’esprit. Avec le totem de la disruption, une version algorithmique de la destruction créatrice schumpétérienne. Et le tabou de l’argent, qui est par quintaux et dépensé par tonnes pour survivre avec des loyers astronomiques, mais dont on ne parle jamais. La mission déclarée de presque toutes les startups est, carrément, de « faire du monde un endroit meilleur ». Un slogan qui ne résiste pas à l’épreuve des faits. En effet, ce qui rend Anna Wiener furieuse dans The Uncanny Valley*, le journal intime éclairant de ses cinq années de travail dans deux startups différentes (aujourd’hui publié en Italie par Adelphi), c’est précisément que les entrepreneurs technologiques « semblaient constitutionnellement incapables de se retenir de cannibaliser la musique, les livres, les sous-cultures : tout ce qui rendait la vie intéressante ».
Le problème des ingénieurs, m’explique la journaliste new-yorkaise de 33 ans via Zoom, c’est qu’ils souffrent d’une sorte de « techno-déterminisme aigu. Si quelque chose peut être fait, il faut le faire. En tant qu’utilisateur, je dis que Spotify fonctionne très bien, mais il échoue lamentablement à permettre aux musiciens de vivre de leur musique ». Mais c’est un effet secondaire, une externalité négative dont l’élimination n’est pas de la responsabilité du programmeur ou du PDG. Lequel ne cesse de répéter, à chaque conférence Ted à laquelle il est invité, qu’il vise une version 2.0 plus performante du monde tel que nous le connaissons (« Mais d’autres questions seraient : Meilleur pour qui ? et quel genre de monde ? »).
En quelques années seulement, le bashing de la Silicon Valley est devenu un genre littéraire dont vous êtes la représentante la plus fringante. Quand a eu lieu le tournant ?
En fin de compte, le phénomène a été scruté à des niveaux correspondant à ses dimensions économiques et sociales, aux niveaux effrayants d’inégalité qu’il produit. Le moment a peut-être été celui des élections [présidentielles US] de 2016 et du rôle que Facebook y aurait joué. Une sorte de boîte noire à l’intérieur de laquelle se passaient des choses que les gens ne comprenaient pas. Mais des voix critiques, comme celles de Paulina Borsook et Ellen Ullman, existent depuis que l’internet existe. Je suis arrivée à un stade historique où on était plus réceptif.
Tristan Harris, un autre critique célèbre, dit que beaucoup de problèmes sont liés au modèle publicitaire : Facebook vise à vous rendre dépendant parce que c’est comme ça qu’il gagne de l’argent, alors qu’Apple ne le fait pas, il gagne de l’argent en vendant son téléphone. Vous êtes d’accord ?
Je suis d’accord que le modèle publicitaire veut accrocher les clients, en maximisant leur engagement (implication) de toutes les manières possibles. Mais chaque modèle a ses problèmes. Google a été attaqué pour ses contrats avec le Pentagone. Amazon pour avoir donné à la police un logiciel de reconnaissance faciale. Le problème est vaste.
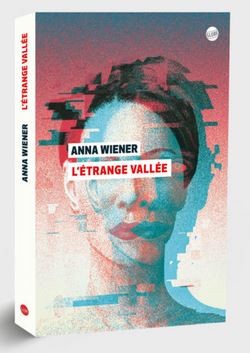
Anna Wiener L’étrange vallée Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Peronny Éditions Globe 320 pages / 22 € ISBN 978 – 2‑211 – 31010‑9 Parution : 10 février 2021
Parmi les problèmes collatéraux, il y a aussi la gentrification (l’embourgeoisement) accélérée par la Big Tech : comment est-ce de vivre à San Francisco aujourd’hui ?
Les problèmes de logement étaient là avant, mais les nouveaux riches les ont multipliés, et j’y ai aussi contribué au prorata. Mais la pandémie a fait chuter les loyers jusqu’à 40 %. D’une part, ceux qui ont fui la ville parce qu’ils ne pouvaient plus se le permettre reviennent. D’autre part, certains ont profité du « travail à domicile » pour déménager. C’est peut-être une occasion pour la ville de redevenir vivable, même pour les sous-cultures originales et pas seulement pour la monoculture technologique.
Un autre paradoxe de l’industrie, dans la partie du monde qui protège toutes les nuances sexuelles des « identités non binaires », est sa misogynie : comment l’expliquez-vous ?
Je pense que cela a un rapport avec son origine dans la contre-culture libertaire, avec le mythe de l’underdog (l’opprimé), du perdant qui rattrape le terrain perdu en travaillant comme un forcené. Cette volonté de rédemption, bien que ce soit aussi le berceau de la libération sexuelle, semble toujours liée aux hommes.
Côté bizarreries, vous mentionnez certaines des questions posées lors des entretiens d’embauche, comme « Combien de mètres carrés de pizza sont-ils consommés aux USA ? » ou « Combien de balles de ping-pong rentrent-elles dans un avion ? » Que sont-elles censées dire sur l’intelligence du candidat ?
Qu’il est capable de réduire un problème complexe à des unités élémentaires, qu’il sait comment naviguer dans des territoires inconnus. Celle que j’ai préférée était : « Comment expliqueriez-vous l’internet à un paysan du Moyen-Âge ? » Il faut simplifier, aller à l’essentiel. Google a lancé ce style, ensuite mythifié.
Vous racontez également une fête d’entreprise avec chasse au trésor et selfies sur fond de strip-tease. Est-ce que cet éthos d’adolescents attardés est vraiment nécessaire ?
La contre-culture joue ici aussi un rôle. L’idée d’être irrévérencieux, de faire les choses différemment, sans costume-cravate. Mais il y a aussi un autre aspect : si je peux vous convaincre que le travail est amusant, vous en ferez plus, vous ne voudrez pas quitter le bureau. D’où les cantines gargantuesques et autres avantages.
Côté manipulation, on trouve l’ingénieuse abréviation d’ « application » en « app », comme pour supprimer l’aspect informatique. D’autres exemples de maquillage linguistique ?
Uber appelle les chauffeurs « partenaires », pour gommer le statut de salarié. L’utilisation de « AI », l’intelligence artificielle, avec toute sa charge abstraite, pour tant de services qui pourraient plutôt être expliqués. Le marketing de la vallée vise à obscurcir les choses. Le démystifier est un impératif moral.
En parlant d’Uber, il vient de gagner un référendum pour ne pas avoir à embaucher de chauffeurs. Cela ne me semble pas le signe que la Silicon Valley a atteint un sommet dont elle ne peut que descendre…
Non, la phase dans laquelle nous sommes est marquée par les critiques, mais ils continueront à faire leur business comme si de rien n’était. Peut-être qu’ils vont changer un peu la narration. J’apprécierais l’honnêteté s’ils commençaient à dire : nous avons fait cette app pour l’argent ! L’industrie — et le confinement l’a réaffirmé — est en meilleure forme et plus omniprésente que jamais. Quelque chose bouge cependant, à commencer par diverses tentatives de syndicalisation. Et puis, pour gagner le référendum, ils ont alloué 200 millions de dollars à leur campagne. On ne dépense pas une telle somme si l’ on n’a pas peur que le vent tourne.