Source : http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=9773
Sortir de la grande nuit, d’Achille Mbembe : livre essentiel !
Par Olivier Barlet
Somme salutaire et décapante, Sortir de la grande nuit — Essai sur l’Afrique décolonisée, le nouveau livre du politologue Achille Mbembe, est incontournable. Son analyse des processus de décolonisation, de l’évolution contemporaine de l’Afrique et de ses relations avec la France sont à lire et relire : une telle pertinence et une telle clarté sont rares ! D’autant plus que si Mbembe ne fait de cadeau à personne, il n’est ni contempteur ni donneur de leçons. Il en appelle simplement à un nouveau paradigme pour des changements profonds tablant sur les mutations du Continent.
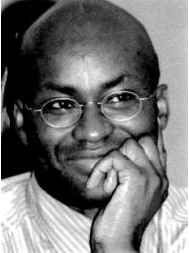 Peut-on même parler de décolonisation, tant la continuité reste forte avec l’ère coloniale ? La colonie, Achille Mbembe montre qu’elle était avant tout fondée sur “l’ivresse de la force” (p.91) et sur la race. Ce sont ces préjugés qui soutiennent encore les discours et pratiques à l’œuvre envers les immigrés dans la société française qui “décolonisa sans s’autodécoloniser”. De l’Afrique, Mbembe trace un portrait pessimiste, “peuplée de passants potentiels” (p.22), dominée par des satrapies séniles mais prêtes à tout pour conserver leurs prérogatives, et dont la démocratisation est bloquée par des facteurs tant structurels qu’imaginaires. Pour sortir de “l’alternative perverse : fuir ou périr” (p.27), un New Deal est nécessaire. Ce sont les conditions de cette nouvelle donne qu’explore Mbembe en dressant un édifiant mais fort réaliste état des lieux tout en dégageant les chances d’une évolution des imaginaires pouvant préparer le changement.
Peut-on même parler de décolonisation, tant la continuité reste forte avec l’ère coloniale ? La colonie, Achille Mbembe montre qu’elle était avant tout fondée sur “l’ivresse de la force” (p.91) et sur la race. Ce sont ces préjugés qui soutiennent encore les discours et pratiques à l’œuvre envers les immigrés dans la société française qui “décolonisa sans s’autodécoloniser”. De l’Afrique, Mbembe trace un portrait pessimiste, “peuplée de passants potentiels” (p.22), dominée par des satrapies séniles mais prêtes à tout pour conserver leurs prérogatives, et dont la démocratisation est bloquée par des facteurs tant structurels qu’imaginaires. Pour sortir de “l’alternative perverse : fuir ou périr” (p.27), un New Deal est nécessaire. Ce sont les conditions de cette nouvelle donne qu’explore Mbembe en dressant un édifiant mais fort réaliste état des lieux tout en dégageant les chances d’une évolution des imaginaires pouvant préparer le changement.
Dans un premier chapitre très personnel, Mbembe évoque d’une belle langue poétique sa trajectoire, son exil du Cameroun, “dans le destin de la nuit du monde” (p.32). Il évoque son enfance au village, son apprentissage de la peur et de la mort, puis sa découverte de la théologie de la libération à l’époque des nationalismes triomphants. Etudiant à Paris, il hérite du patrimoine culturel français, lequel révèle aussi sa face nocturne, contradiction entre sa tradition universaliste et son dogme républicain qui a soutenu la colonie. L’hospitalité new-yorkaise, sa collusion des cultures et la montée en puissance de l’Amérique noire lui offrent une alternative plus à même de penser un futur. Plongeant ensuite dans la fusion culturelle sud-africaine, il perçoit une modernité contemporaine africaine en marche qu’il théorise comme “afropolitaine”. Il en reprend (p.229) la définition déjà énoncée en 2005 dans son article publié dans Le Messager et Africultures ([article n°4248]) : “La conscience de cette imbrication de l’ici et de l’ailleurs, la présence de l’ailleurs dans l’ici et vice-versa, cette relativisation des racines et des appartenances primaires et cette manière d’embrasser, en toute connaissance de cause, l’étrange, l’étranger et le lointain, cette capacité de reconnaître sa face dans le visage de l’étranger et de valoriser les traces du lointain dans le proche, de domestiquer l’in-familier, de travailler avec ce qui a tout l’air des contraires — c’est cette sensibilité culturelle, historique et esthétique qu’indique bien le terme “afropolitanisme””.
 Hantées par l’esprit de la plantation, Haïti et le Libéria ont perpétué la servitude et échouèrent dans leur tentative d’autonomie. Ce fut justement le projet de la décolonisation : la “déclosion” du monde au sens d’une levée des clôtures pour faire surgir l’humanité à travers la conscience de soi. Il faudrait pour cela abolir la race et la pensée universalisante au sens de la critique postcoloniale pour faire émerger une pensée monde (chapitre 2). Cela implique un décentrement : une Europe qui se recloisonne est sans intérêt, ni pour l’Afrique ni pour le monde (p.87).
Hantées par l’esprit de la plantation, Haïti et le Libéria ont perpétué la servitude et échouèrent dans leur tentative d’autonomie. Ce fut justement le projet de la décolonisation : la “déclosion” du monde au sens d’une levée des clôtures pour faire surgir l’humanité à travers la conscience de soi. Il faudrait pour cela abolir la race et la pensée universalisante au sens de la critique postcoloniale pour faire émerger une pensée monde (chapitre 2). Cela implique un décentrement : une Europe qui se recloisonne est sans intérêt, ni pour l’Afrique ni pour le monde (p.87).
C’est alors que Mbembe dresse un portrait au vitriol de la France actuelle. On sent son regret de la voir refouler le cosmopolitisme qui fonderait pour le monde une “démocratie à venir”. Au contraire, la plantation et la colonie se sont installées dans les banlieues (p.94). Plongeant dans le narcissisme, nation figée en déclin, la France est impuissante à penser la postcolonie. Les démonstrations de Mbembe sont fulgurantes : rapport métaphysique de la France avec sa langue et impensé de la race qui récuse l’humanité commune définie par l’idée républicaine. Non content de dresser cet état des lieux, il dessine les voies de sortie, prônant le cosmopolitisme contre “une démocratie des communautés et des minorités” et “son double masqué : une démocratie imbue de ses propres préjugés de race mais aveugle aux actes par lesquels elle pratique le racisme”. (p.118) Cette démocratie à venir, Mbembe la centre autour des questions de savoir qui est mon prochain, comment traiter l’ennemi et que faire de l’étranger.
Car c’est bien la question de l’altérité qui reste essentielle pour définir un avenir, alors même que l’on sort de la subalternité imposée par le “long hiver impérial français” qu’il analyse dans son 4ème chapitre dans toutes ses contradictions. Il y aborde de front les reproches faits à la critique postcoloniale, tout en rappelant qu’il avait lui-même attaqué dans son précédent ouvrage De la postcolonie les tenants de l’orthodoxie postcolonialiste. La question de la différence et de l’indifférence aux discriminations débouche sur celle de la violence des préjugés envers les Noirs et les Arabes, et notamment comment les controverses sur le hijab ou la burqa conduisent à la stigmatisation plus qu’à la justice. Ses développements sur le culte des grands hommes et le rapport à la mort dénotent son intérêt pour les dimensions imaginaires de la politique qui faisait déjà l’originalité de De la postcolonie. C’est ainsi qu’il explique brillamment que si la mémoire de la colonie pose autant problème en France, c’est que dans la colonie elle fut à la fois victime et bourreau.
Pour envisager les mutations modernes, Mbembe remonte plus loin que la fixation des frontières par les Etats coloniaux que franchissent aujourd’hui ceux qui cherchent ailleurs la vie qui leur manque. L’itinérance modifie l’appartenance et le territoire, sans compter que l’informalisation de l’économie va de paire avec la dispersion du pouvoir d’Etat. Dans ce contexte s’expliquent les guerres à répétition qui engagent de plus en plus les populations civiles.
Les profondes recompositions sociales à l’œuvre font l’objet d’une fine analyse qui met notamment en relief le fait que la maîtrise des ressources locales est un puissant facteur d’accès aux ressources internationales, ce qui explique les conflits liés à l’autochtonie revendiquée pour remporter la compétition. Les effets de la fragmentation sociale sur les structures familiales mettent radicalement en cause le patriarcat ambiant et génèrent des comportements nouveaux chez les jeunes au niveau des rapports hommes-femmes. Mbembe s’arrête également un bon moment sur le rejet quasi-général de l’homosexualité et ce qu’il enseigne du rapport du pouvoir à la virilité. Inutile de préciser que ces positions clairement argumentées sont rares et importantes sur des sujets où règne l’hypocrisie.
C’est une Afrique nouvelle qui apparaît sous la plume de Mbembe, marquée par la dispersion et la circulation, dont le territoire n’est plus un centre en soi et dont les expressions artistiques se font flottantes et mobiles. Il cite Sony Labou Tansi dans sa préface à son roman L’Etat honteux : “J’écris, ou je crie, un peu pour forcer le monde à venir au monde”. C’est bien là le projet de ce vibrant et radical appel à sortir du “réflexe indigéniste” (p.229) et des logiques raciales et guerrières reprises par les nationalismes africains : ce livre indispensable est un cri pour aider le monde à accoucher d’un monde à venir.
Olivier Barlet

