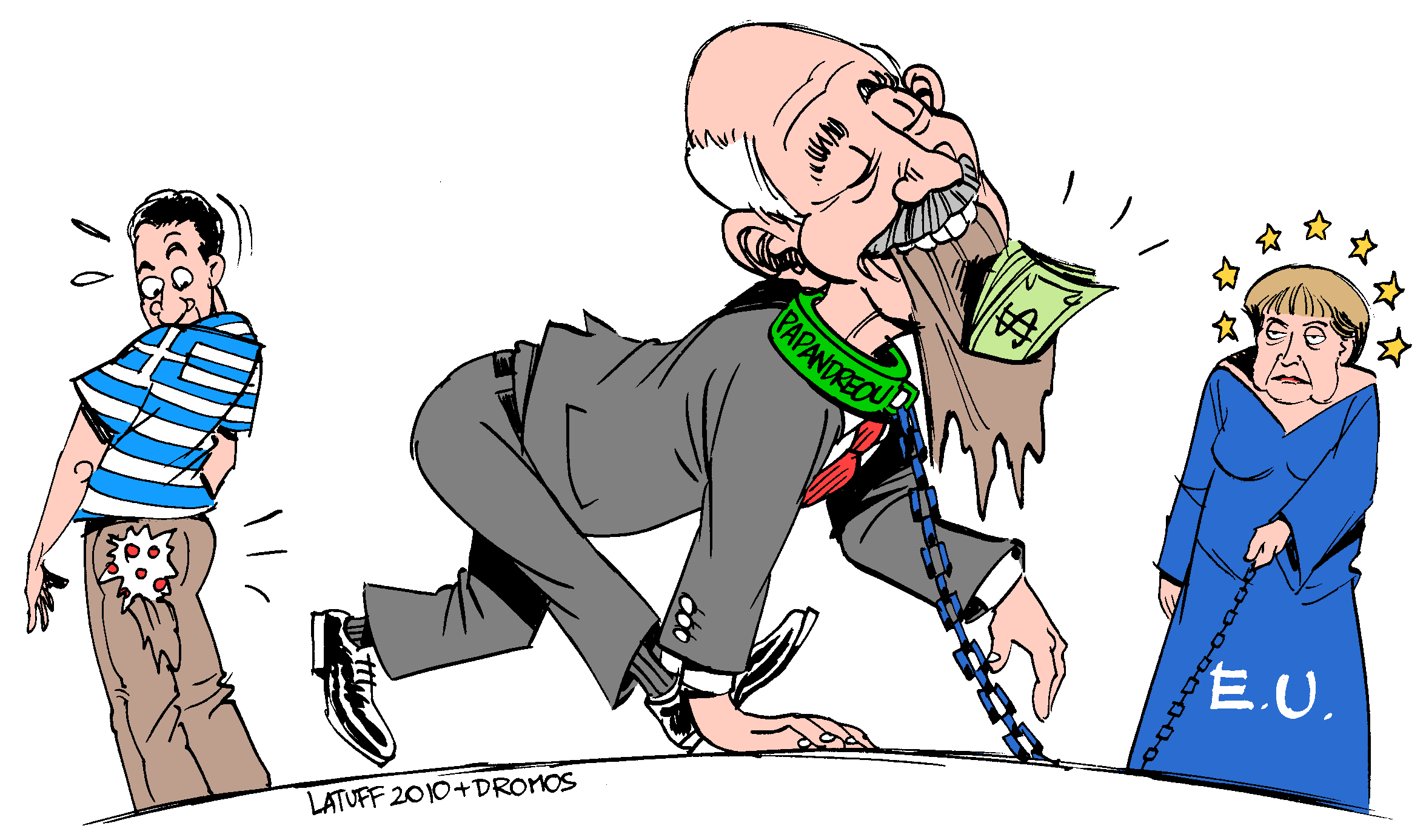
par Guillermo Almeyra
Le socialiste Giorgios Papandreou n’a pas voulu passer à la postérité de la Grèce comme l’homme qui a annulé la souveraineté nationale pour sauver les banquiers et a accepté un statut social semicolonial pour son pays, avec des fonctionnaires étrangers qui contrôleraient son économie et sa politique. Pour sauver sa responsabilité il avait demandé un vote de confiance au Parlement et, surtout, avait convoqué pour décembre un référendum populaire pour que la citoyenneté décide si elle accepte ou non le plan qui, aux dépens des grecs, permettrait aux grands banquiers de sortir de l’impasse où ils se sont mis. Après, après avoir perdu sa majorité absolue au Parlement et sous la pression franco-allemande, il a annulé le référendum et essaie de former avec la droite un gouvernement d’unité nationale, encore plus faible et discrédité que l’actuel. Devant cette crise, l’Union Européenne (lire les capitaux franco-allemands et leurs agents gouvernementaux) abandonne la Grèce à son sort (qui la mènera, presque sûrement, à la cessation de paiements de la dette, à la sortie de l’euro-zone, la création d’une propre monnaie et la dévaluation de la même – et, par conséquent, à celle des revenus des grecs – et qui pourrait la mener, même, à une révolution).
Rappelons que les États-Unis ont sauvé le Mexique, qui comptait alors moins de 100 millions d’habitants, avec 55 milliards de dollars pendant la crise nommée « Tequila ». La Grèce, avec près de 12 millions d’habitants, n’a pas pu être sauvée maintenant par une injection de plus de 200 milliards d’euros (280 milliards de dollars). Que se passera t‑il alors avec des grands pays européens peuplés, comme l’Italie et l’Espagne, dont les économies chancellent et dont les gouvernements respectifs appliquent des recettes de cheval qui les dépriment encore plus ? Si l’Union Européenne ne prend pas rapidement de grandes mesures préventives, la chute successive de l’Italie, de l’Espagne et du Portugal et l’abandon probable de l’euro par les italiens, comme le prévoit Paul Krugman, prix Nobel d’Économie, pourrait s’avérer fatal.
C’est pourquoi la chancelière allemande Angela Merkel soutient maintenant que l’essentiel est de sauver la zone euro, c’est à dire, les finances européennes, parce que l’union de l’Europe n’est en réalité pas une union de pays et beaucoup moins encore des peuples, mais une alliance conflictuelle de capitaux financiers. Ce n’est même pas sûr qu’elle puisse l’obtenir. Parce que jusqu’à présent l’Union Européenne a perdu 280 milliards de dollars, et autant comme conséquence de la chute des bourses à cause de la crise grecque. Et même pas ainsi ils ont pu stabiliser les banques, qui sont insatiables et exigent des transferts continus des revenus de la population vers leurs coffres. Bien que la Chine, qui est un grand partenaire commercial de l’Union Européenne, et a par conséquent intérêt à que celle-ci se maintient à flot, vient de lui offrir un renfort de 80 milliards d’euros (120 milliards de dollars), cet apport court le risque de s’évaporer comme une goutte d’eau sur un fer à repasser chaud.
De plus, pour « sauver » l’Union Européenne, le duo Nicolas Sarkozy — Angela Merkel jettent une bouée de sauvetage en plomb : celle de la politique récessive et brutale de la réduction des salaires indirects (grâce à des coupes dans l’éducation, la santé, l’aide sociale et des augmentations dans l’âge de la retraite et dans les impôts) et aussi des salaires directs tandis que le capital financier spécule sur les prix des matières premières agricoles. La pouvoir d’achat des consommateurs – et leur expectative de consommation –baisse tandis que le coût de l’alimentation et des services augmentent. Le résultat est une consommation interne moindre en Europe au moment où celle-ci devra payer le soutien chinois avec des concessions politiques – telle que la reconnaissance de la Chine comme économie de marché, comme l’ exige Beijing – ce qui facilitera grandement les exportations chinoises vers l’Union Européenne.
Jusqu’à présent, sauf en Grèce, où les luttes sont de plus en plus massives et décidées et pourraient déboucher sur une explosion sociale, les gouvernements européens n’ont pas à affronter une opposition sociale massive. Tout au plus, ils voient grandir une opposition qui est parfois de centre-gauche – comme les sociaux — libéraux en Italie ou les sociaux-démocrates en France – ou d’autres de droite, mais qui en aucun de ces deux cas offre une autre proposition économique que la continuité, avec des plans du capital, à peine réformés et, bien sûr, ils ne pensent même pas à une alternative sociale. Si la crise économique est profonde et très grave, l’Europe est politiquement conservatrice, et socialement elle commence seulement à se réveiller avec quelques grèves et mobilisations et avec le mouvement des indignés.
Par conséquent, et face au manque d’une menace sociale sur le pouvoir capitaliste, au Groupe des 20 on approuvera les mesures qui augmenteront le niveau des sacrifices que devront encore faire les travailleurs européens, séparés horizontalement entre natif et immigrant et verticalement par la concurrence entre ceux qui pensent seulement à leur région ou à leur pays sans percevoir la nécessité de trouver une solution commune anticapitaliste et de l’imposer collectivement. Chacun pour soi, le régionalisme, le nationalisme, le racisme, le chauvinisme qui touchent de vastes pans de travailleurs européens, sont les principaux soutiens d’un capitalisme en crise mais qui conserve encore l’hégémonie culturelle et idéologique et peut, par conséquent, dominer ses victimes désunies.
Il ne suffit donc pas de condamner le capitalisme comme le font les indignés, ou de résister avec des grèves à des politiques et à des mesures comme le font quelques syndicats. Il est indispensable surtout de s’organiser dans toute Europe au dessus des frontières et en unissant immigrants et natifs, avec un programme anticapitaliste alternatif d’expropriation du capital financier, de la modification radicale du système fiscal, du soutien à la consommation populaire et une planification commune du développement industriel. Ce programme doit partir du fait que la crise doit être payée par ceux qui l’ont causée, que les salaires et les conditions de vie sont intangibles, qu’à l’internationalisme des finances et des transnationales il faut opposer l’internationalisme des producteurs.
La Jornada. Mexique, le 6 novembre 2011.
Traduit de l’espagnol pour El Correo par : Estelle et Carlos Debiasi

