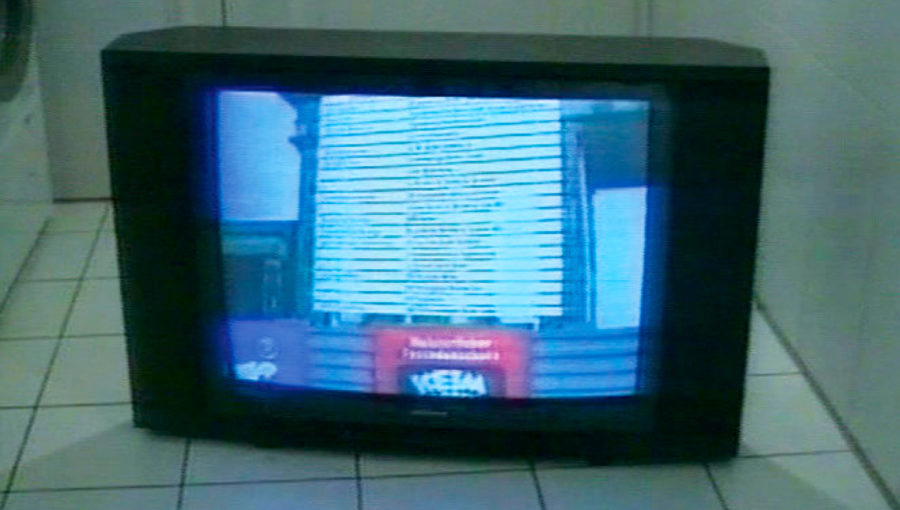Aujourd’hui, la télévision remplace le zoo. On n’a plus besoin d’aller voir les vrais animaux.
JPC : Quel regard portez-vous sur la télévision contemporaine ?
JLC : Globalement on peut dire que toutes les télévisions, y compris celle de service public, se sont ralliées à une logique qui est celle du divertissement. C’est la forme dominante aujourd’hui de la télévision au sens complet du terme, privé et public. Je ne fais plus aucune différence entre les deux. Il y a encore une différence de droit mais le droit est bafoué par les faits. Les télévisions publiques, en tous cas en France, en Italie, en Espagne s’alignent globalement d’une manière ou d’une autre sur ce qui se passe dans les télévisions privées, allant parfois jusqu’à les imiter au sens le plus bête du terme, à savoir faire la même chose qu’elles. Mais moins bien évidemment. C’est flagrant sur France 3 et sur France 2 où l’on a des producteurs, qui sont des concepteurs et des fabricants ’émissions, financées par les fonds publics. Et ces producteurs travaillent indifféremment pour TF1, France 2 ou France 3.
Si c’est les mêmes, c’est que c’est la même conception, la même idéologie, les mêmes besoins et les mêmes modèles qui circulent. Donc de ce point de vue-là pour moi ça simplifie le problème, c’est globalement la même chose. L’étude interminable de la petite différence entre public et privé ne nous apporte rien. Il y aura toujours une petite différence. Et parfois la petite différence n’est pas toujours du côté du service public. Mais globalement on perd son temps, on s’épuise en vain â courir derrière ces petites différences parce qu’elles sont quand même écrasées par une grande ressemblance. Petites différences, grandes ressemblances.
Évidemment cela ne s’est pas fait d’un coup. Cette évolution n’est la décision de personne. C’est une sorte de système, une pesanteur, une force de gravitation, qui fait qu’on va inévitablement vers ce qui est le plus capable de rassembler une audience indéfinie et la plus vaste possible. On ne travaille donc plus sur des spectateurs, ou sur des groupes de spectateurs, mais plutôt sur quelque chose de confus, de flou qui est l’audience que l’on peut avoir de telle heure à telle heure, de telle minute à telle minute) On est donc du côté de la consommation. Donc divertissement d’un côté, consommation de l’autre. Ce motif allant vers le divertissement s’impose aujourd’hui comme quelque chose de très puissant et de presque irrésistible.
Même ARTE résiste de moins en moins.
On peut dire que le documentaire a de moins en moins sa place dans ce jeu-là. Il a en tout cas une autre place qu’il faudrait peut-être essayer de comprendre. D’évidence, il y a très peu de documentaires comiques ou véritablement divertissants, au sens où ça détendrait, ça délasserait. C’est plutôt le contraire. La plupart des films documentaires quels qu’ils soient, bons ou mauvais, complexes ou simples, sont des films qui d’une manière ou d’une autre vont réveiller des questions. Des questions latentes ou à l’inverse, des questions médiatiquement ressassées. Mais ce sont toujours des questions. Et donc, d’une certaine façon, le spectateur du cinéma documentaire ou de la télévision qui montre des films documentaires, est considéré comme devant être mis d’une manière ou d’une autre en alerte, dans une position de spectateur alerte. Dans le double sens du mot, « vif », « capable d’agilité » mais aussi « averti » et peut-être même « inquiet ».
Un spectateur qui se pose des questions et qui n’est pas totalement rassuré sur le destin de sa société et de toutes les « valeurs » qui sont encore proclamées par cette société. Un spectateur qui se pose des questions politiques, éthiques, sociales et qui est pris dans des actions et dans des réalités. C’est donc ce spectateur pris dans des réalités que, d’une manière ou d’une autre, le cinéma documentaire convoque. Or, c’est précisément de ce spectateur-là que la télévision de divertissement ne veut plus.
Au contraire, elle veut qu’il vide sa tête de toutes les questions qui peuvent l’angoisser et le préoccuper (comme dit admirablement Patrick Lelay, directeur de TF1)1 et qu’il se « libère » (je mets ce mot dans un sens véritablement pervers). C’est-à-dire que le spectateur renonce en gros à penser. Parce que penser ça fatigue, ça coûte de l’argent, ça empêche de consommer, ça a beaucoup de défauts. On va donc vers une réduction de ce que l’on pourrait appeler « la subjectivité du spectateur » à un minimum.
Il ne resterait guère que des sens (les yeux, les oreilles, peut-être les glandes salivaires) qui seraient encore en état de marche. Tout le reste étant jeté à la poubelle, en tout cas pendant le temps, les longues heures qu’on passe devant le petit écran. Donc c’est ça le spectateur qui tend aujourd’hui à se fabriquer et à se répandre. C’est celui-là qui est économiquement articulé â ce qui se passe dans le divertissement. Au fond, c’est l’homme futur.
Moi je crois que la télévision fabrique du sujet, comme le cinéma. On fabrique des manières d’être dans la société, on fabrique des comportements, des logiques, des modes de pensée. Le mode de pensée fabriqué dans cette industrie du divertissement est évidemment un mode de pensée extrêmement restreint et réduit.
Je pense qu’il faut prendre la télévision (public et privé mêlés) comme un système d’initiative qui tend à fabriquer quelque chose de différent ou de nouveau. Il faut la voir positivement et pas seulement de manière négative en disant : « Oh là, là, quelle horreur ! ». Non, étudions ce qui se fabrique, voyons ce que c’est. Alors c’est ça, c’est cet homme-là. La plupart des dimensions qui caractérisent jusqu’à aujourd’hui encore l’homme en tant qu’être social sont peu â peu déconnectées. On débranche le cerveau de toutes les luttes, du social, de l’économique, et on en fait effectivement cette espèce de partenaire faible. Affaiblir certaines dimensions de l’homme â venir, affaiblir le citoyen, affaiblir le responsable, affaiblir le penseur. De ce point de vue-là, ce qui se passe à la télévision n’est que l’actualisation d’un processus bien plus ancien et évidemment infiniment contradictoire. Comme c’est un processus, ça ne se fait pas sans lutte. L’homme, le citoyen d’aujourd’hui, ne renonce pas sans résistance ou sans lutte à une série de ses prérogatives. Par exemple, il pense qu’il a son mot à dire dans la sphère politique, éventuellement dans la sphère économique, dans la sphère sociale, dans la sphère familiale, etc. Et donc si on lui demande de renoncer à tout, c’est un arrachement qui ne peut pas se passer sans douleur. Y compris dans son aliénation, quelque chose en l’homme résiste à devenir simplement la carpette du marché.
A mon avis, avec le documentaire, il se passe deux choses. On voit bien comment la télévision tend à réduire le documentaire à une forme de divertissement pédagogique, où aucun effort n’est requis pour apprendre quoi que ce soit puisque tout est déjà su. Le commentaire va nous dire ce qu’il faut penser de telle ou telle chose. Si la télévision fait une série de documentaires sur l’Inde, ça ne sera certainement pas sur les problèmes politiques, sociaux ou religieux. Ce sera plutôt sur la culture du poivre ou quelque chose comme ça. Et donc du coup cette réduction du spectateur correspond aussi à une réduction du champ traité. On ne peut pas traiter de tout parce qu’évidemment il y aurait de nouveau ce risque, ce danger d’alerter un spectateur. Donc on va réduire aussi le champ traité pour qu’il présente le moins d’aspérités possibles.
Effectivement, il y a les succès du cinéma animalier. Mais on est là dans l’anthropomorphisme absolu. On est dans la domination absolue sur les espèces animales qui sont mises à la disposition du spectateur exactement comme dans un zoo. Aujourd’hui, la télévision remplace le zoo. On n’a plus besoin d’aller voir les vrais animaux.

Strip-tease est une émission de télévision documentaire belge créée sur RTBF1 en 1985, puis belgo-française depuis le 3 octobre 19921 et sa diffusion sur France 3.
JPC : C’est d’ailleurs intéressant de voir qu’aujourd’hui, Les grands documentaires de prime-time sont des films pseudo-scientifiques qui racontent l’origine de l’homme, comme « Homo Sapiens », ou « L’odyssée de l’espèce ».
JLC : Par ailleurs, on est en pleine idéologie avec des émissions de type para-scientifique, comme « L’odyssée de l’espèce ». Attention ce n’est pas un discours pseudo-scientifique, parce que ce sont de vrais scientifiques qui sont là pour gérer ces boîtes à images. Mais c’est une science vulgarisée, une science surtout qui ne se pose pas la question de savoir dans quelle idéologie elle est, c’est-à-dire une science sans pensée. On ne pense l’objet qu’en terme technologique. C’est une évolution technologique de l’évolution des espèces. Où toutes les questions philosophiques sont évacuées. Là aussi, on lisse complètement le champ de façon à faire une pédagogie sans réveil des questions gênantes, sans remise en cause de quoi que ce soit. Surtout il ne faut pas fatiguer le spectateur, le porter à la crise. Il faut lui permettre de slalomer entre les différents points difficiles sans qu’il s’en aperçoive.
Ce que j’essaye de dire, c’est que cette logique qui consiste à débrancher l’homme de ses rapports au réel se traduit aussi par un aplatissement des programmes. Tout ça est cohérent. Si on veut un spectateur faible, totalement capable d’ingurgiter les choses sans se poser de questions, il ne faut pas que ces questions apparaissent non plus. Donc voilà, les deux se tiennent.
C’est en ce sens-là que, sur un plan théorique, on pourrait dire que la question de la place du spectateur — telle qu’elle est définie par un système quel qu’il soit et en l’occurrence la télévision —, est en fait évidemment idéologique. C’est-à-dire qu’elle se traduit par des choix qui consistent à faire tel programme plutôt que tel autre, à mettre en chantier telle série plutôt que telle autre, etc. Il y a un lien entre les deux. C’est une place stratégique.
La première tendance qu’on a vu émerger et finalement dominer à la télévision, c’est le cocktail entre l’affabulation scientifique et le spectacle. La série « Les derniers jours de Pompéi », les hommes préhistoriques, etc., ça reste du spectacle. Il y a un mélange, d’un côté de spectacularisation de l’histoire ou d’une réalité, et de l’autre une simplification, une réduction poussée vers le lissage. Cette tendance-là est aujourd’hui majoritaire.
Une autre tendance qui a émergé est que la télévision nous donne littéralement à nous spectateurs à jouir de la mise à disposition du corps de l’autre. La télé réalité en est le point d’expressivité le plus grand et le plus saillant. Mais à mon avis, cela existait avant la télé réalité, qui n’en est que le prolongement. On l’a vu, par exemple, dans la série « Strip-tease ». La télé réalité a intensifié et radicalisé des principes qui sont dans cette émission. « Strip-tease »2 portait déjà en germe cette chose-là. Mais c’est le cas aussi de beaucoup de films documentaires, où le rapport à l’autre se fait d’une façon toujours inégalitaire, où l’autre est l’objet (voire la victime) d’un dispositif, d’un pouvoir, d’un rapport de forces dans lequel ceux qui font ces films sont plus forts que ceux qui sont dedans. Ca aussi, c’est tout à fait le cas de la télé réalité. Le dispositif est beaucoup plus puissant que les êtres qu’il met en scène qui sont extrêmement affaiblis. Donc, l’affaiblissement devient le projet, le sujet même de l’émission. Ces émissions nous racontent qu’ils ont toutes les chances de s’affaiblir et comment ils vont s’affaiblir.
Parce que ne survivra, ne résistera à la pression du programme que le plus extraordinairement doué, les autres étant balayés peu à peu. C’est bien l’histoire de l’affaiblissement de l’homme qui est en jeu. On est en plein dans le darwinisme.
Mais la question de l’affaiblissement ne concerne pas seulement les personnes filmées (ou leurs producteurs ou leurs réalisateurs). Elle concerne aussi le spectateur. Pendant environ un siècle, il y a eu une ambivalence dans le fonctionnement du cinéma. Car filmer l’autre, filmer le corps de l’autre, c’est d’une certaine façon le mettre en vue du spectateur et donc le mettre à sa disposition, lui donner accès à cette représentation de la figure de l’autre avec cette ambivalence. Mais, ce n’est pas impunément qu’on a accès à la figure de l’autre. Il y a évidemment un risque. Ce risque c’est que l’autre m’entame. C’est que, non seulement il soit l’autre, une altérité, mais que cette altérité devienne une altération de ma propre place, de mon propre point de vue. Et globalement, on peut dire que c’est comme ça que le cinéma a fonctionné. C’est-à-dire que le spectateur n’est pas indemne de ce qui se passe pour le corps de l’autre dans un film. On peut prendre mille exemples, mais contentons-nous de Charlot. Le corps de Charlot travaille le corps du spectateur et ne le laisse pas totalement entier. Et les rapports de forces dont Charlot multiplie les épreuves entament quelque chose dans le corps spectateur, qui se retrouve lui aussi d’une certaine façon solidaire ou du moins complice d’une brutalité, d’une violence, d’une ruse, d’une souffrance, qui passent par Charlot. Donc le cinéma c’est la figuration du corps de l’autre qui passe par mon corps spectateur. Si je pleure en regardant un film par exemple, c’est évidemment que quelque chose m’a déchiré d’une manière ou d’une autre et m’a été arraché par la figuration de la situation dans laquelle le corps de l’autre joue. Du coup quelque chose m’est enlevé, il y a une réaction et des sentiments qui naissent.
Pour le cinéma, l’implication du corps spectateur est une donnée absolue. Sinon il n’y a pas de cinéma.
C’est d’ailleurs pour ça que la salle est obscure. C’est pour ça que le spectateur du cinéma est un infirme qui voit sur l’écran des corps non infirmes jouer, alors que lui ne peut pas bouger, ne peut pas parler, et est réduit à peu de chose. Cette réduction est compensée par le fait qu’il projette évidemment dans les corps filmés ses impuissances. Je ne peux pas courir mais le type qui est sur l’écran, lui, il va courir. Il y a donc ce rapport de compensation qui fait que mon corps de spectateur, d’une manière ou d’une autre, est pris en charge, travaillé, traversé par la figuration du corps de l’autre. Mais ça suppose des conditions qui sont celles de la séance cinématographique. Le fait que, pendant la séance cinématographique, je suis incapable de sortir de la salle et de mettre fin à la séance, d’arrêter. Un spectateur ne peut pas arrêter un film, parce qu’il faudrait aller dans la cabine, casser la tête à l’opérateur, arrêter les bobines. Peu de gens le font, parce que c’est quand même assez, assez compliqué.
En télévision, l’apparition des télécommandes, le système du zapping, est une question centrale que l’on n’a peut-être pas bien repérée au départ. Ce qui est sûr, c’est que ça donne au spectateur une puissance qu’il n’a pas au cinéma. Nous n’avons pas une télécommande qui nous permet de changer de film au cinéma. Le spectateur de cinéma est donc réduit à une certaine impuissance. Il a peu de prises par rapport à ce qui se déroule sur l’écran. Les seules prises qu’il puisse avoir sont des prises imaginaires, qui supposent une projection, sa projection à lui dans le film. Du coup, en se projetant dans le film, il risque évidemment, sinon sa peau, quelque chose de sa lucidité, ou de sa conscience, ou de ses rêves, ou de ses idées reçues. C’est ça le fonctionnement du cinéma.
Avec les télécommandes, le zapping, mais aussi la multiplicité de chaînes et canaux, apparaît aussi un téléspectateur davantage en position de consommateur. Il peut « choisir ». Je mets choisir entre guillemets parce qu’on sait bien que le choix est nul et que, entre le programme A et le programme B, il n’y a pas vraiment fondamentalement de différence. Il y a une uniformisation. Contrairement à l’idée reçue mais aussi au slogan publicitaire du libéralisme économique, le marché produit de la standardisation et de l’uniformité. Il ne produit pas une infinie variété de possibilités et de désirs. Ça, c’est un rêve qui n’est que dans la tête des idéologues libéraux. Dans la réalité, c’est le contraire qui se passe. Effacement des différences et standardisation.
Je reviens à ce que je disais sur la télé réalité. Le corps filmé de l’autre est soumis à la pression du dispositif. Il est donc mis en situation d’un être affaibli, inférieur, soumis. Cela demande souvent de lui de la docilité et une acceptation des absurdités des règles du jeu. Les corps figurants et figurés sont tenus d’accepter cette absurdité presque par contrat. On leur fait signer des papiers qui définissent les règles. Mais le plus grave pour moi, c’est que ça se répercute du côté du téléspectateur. Il est dans l’illusion d’une maîtrise des programmes. La télé réalité en a fait son motif, maîtriser le programme. Évidemment il s’agit d’une illusion, il s’agit d’un leurre. On sait bien que ni vous ni moi, ni personne ne maîtrise TF1 ou les sociétés qui produisent de la télé réalité. Nous sommes donc totalement impuissants par rapport à leurs décisions. Mais on est dans cette illusion de maîtrise, à la fois parce que le dispositif de la télévision permet le zapping, mais aussi parce que c’est précisément sur cette logique du zapping que tout est construit.
Ce qui est terrible, c’est que du coup je peux consommer du corps de l’autre sans risque. Il y aura toujours des identifications qui se produiront, il y aura toujours de la projection qui se mettra en place, ne fût-ce que sur des images fragmentaires ou des séquences brèves. Mais elle sera extrêmement canalisée et calibrée. Et on ne sera pas dans cette grande plongée dans l’inconscient qui est celle du cinéma.
En vérité, le petit écran nous coupe de la chose filmée. Le cinéma induit une circulation qui fait que je me retrouve quelque part de l’autre côté de l’écran, dans la chose filmée. En télévision ce phénomène n’a plus lieu, ou parfois de manière sporadique et insignifiante. Je vais, du haut de ma télécommande et de mon fauteuil, avoir le pouvoir de juger du destin, du sort, de l’intérêt, de la valeur, de la beauté, de la séduction, ou de la vulgarité de l’autre.
Sans que rien ne s’entame de cette place de maître que j’occuperai à ce moment-là. C’est là le véritable, l’énorme supercherie. On ne peut même plus parler de leurre ou d’illusion. On est dans la supercherie qui est une version beaucoup plus pauvre de l’art de l’illusion que l’on retrouve dans les contes pour enfants ou dans le cinéma. C’en est une version très pauvre, puisqu’au fond elle consiste à me dire que tout peut arriver à l’autre et rien ne m’arrive à moi. Évidemment de temps en temps des petits grains de subjectivité vont se glisser dans le mécanisme, mais ça restera à un état endémique, sporadique et peu actif tout simplement parce que je conserverai toujours cette position de maîtrise.
Dans la relation documentaire, il est question de la figuration du corps de l’autre. Mais la logique du divertissement dont je parlais tout à l’heure va faire glisser la relation documentaire vers une mise à disposition du corps de l’autre à la télévision. Et ce partage, cette entame de l’un par l’autre n’a plus lieu. D’un côté, le sujet. De l’autre côté, le maître. On peut penser à Marivaux, avec d’un côté des princes et de l’autre côté des esclaves.
Il y a là aussi un rapport à la jouissance. Il s’agit de jouir de la faiblesse, des avatars, du comique, du ridicule de l’autre, mais au fond sans danger, sans risque, sans péril, sans être entamé.
C’est donc dans cette société que se fabriquent des consommateurs de spectacles « débranchés », à qui on donne en échange une sorte de prime de maîtrise. Une maîtrise totalement illusoire. Aucun spectateur ne maîtrise rien de ce qui se passe dans la télévision, mais il a l’illusion peut-être de pouvoir jouir à sa guise d’une certaine façon de la faiblesse de l’autre.
Le cinéma est trahi de façon multiple par la télévision. Ce qui se passe dans un film (et c’est encore plus vrai dans les beaux films), c’est que la figure humaine est sauvée par le cinéma. Je pense que le cinéma est une entreprise de sauvetage de la dimension humaine de l’homme et que cela ne se passe plus à la télévision. La dimension humaine de l’homme est attaquée à la fois sur le plan de la consommation mais aussi sur le plan de la jouissance du spectateur.

Secret Story est une émission française de télé réalité diffusée du le 23 juin 2007 au 7 décembre 2017. D’abord en prime-time sur TF1, avant de basculer partiellement sur NT1 en 2015 puis totalement en 2016 et 2017 (hors-primes de lancement). Les candidats sont isolés du monde extérieur durant dix à quinze semaines au sein d’une demeure dénommée « maison des secrets », dont l’ensemble des pièces sont équipées de caméras vidéo, à l’exception des toilettes et d’une pièce imposée par le CSA. En compétition, chacun a pour mission de préserver un secret tout en tentant de découvrir ceux de ses colocataires.
JPC : Pourquoi les gens se laissent-ils filmer ?
JLC : Je pense que pour une grande majorité d’entre nous (je me mets dans le coup aussi), la vie réelle est extrêmement décevante, peu gratifiante et souvent pénible. La vie filmée est quand même plus plaisante. C’est quand même plus marrant d’aller sur un plateau de télévision, de se faire filmer pendant trois heures même si c’est dégradant. Au moins on est là, on est vus par les autres, on existe devant les autres, et on existe aussi devant soi-même d’une façon peut-être plus forte, plus riche, plus intéressante que quand on est tout seul chez soi devant son bol de café au lait. Il me semble qu’il y a cette dimension-là. Une généralisation du spectacle.
Le fait que chaque être à la surface de la terre fait un filmé possible. Il y a aussi l’idée (qui a donné naissance au cinéma), que l’on puisse être vu partout, une sorte de don d’ubiquité, que l’on puisse survivre et avoir accès à une certaine relative immortalité. C’est tout ça qui est en jeu.
JPC : Comment évolué la représentation de l’autre ?
JLC : Quand le cinéma léger et synchrone est devenu possible au début des années 60 la télévision existait bien sûr. Un certain nombre de réalisateurs de télévision ont utilisé cette possibilité de filmer à l’extérieur, n’importe où. On pouvait enregistrer synchrones le corps à la parole de la personne filmée. On a vu des choses très belles se faire à ce moment-là, qui étaient du cinéma à la télévision dans lesquelles l’autre filmé n’était pas méprisé, réduit, minoré, offert en pâture à un spectateur tout-puissant. On pouvait faire la découverte de l’altérité qui était aussi la découverte de ma propre part d’altérité. Ce qu’on apprend quand on filme c’est qu’il y a de l’autre des deux côtés. L’altérité de l’autre est aussi quelque chose qui m’affecte parce que je suis aussi l’autre pour lui. Nous sommes deux autres. C’est donc des deux côtés que ça se passe.
La télévision telle qu’elle s’est généralisée aujourd’hui coupe précisément cela. Il n’y a plus d’altérité que d’un côté. De l’autre, il y a du « même ». Et il ne s’agit pas que l’altérité filmée affecte l’identité, la similitude, ou la conformité de celui qui regarde aux autres regardants. Ca ne doit pas être touché. Ca doit être préservé. C’est là que le marché travaille. C’est là qu’il s’appuie. Sinon il n’y aurait pas de possibilités de mettre en équation la fonction spectateur.
JPC : On a toujours besoin d’un autre qui nous regarde pour se construire sa propre image. Tout ça renvoie donc à la construction de sa propre image.
JLC : C’est une chose à la fois absolument vraie et totalement méconnue. Le stade du miroir, tel qu’il a été décrit par Lacan , est quelque chose qui arrive à chacun d’entre nous. Très vite je suis convaincu que c’est mon image à moi que je vois dans le miroir et non pas quelque chose d’autre qui serait la manière dont le miroir constitue un autre de moi en face de moi. L’expérience traumatisante (au sens où elle déstabilise) de la découverte de son corps dans un miroir est une chose qui est terriblement refoulée, jugée insupportable. Il y avait des bouts de corps, ils deviennent une figure entière. Effectivement il y a une angoisse à accepter l’idée que l’autre et moi-même sommes à ce point solidaires et que nous marchons ensemble. Le refoulement de cette effective présence de l’autre en moi (et qui existe évidemment pour le regard des autres) se passe sur un plan psychologique mais aussi sur celui de la caméra. Je préfèrerais parfois pouvoir l’ignorer, mais identité et propriété vont ensemble.
C’est bien moi dont il s’agit mais je suis aussi propriétaire de moi-même. Et dans ce monde de la propriété privée, l’image qui serait fabriquée de moi par un autre (et notamment par cet autre radical qu’est la caméra) m’appartient. Derrière le droit à l’image, il faut donc voir un droit de propriété. Mais un droit de propriété qui s’appuie de manière retorse sur cette conviction illusoire que moi c’est bien moi, que moi et mon image c’est la même chose. Évidemment c’est un leurre.
Quand on filme un documentaire, on sait bien qu’à aucun moment la personne filmée n’est à même de se reconnaître dans ce qu’on fait, dans ce qu’on fabrique comme images. Y compris d’ailleurs en fiction, où beaucoup d’acteurs professionnels ne se reconnaissent pas véritablement. Ils ne peuvent pas se voir comme la caméra les voit. Je ne peux pas me voir comme l’autre me voit, c’est une impossibilité radicale. Cette impossibilité est suspendue par le cinéma qui brusquement me permettrait de me voir sur un écran tel que la caméra me voit. Mais évidemment on a du mal à accepter ça. J’en ai fait l’expérience encore très récemment. Je ne me laisse presque jamais filmer. Je n’aime pas ça, mais là j’étais obligé de le faire. Quand j’ai vu les rushes, j’étais absolument consterné. Je ne sais pas comment un autre verrait ces rushes, mais moi je sais que je ne peux pas me voir. Parce que je ne me reconnais pas.

Être et avoir est un film documentaire français réalisé par Nicolas Philibert. Présenté en sélection officielle au Festival de Cannes en mai 2002 et sorti en France le 28 août 2002, le film suit pendant une année scolaire un instituteur et sa classe unique d’enfants de 4 à 11 ans dans une école communale située à Saint-Étienne-sur-Usson, dans le parc naturel régional Livradois-Forez, en Auvergne. Par la suite, le film a fait l’objet d’une polémique lorsque, face au succès rencontré, l’instituteur ainsi que des familles des enfants filmés ont estimé avoir été abusés par le réalisateur et ont réclamé leur part sur les bénéfices du film ainsi qu’un droit sur l’utilisation commerciale de leur image, ce qui a relancé le débat sur l’avenir des films documentaires.
JPC : Que nous a appris l’affaire Philibert ?
JLC : C’est plutôt l’affaire Lopez que l’affaire Philibert. Ce qui s’est passé c’est que le droit de propriété au sens économique du terme a pris le devant sur tous les autres droits. C’est l’idée que, comme je suis propriétaire de mon image, cette propriété doit me rapporter, cette propriété c’est de l’argent que je gagne. Mon image va me faire gagner de l’argent.
Dans le film de Nicolas Philibert, le contrat documentaire est accompli. Celui qui a été filmé n’est pas le même que celui qui n’a pas été filmé. Si Georges Lopez n’avait pas été filmé, il serait resté Georges Lopez. Point. Il a été filmé, il a été transformé en personnage de film et là, ni lui, ni Philibert n’y peuvent rien. C’est inévitablement comme ça que ça se passe. Si le film n’avait pas eu de succès, il serait resté un personnage de film sans histoires. Et je ne crois pas que Georges Lopez se serait manifesté, ait fait un procès et réclamé des sous. Parce qu’évidemment il aurait été confronté lui aussi à cette production d’une altérité, de lui comme altérité, ou comme autre à ses propres yeux, contre laquelle il n’y a rien à dire. En revanche, le film a été un triomphe commercial et, du coup, l’idée que ce droit de propriété puisse aussi être un droit à une rentabilité s’est imposée. De ce point de vue-là, l’histoire est emblématique. C’est une histoire moderne. Le capital produit des histoires et c’en est une.
JPC : Ce qui est central dans le cinéma documentaire, c’est la question de la place du spectateur.
JLC : J’ai un peu écrit sur des films documentaires qui pratiquent cette mise à l’épreuve du corps filmé et dans lesquels on est proche du type de pratique de la télé réalité. Je pense au film de Robert Kramer « Berlin 10/90 » ou à « Dans la chambre de Vanda » de Pedro Costa. Le corps filmé est soumis à une épreuve, l’épreuve du tournage, l’épreuve de sa propre exhibition, de sa propre auto-mise en scène. C’est vrai dans les deux films. A première vue ça ressemblerait à ce qui se passe dans une émission de télé réalité. A cette énorme différence près que le corps spectateur est fortement entamé par cette représentation du corps de l’autre. Nous allons partager avec le corps exhibé et filmé, du temps, de la durée. Et dans les deux films, cette durée est une durée destructrice et constructrice. Quelque chose va se passer qui rend la place du spectateur plus critique, problématique, en crise. Est-ce que je supporte ? Jusqu’où je supporte ? Quelle place j’occupe ? Est-ce que je suis là en train de juger l’autre ? Toutes ces questions se posent dans l’un et l’autre film.
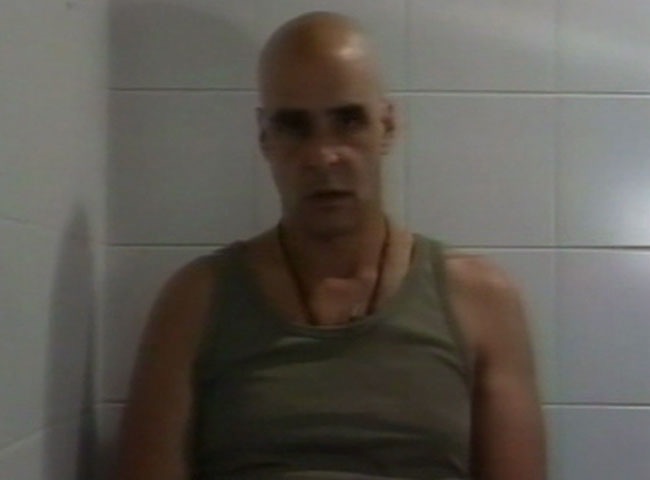
Berlin 10/90 tente de faire appel à une perception intuitive de la réalité, d’être là, maintenant, dans l’écoulement du temps. Aussi, l’important est moins le sujet filmé que le sujet qui filme, car celui qui est là, derrière la caméra, est sans retard ni écart avec ce qui arrive, il est dans le temps même qui se déroule, et ce que nous voyons est par conséquent le mouvement de sa pensée au travail.
JPC : La question de la transformation ?
JLC : Une relation (y compris difficile) dans le malaise. Ces films produisent du malaise. Et je pense que rien n’est fait dans la télé réalité pour que ce malaise affecte des spectateurs, au contraire. Pourtant ça devrait être le cas. Mais parce qu’il s’agit en fait d’une simulation plus que d’une véritable épreuve, parce que c’est un jeu, etc., ça ne se passe pas. Alors que, dans le film de Kramer, il s’agit d’une expérience mais pas d’un jeu. On le voit souffrir au fur et à mesure que le film avance. On le voit s’épuiser au fur et à mesure qu’il se filme lui-même. Dans « La chambre de Vanda », on voit cette fille mourir devant nous à petit feu si je puis dire. Mais nous sommes soumis à une épreuve qui est précisément celle de notre capacité de voir, de regarder cette mise à mort, qui est une chose terrible. Les spectateurs de ces deux films ne sortent donc pas indemnes de la séance de cinéma. Ils sortent de là affaiblis, troublés, embarrassés, contradictoires, conflictuels, et donc ils travaillent. Ils se sont mis au travail. Y compris dans le malaise. Le malaise est ici la juste mesure de l’implication du spectateur dans le film. S’il n’y avait pas de malaise, on s’en foutrait. On pourrait se mettre dans une position de maîtrise qui écarte tout ce qui pourrait troubler et faire mal. On pourrait accueillir par contre tout ce qui peut procurer cette jouissance d’être du bon côté de l’écran et pas de l’autre. (…)
Quand on parle de télé réalité on est toujours dans une équivoque parce qu’on est dans un système de contrôle paranoïaque du tournage. Il y a énormément de caméras mais leurs images aboutissent sur des écrans de contrôle où technicien ou réalisateur choisit l’image qui passe à ce moment-là. Le spectateur est donc toujours confronté, non pas à l’expérience dans sa durée et éventuellement dans sa violence, mais à une « traduction contrôle » de cette expérience, où même les crises sont mises en scène, contrôlées. Alors que dans le film de Robert Kramer ou de Pedro Costa, ce contrôle n’a pas lieu. Le spectateur est confronté directement à la prise de pouvoir du corps filmé sur le film. C’est donc bien le contraire de la télé réalité. C’est Vanda qui met ce film en scène (quand elle est là) même si c’est Costa qui est derrière la caméra. C’est elle qui gère admirablement et fortement la scène. D’ailleurs il y a bascule car à la fois elle meurt et en même temps elle met en scène. Donc elle n’est pas entièrement du côté de la destruction mais aussi de celui de la construction de quelque chose. La construction que le cinéma fait à partir de la ruine et de la faiblesse chez elle construit quelque chose pour le spectateur. Mais j’ai toujours affaire à un corps qui se bat, qui résiste. Comme Kramer qui se filme lui-même.
Il se met en face de la caméra et on voit qu’il a du mal, que c’est difficile pour lui de parler en filmant, qu’il souffre. Il le dit. Comme spectateur, je suis confronté à la souffrance de l’autre sans qu’aucun dispositif de remise en scène ne vienne la transformer en autre chose, la dialectiser. Je suis donc directement impliqué. Qui y a‑t-il derrière la caméra, sinon moi, mon regard. Il y a donc cette implication incroyable du regard du spectateur comme regard du cadreur. C’est du coup un regard qui enferme le corps de Kramer dans la durée et l’espace du cadre.
Loin d’être dans une position de maîtrise, le spectateur est ramené à une certaine impuissance (ce qui est une définition du cinéma). Non pas pour le minorer mais pour que de cette impuissance quelque chose puisse se construire. Et nous sommes plus petits que les figures filmées sur l’écran. C’est notre place d’enfance qui est convoquée par là. Enfant, je suis plus petit que les hommes et femmes que je rencontre dans la rue. On est face à l’impuissance relative d’un enfant qui n’a pas assez de muscle ou de tête pour bousculer le monde. Et de ce fait c’est plutôt lui qui est bousculé par le monde qui se présente à lui.
- Patrick Lelay, PDG de TF1, avait défrayé la chronique en juin 2004 à cause de propos tenus sur la télévision dans un livre intitulé « Les dirigeants face au changement » (Ed. du Huitième jour, 2004). Il y écrivait notamment « Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective ‘business’, soyons réaliste : à la base, le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit […] Or pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-â-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible. […] Rien n’est plus difficile que d’obtenir cette disponibilité. C’est là que se trouve le changement permanent. Il faut chercher en permanence les programmes qui marchent, suivre les modes, surfer sur les tendances, dans un contexte où l’information s’accélère, se multiplie et se banalise… […] La télévision, c’est une activité sans mémoire. Si l’on compare cette industrie à celle de l’automobile, par exemple, pour un constructeur d’autos, le processus de création est bien plus lent ; et si son véhicule est un succès il aura au moins le loisir de le savourer. Nous, nous n’en aurons même pas le temps ! […] Tout se joue chaque jour sur les chiffres d’audience. Nous sommes le seul produit au monde où l’on ‘connaît’ ses clients à la seconde, après un délai de vingt-quatre heures » (Patrick Lelay, dans « Les dirigeants face au changement », op. cit.)
- « Strip-Tease » est une émission belge (puis franco-belge) produite par la RTBF qui s’est positionné pendant 17 ans comme « le magazine qui déshabille la société ». Plus d’info sur le site officiel www.stripteaselesite.com