Il est réellement important d’avoir une idée du fonctionnement du pouvoir, de la manière de l’affronter, de le changer, et de la façon d’instituer de nouvelles relations de pouvoir, dans la perspective d’un ordre plus juste, plus égalitaire et solidaire.
Entretien avec Asef Bayat, auteur de “Révolution sans révolutionnaires”, par
Heba Khalil & Linda Herrera
Asef Bayat est professeur de Sociologie à l’Université de l’Illinois, Urbana-Champaign. Dans son dernier livre, Revolution without revolutionaries : making sense of the Arab Spring (Révolution sans révolutionnaires : comprendre le Printemps Arabe), il étudie le sens du combat révolutionnaire pendant la période de l’après-guerre froide, une « époque où l’idée même de révolution s’est dissipée. »

Au cours de cet entretien, Heba Khalil questionne Bayat sur l’histoire des révolutions et des idées révolutionnaires, sur la place des gens ordinaires dans la transformation de la société et sur ce qu’on peut apprendre du “moment Tahrir” et du Printemps arabe.
H : Votre nouveau livre porte un titre provocateur, « Revolution without Revolutionaries. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là ?
A : Quand je parle de « révolution sans révolutionnaires », j’entends révolutions sans idées révolutionnaires. Il s’agissait bien de révolutions, si l’on considère le côté spectaculaire de ces extraordinaires manifestations de protestation. Elles étaient remarquables par leurs techniques de mobilisation ─ comment mobiliser, comment résister et réussir à faire descendre tant de gens dans la rue. Dans le cas de l’Égypte, la place Tahrir est devenue un espace global, un modèle pour les autres mouvements qui ont surgi ensuite dans d’autres endroits, dans quelque 5.000 villes du monde entier. Mais ce qui manquait tout à fait, à mon avis, c’est une vision des changements que doit apporter une révolution et de la manière de s’y prendre pour arracher le pouvoir aux gens en place. Bien sûr, certains avancent qu’une vision peut se former spontanément pendant le cours du processus révolutionnaire, peut-être que oui, peut-être que non. Je n’en suis pas vraiment convaincu. À mon avis il est possible que certaines idées se fassent jour au cœur de l’action, mais en réalité elles doivent s’appuyer sur une réflexion profonde et une analyse rigoureuse.
Par exemple, les événements de la place Tahrir même ne signifiaient pour certains observateurs pas moins qu’un « futur-dans-le-présent ». En d’autres termes, ils étaient vus comme un espace démocratique géré par les gens, du genre de ce qu’Hannah Arendt appelait une « Polis grecque » où les gens menaient leurs affaires démocratiquement sans être soumis à un pouvoir souverain. C’est une idée très intéressante qui a captivé des gens comme Alain Badiou, Slavoj Žižek, etc. Mais je pense que, tout en étant un événement si spectaculaire, si exaltant, Tahirir a aussi été exceptionnel et transitoire. Ce fut un moment dans le long processus de la révolution, qui se produit dans la plupart des grandes transformations révolutionnaires, quand apparaissent des pratiques qui naviguent entre le réel et l’irréel, entre la réalité et l’utopie. Mais la question que je me posais était la suivante : que se passe-t-il le lendemain de l’abdication du dictateur, quand les gens rentrent chez eux pour vaquer à leurs besoins quotidiens, le pain, le travail, la sécurité et la normalité ? Voici le genre de questions que j’ai à l’esprit quand je parle de visions plus larges et de réflexions profondes, que selon moi les révolutionnaires devraient avoir. Il faut avoir une idée assez précise de ce qui se passera le jour d’après. Comment voulez-vous transposer le superbe modèle démocratique que les gens ont connu sur la place Tahrir au niveau de la société, de l’État, à l’échelle nationale ? Le défi est là.
Et ce ne sont pas seulement les soulèvements arabes qui n’ont pas été en mesure de répondre à ces question. Si on examine les autres mouvements sociaux qui se sont produits dans le monde pendant cette période charnière de 2011, comme Occupy, ils partagent ce point commun, qui est de ne pas avoir de vision alternative à l’instar des révolutions précédentes. Tout ce qu’on peut dire ici est que quand un mouvement révolutionnaire arrive à maturité, il est réellement important d’avoir une idée du fonctionnement du pouvoir, de la manière de l’affronter, de le changer, et de la façon d’instituer de nouvelles relations de pouvoir, dans la perspective d’un ordre plus juste, plus égalitaire et solidaire. Mais, pour aller plus loin, nous devons, dans nos mouvements, non seulement réfléchir à la façon d’aborder la question du pouvoir, mais aussi celle de la propriété.
À ce stade, je voudrais souligner une différence importante : les militants du Printemps Arabe ont séparé le domaine du politique de celui de l’économique, comme s’il s’agissait de deux sphères distinctes. En fait, ils n’ont pas fait ou dit grand-chose en matière de relations économiques, si ce n’est d’appeler à plus de « justice sociale ». Mais nous devons nécessairement nous demander ce qu’ils entendaient par « justice sociale ». Avec quel ancrage institutionnel ? Comment se proposaient-ils d’instaurer la justice sociale, ou n’étaient-ce que des paroles creuses, une réaction aux terribles inégalités que le néolibéralisme a imposé aux gens ordinaires ? Comment s’attaquer à ces spoliations ?
Autrefois la question de l’égalité était essentielle pour beaucoup de révolutionnaires, mais elle n’a pas été reprise par les révolutionnaires arabes, bien que l’exclusion sociale et économique ait été une des préoccupations majeures pour beaucoup de gens ordinaires. Les questions clés soulevées par la classe politique arabe semblaient concerner la responsabilité gouvernementale, la démocratie et les droits humains. Je dois dire que ces exigences ont certes une très grande importance dans notre partie du monde. Mais elles sont souvent reprises et manipulées par les régimes autoritaires et leurs alliés occidentaux, qui tiennent un discours similaire. Ce discours est souvent utilisé pour masquer le rapport qui existe entre la classe dirigeante et l’exclusion sociale, le pillage économique, les terribles inégalités et le régime de la propriété.

Quelle différence voyez-vous entre les révolutions des années 1970 et avant, comme celles de l’Iran, du Nicaragua et de Cuba, d’une part, et le Printemps arabe, de l’autre ?
Pour expliquer cette différence, il est essentiel de comprendre qu’elles ont eu lieu à des périodes différentes sur le plan idéologique. À l’évidence, les révolutions des années 70 ont eu lieu alors que la guerre froide faisait rage, et que le monde était divisé entre l’Union soviétique et ses alliés, les pays socialistes, d’une part, et le monde capitaliste de l’autre. Et puis il y avait un tiers monde, dont faisaient partie l’Iran et le Nicaragua. Mas il y avait encore des mouvements de libération et des mouvements sociaux, qui penchaient vers des idéologies radicales comme le socialisme et le communisme, surtout dans les pays en voie de développement.
Il y avait aussi des mouvements anti-impérialistes très puissants, comme à Cuba, que beaucoup de groupes politiques de ces pays en voie de développement soutenaient. À l’inverse, le Printemps arabe s’est concrétisé dans une période idéologique différente des années 70, dans un interrègne en quelque sorte post-idéologique : la période qui avait suivi 1989 et les révolutions anticommunistes en Europe de l’Est marquait la toute fin de l’idéologie d’opposition en tant que telle. Ainsi, avec la fin du socialisme suite aux révolutions en Europe de l’Est, l’idée même de révolution, qui était si intimement liée idéologiquement au socialisme, s’est éteinte. C’était comme si le monde était devenu incapable de percevoir la pertinence des révolutions. Les révolutions arabes se sont donc produites au moment où l’idée même de révolution avait disparu.

Dans quelle mesure l’absence de théoriciens de l’avant-garde révolutionnaire comme Trotsky, Guevara, Fanon, ou l’idéologue socialiste islamique de la révolution iranienne, Ali Shariati, a‑t-elle affecté le processus et l’issue des révolutions arabes ?
Les révolutions démarrent presque toujours spontanément et surprennent tout le monde, y compris leurs protagonistes eux-mêmes, des gens comme Lénine, qui sont des révolutionnaires professionnels. Mais les révolutions sont généralement liées à une démarche intellectuelle, à un bagage conceptuel élaboré, qui oriente la pensée des militants, leurs espérances, particulièrement la stratégie révolutionnaire et la vision des changements à venir. Ces idées servent de guide général sur la façon de faire avancer la révolution. Rosa Luxemburg, par exemple, a apporté ce qu’elle appelait la « théorie » dans la pratique révolutionnaire. Lénine avait décrit de façon détaillée la nature du développement capitaliste en Russie, ainsi que la nature de l’État. Frantz Fanon a développé la notion de la révolution anticolonialiste. La révolution nicaraguayenne s’appuyait sur la théorie du socialisme démocratique et la vision d’Augusto Sandino. Ali Shariati avait envisagé une révolution qui reflète les particularités de la société et de la culture iraniennes ─ un mélange de socialisme marxiste et de chiisme révolutionnaire.
Dans le cas des révolutions des années 2010, il me semble qu’elles ne s’appuyaient pas sur une quelconque idéologie populaire. Il n’existait pas de visions alternatives aux institutions et aux rapports économiques en vigueur sous les régimes existants. Il semble que ce que voulaient les protagonistes, c’était chasser les autocrates comme Mubarak, Ben Ali ou Saleh. Mais qu’est-ce qui se passerait ensuite ? Ils envisageaient probablement un gouvernement plus représentatif, et le respect de l’État de droit. Mais alors, comment y parvenir ? Par quoi voulez-vous les remplacer ? Autrement dit, la question était de chasser du pouvoir les régimes en place ; avec quels moyens, quelles ressources ? Bien sûr, ils disposaient du pouvoir dans la rue, de la volonté populaire, et c’est important. L’espoir était que le régime soit obligé de reconnaître sa défaite. Mais même ainsi, l’instauration d’un nouvel ordre demanderait de la réflexion, de l’analyse, de l’imagination, sans parler d’organisation.

Vous avez parlé de la question du pouvoir étatique dans la révolution. Selon vous, quelles transformations sociales les révolutions arabes ont – elles apportées pour les gens « ordinaires » ?
Aucune révolution ne réussit sans la participation des gens ordinaires. Même dans la guerre de guérilla, où les protagonistes n’étaient pas plus de deux ou trois cents, ils n’y seraient pas arrivés sans l’appui des paysans et des gens des villes. Sinon ils auraient été battus . En général, la participation des gens ordinaires peut faire beaucoup pour sécuriser les protagonistes et leurs actions de protestation, en faisant en sorte, qu’ils apparaissent comme la préoccupation de chacun, en les intégrant dans le courant général. Faire paraître ordinaire, « normale » une protestation illégale et non programmée est un acte assez extraordinaire.
S’ils ne sont pas intégrés dans le courant général, les militants peuvent être facilement identifiés, ostracisés, isolés comme déviants antisociaux, et ainsi éliminés. Mais quand on voit les foules qui descendent dans les rues ─ hommes, femmes, vieillards, enfants, familles entières, etc.─ , cela devient très important. Une telle présence des masses sur la place publique démontrerait de surcroît la force du mouvement et de l’opposition, aussi bien à leurs propres yeux qu’à ceux de leurs adversaires. Alors, effectivement, les gens ordinaires jouent un rôle crucial dans les luttes révolutionnaires. J’ai parlé de leur rôle pendant les insurrections ; leur rôle est tout aussi important après le changement de régime, car leurs actions à la base, dans les usines, à la ferme, dans les quartiers ou dans leurs syndicats, ont souvent pour effet de radicaliser les mouvements révolutionnaires.
Comment des révolutions, en soi radicales, peuvent-elles en même temps ne pas remettre en question la vision du monde du système contre lequel elles se soulèvent ?
C’est une question très intéressante. Je suppose que ce paradoxe et cette contradiction apparents reflètent d’une certaine manière les contradictions de notre époque. En effet, la première phrase du livre commence ainsi : « il n’est pas nécessaire que les gens aient réfléchi à la révolution pour qu’il s’en produise une… Parce que, quand les révolutions éclatent, ça n’a que peu de rapport avec des idées et encore moins avec une théorie de la révolution. Les révolutions éclatent, « simplement »… Bien sûr je mets « simplement » entre guillemets, mais en fait elles éclatent d’une manière très complexe. Qu’on ait ou non une conception de la révolution a des conséquences cruciales sur l’issue d’une révolution, quand celle-ci éclate.
En d’autres termes, des mouvements révolutionnaires peuvent se produire, et se sont effectivement produits, même si la classe politique, par exemple les militants, n’avait pas pensé à la révolution, ne l’avait peut-être même pas imaginée. Et c’est pour cela que, quand ça a éclaté à Sidi Bouzid et plus tard sur la place Tahrir, les révolutionnaires et les militants ont été obligés d’improviser. Ils ont dû relever un défi qu’ils n’avaient jamais imaginé ─ que faire de cette foule, et que se passerait-il le lendemain ? Ils ont dû improviser, et c’était très difficile. À un moment, pendant les émeutes, les protagonistes ont dû se dire « nous ne sommes probablement pas prêts pour ça », « nous n’avions pas pensé à ça », et « nous aurions dû penser à ça », mais alors il était trop tard.
Conséquence de cette réalité paradoxale, le résultat est devenu ce qu’on pourrait appeler des « réf-olutions », ou si vous préférez des « révolutions réformistes ». Cela signifie qu’il s’est produit un mouvement révolutionnaire qui a obligé l’État existant à se réformer au nom de la révolution. Cela différait des révolutions précédentes où les révolutionnaires formaient un gouvernement provisoire, un organe alternatif de pouvoir, disposant d’une sorte de « force de frappe » qu’ils utilisaient, alliée à leur puissance dans la rue, pour obliger le pouvoir en place à abdiquer. Ils s’emparaient alors du pouvoir exécutif et instauraient de nouvelles structures de gouvernement, de nouvelles institutions sociales et de nouvelles relations dans la société. Ces transformations rapides et radicales qu’on a observées dans les révolutions des années 70 ne se sont pas produites dans le cas de la Tunisie, de l’Égypte ou du Yémen.

Vous décrivez le Printemps Arabe et le mouvement Occupy comme « post-idéologiques ». Quels sont les avantages des mouvements post-idéologiques ?
À ce stade je pense aux mouvements d’opposition. En effet, l’idéologie peut constituer une très grande force quand il faut mobiliser, d’unifier et galvaniser un mouvement, en créant un tout unifié, ce qui a son importance dans la prise de pouvoir. Mais, pour cette même raison, l’idéologie risque de se transformer en dogme, et de devenir incontestable au point d’en être également une force répressive. Dans le cas des révolutions arabes, cette dualité apparaît clairement. D’une part, les révolutions arabes étaient de loin plus ouvertes, plus participatives et moins répressives dans leur déroulement que les révolutions antérieures, qui avaient une organisation et un commandement unifié. Une organisation unifiée peut facilement étouffer la diversité et la pluralité, on l’a constaté dans le cas de la révolution iranienne.
Malgré cela, il y avait dans la révolution iranienne un fort élément démocratique, sous la forme de conseils populaires formés par la base dans les quartiers, sur les lieux de travail et les établissements d’enseignement. Mais au niveau de l’État, elle est très vite devenue répressive et s’est mise en devoir de museler l’opposition. Ce type de répression n’a pas eu lieu en Égypte, par exemple, jusqu’en 2013, et la Tunisie est restée relativement ouverte et pluraliste. En fait, c’est comme cela que je me réfère aux deux aspects des « réf-olutions ». D’une part elles sont pluralistes par nature, parce que le mouvement n’est pas obnubilé par la prise du pouvoir d’état ─ beaucoup d’institutions de la société civile, y compris celles qui sont liées à l’ancien régime, demeurent en activité. D’autre part, pour cette raison précise, les forces de la contre-révolution sont bien mieux à même de mener des actions de sabotage et de se regrouper pour restaurer l’ordre ancien.
Pensez-vous qu’un changement significatif est possible au sein de l’ordre mondial actuel, dominé par la pensée postmoderne et post-idéologique ?
C’est difficile à dire. Je comprends la dynamique et les contraintes, mais tout ce que je peux dire, c’est que nous vivons dans une époque où toutes les options sont ouvertes. Il existe peut-être un plus grand potentiel de changement significatif. Pour moi le « changement significatif » doit bénéficier à la majorité des gens défavorisés, que ce soit politiquement, économiquement, racialement ou sur le plan identitaire. Mais je pense que cela ne peut pas se faire si ceux qui veulent réellement le changement ne s’attaquent pas sérieusement à l’idéologie et aux pratiques écrasantes du néolibéralisme. « Post-idéologique » peut signifier que l’opposition au pouvoir n’adhère pas à une idéologie particulière.
Mais la plupart des détenteurs du pouvoir continuent à s’appuyer sur l’idéologie. Le néolibéralisme est devenu une idéologie, une idéologie très puissante, qui montre ces deux aspects que j’ai mentionnés : une très grande force de persuasion, doublée de la très dangereuse faculté de se faire passer pour du bon sens, un mode naturel de pensée et d’organisation de la vie publique. Il est très important d’en faire la critique et de la subvertir, de mettre en lumière ses principes et ses conséquences au plus haut point répressives et inégalitaires. Comme je l’explique dans mon livre, le néolibéralisme a pour effet, à la fois de susciter de la dissidence chez les gens ordinaires, en créant des privations, de l’exclusion et des inégalités ; mais aussi, de déradicaliser la classe politique, en se présentant comme un mode de vie auquel il n’existe aucune alternative. Par conséquent, tout changement éventuel doit se produire dans le contexte de ce régime de pouvoir et de son discours. Si vous l’admettez, vous avez tendance dans l’opposition à jouer selon les mêmes règles et à manier les mêmes concepts. Le néolibéralisme est capable ─ et il est prompt à le faire ─ d’intégrer et d’absorber le radicalisme qui le conteste, en en faisant une marchandise. Il peut glorifier et marchandiser des personnages tels que le Che Guevara, en vendant des posters à son effigie ou des produits dérivés. Il sait même marchandiser les révolutions. Cette tendance remonte aux émeutes contre Milošević en Serbie, quand certains idées ont été développées pour rendre la révolution chic, branchée ou sexy.

Que pouvons-nous apprendre du « Moment Tahrir » ?
Pendant ces dix-huit journées, Tahrir a défini la politique d’en bas pour le monde entier. Mais la question qui se posait était celle-ci : comment est-il possible, de façon durable, de faire entrer cette politique dans les relations sociales et les institutions, et de l’y maintenir jusque dans les périodes normales, ordinaires, post-révolutionnaires ? Je me demandais aussi s’il y avait (de la part de certains) une réflexion pour faire durer ce moment révolutionnaire, ou si ce n’était qu’un moment éphémère et fugace dans le long processus de la mobilisation révolutionnaire.
Il est important de réfléchir maintenant sur ce Moment Tahrir, et très pertinent de le documenter et d’y penser, et de s’en servir comme d’une ressource historique, politique et même morale à utiliser pour imaginer un avenir différent. Les événements de Tahrir nous ont transmis un héritage, et il nous faut penser à la manière dont il nous serait possible de prolonger ce moment politique dans l’espace et dans le temps.
Comment l’esprit de Tahrir peut-il revivre dans des environnements différents ?
Cela m’amène à l’idée de la révolution. L’idée, l’idéal et la mémoire de la Révolution doivent être entretenus. Il ne faudrait pas cesser d’en parler, sans jamais la mettre de côté. Nous devrions la considérer comme un projet inachevé, qui pourrait ouvrir des débouchés à l’avenir. Bien sûr, il ne faudrait pas se contenter d’attendre que l’avenir soit là, nous devrions faire en sorte que cet avenir différent soit possible. J’ai le sentiment que certains militants le font, ils lisent, ils réfléchissent sur ce qui s’est passé, et ce qui aurait pu être fait. L’histoire de pays comme l’Égypte ou la Tunisie ne dure pas que quelques années, il y a devant nous beaucoup de générations à venir. Je ne me laisserai donc pas démoraliser par le fait que la situation politique d’aujourd’hui est réellement déprimante, et que c’est le cas globalement. N’oublions pas que, sur le temps long, et même de notre vivant, des régimes politiques naîtront et disparaîtront, mais que les pays et les sociétés leur survivront. Il est donc impératif que nous agissions sur nos sociétés, et cela, c’est possible. Une société forte et consciente, qui attache de la valeur à l’égalitarisme, à l’intégration et à la justice sociale sera capable de socialiser, et même d’acclimater, et de mettre au pas les États et leurs sbires. Il y a donc beaucoup de travail à faire et de réflexion à mener.
Traduit par Jacques Boutard (Tlaxcala)
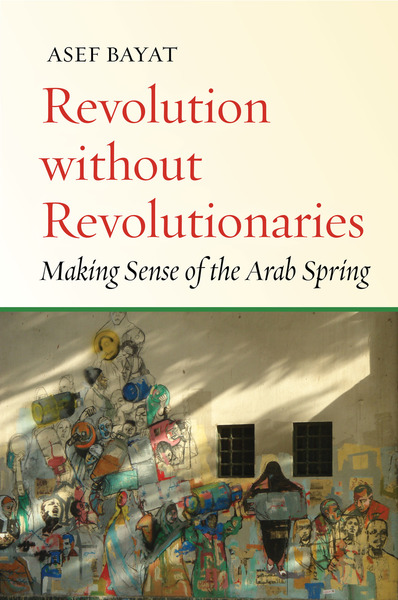 Revolution without Revolutionaries. Making Sense of the Arab Spring
Revolution without Revolutionaries. Making Sense of the Arab Spring
Asef Bayat
SERIES : Stanford Studies in Middle Eastern and Islamic Societies and Cultures
August 2017, 312 pages.
Cloth ISBN : 9780804799027 / Paper ISBN : 9781503602588 / Digital ISBN : 9781503603073

