Lorsque les femmes s’emparent de la caméra à l’époque de la « deuxième vague », elles révolutionnent le cinéma.
Prenons la revendication primordiale de l’égalité des femmes et des hommes. Pour y parvenir, les féministes de la « deuxième vague »1 s’emparent des caméras comme d’un outil de lutte. Mais cela fait mauvais genre. Le genre de cinéma a pourtant tout à voir avec la manière dont on nous regarde, pourraient proclamer les militantes. Alors qui parviendra à bousculer les codes ?
Dans l’une de ses performances, Barbara Hammer, cinéaste expérimentale américaine, surgit de derrière un écran de cinéma en le transperçant d’un couteau. Bousculant la·le spectateur·trice habitué·e à rester tranquillement assis·e face à l’image, elle l’invite à se déplacer autour d’une forme sphérique pour visionner l’œuvre. Lorsque les femmes s’emparent de la caméra à l’époque de la « deuxième vague », elles révolutionnent le cinéma.
Les genres cinématographiques classiques sont destinés à un « genre » – féminin ou masculin. Ainsi du western et du mélodrame – le western visant un public masculin, le mélodrame apprécié d’une audience féminine. Les codes de ces genres cinématographiques évoluent selon les lieux et les époques en interaction forte avec les représentations sociales. La télévision, le documentaire et le cinéma expérimental jouent de ces normes avec une plus ou moins grande liberté. À travers quelques films programmés en 2016 aux Rencontres du cinéma documentaire de Montreuil et à Entrevues à Belfort, cet article explore la manière dont les féministes ont cherché à se libérer des normes de genre.
Les yeux revolver
Les femmes cinéastes opèrent d’abord une première inversion : elles expriment leur vision de la féminité, massivement représentée à travers des regards masculins. Deux territoires cinématographiques autorisent particulièrement cette efflorescence : le documentaire et le cinéma expérimental.
Le combat pour la légalisation de l’avortement est le sujet du film Regarde, elle a les yeux grands ouverts en 1980. Les femmes du Mouvement pour la Libération de l’Avortement et de la Contraception (MLAC) ont demandé à Yann Le Masson de le co-réaliser avec elles. Écrit à partir de faits réels, il est rejoué par les femmes qui les ont vécu. Ce documentaire scénarisé intègre ainsi des formes allant de la fiction au cinéma direct. Chaque genre semble convoqué pour faire référence à une vision du monde particulière, dont il semble son vecteur logique, implicite.
Deux séquences de fiction représentent le contexte de la société patriarcale. La première montre une femme désemparée prendre le bus. Une voix intérieure renseigne sur la cause de son trouble, choisir d’avorter ou de garder l’enfant qu’elle porte. Plus loin, une militante prépare le repas à son mari et à ses enfants dans un cadre domestique traditionnel qui surprend de la part d’une militante du MLAC. Ces séquences incarnées avec distance soulignent la difficulté à négocier avec les attendus sociaux liés à la maternité.
À l’opposé, les séquences en cinéma direct soulignent le rôle révolutionnaire des militantes féministes. Réunions, débats et manifestations sont filmés de la même manière que la foule supportant Salvador Allende en 1973 au Chili : lorsque six femmes du MLAC sortent du tribunal où elles ont été condamnées pour avortement sur mineure (Procès de 1977), un long travelling parcoure les visages des manifestant·e·s avant que la caméra n’attrape au vol celle qui parle au micro. Ce cinéma direct souligne l’importance de chacun pour créer un mouvement collectif. Il porte la signature de Yann Le Masson ; mais lorsque celui-ci privilégie certains personnages ou cherche à héroïser les militantes, il s’écarte parfois de la philosophie du MLAC, qui attache une importance extrême à ne mettre en place aucune domination.
Les séquences présentant le mieux l’idéologie de la Commune2 sont celles dont la forme s’invente au plus près de la vie quotidienne et des combats. Écrit collectivement, le scénario reflète l’esprit de leur pratique. Il aborde d’abord les conditions dans lesquelles les femmes recourent à l’avortement, puis dessine un parcours de maîtrise progressive de leur corps, de leur autonomie, de prise de conscience de leur capacité de réflexion et d’action politique, pour s’achever par un accouchement heureux. Les femmes du MLAC veulent donner naissance lorsqu’elles le peuvent, dans tous les sens du terme – affectif, matériel, mental…
Un choix formel majeur découle naturellement de la pratique du MLAC : le corps est complètement dévoilé. Un gros plan fait apparaître le col de l’utérus lors d’un avortement. Or à l’époque, les féministes débattent de la question de la nudité en cherchant à s’opposer au « regard du mâle » sur le corps féminin3. Deux choix se dessinent : celui d’assumer une nudité parfois radicale tout en en transformant les modalités, ou celui de ne jamais dévoiler le corps. Ici, le choix du dévoilement a d’abord un objectif pédagogique. Montrer les étapes de son avortement à Martine à l’aide d’un miroir lui permet de maîtriser au mieux la douleur physique et morale qu’elle engendre. Dans le cas d’un accouchement, une femme peut alors accueillir elle-même le nourrisson. Yann Le Masson est derrière la caméra, mais c’est bien le regard de la femme sur son propre corps qui construit le découpage lorsque la pratique du miroir est traduite par un gros plan. D’autre part, cette nudité est celle d’un « corps parlé »4, c’est-à-dire soulagé de ses maux par des mots pour évoquer la douleur physique et morale, par des gestes qui accompagnent et soutiennent, s’éloignant d’une conception uniquement organique de l’accouchement ou de l’avortement. Le scénario souligne ce rôle de la parole dans un processus de libération individuelle. L’image insiste sur l’émotion des regards, les discussions collectives qui permettent les décisions individuelles. En jouant leur propre vie devant la caméra, les membres de la Commune revendiquent la pleine responsabilité de leur choix.

Regarde, elle a les yeux grand ouverts, 1982 © Les Films du Grain de Sable
Avorter ou donner naissance, vivre en famille ou en communauté : Regarde, elle a les yeux grand ouverts jongle avec les formes au profit d’un appel à la liberté : la fiction est utilisée comme support d’une représentation de la famille traditionnelle ; le cinéma direct exprime l’action militante ; le scénario, le découpage et le montage du documentaire permet de substituer au regard de l’homme sur la femme un regard de la femme sur son propre corps. Une telle réappropriation à l’image du corps de la femme se trouve à la même époque dans le cinéma expérimental.
« C’est ainsi que voient les grenouilles »
Barbara Hammer exprime ainsi l’apparition à l’écran d’une subjectivité jusqu’ici non représentée. Les féministes françaises s’inspirent beaucoup des livres et films parus aux Etats-Unis. Leurs revendications sont proches. Barbara Hammer, invitée des Rencontres du cinéma documentaire de Montreuil en 2016, raconte qu’elle a eu du mal à trouver sa place dans le cadre de l’université de cinéma en Californie. Elle a donc filmé pour elle, avec une petite caméra, ce qu’elle vivait dans le milieu lesbien. « Une vie expérimentale demandait un cinéma expérimental » explique-t-elle. Il s’agit de parvenir à se connaître en tant qu’individu alors même que l’on a été forgé par les normes du féminin ou du masculin — le « regard du mâle » attribuant la naissance du désir au fait de regarder chez l’homme et d’être regardée chez la femme. Les féministes identifient ces normes, font reconnaître les (dé)raisons sociales de leur fabrication et luttent contre leur imposition. Mais ce travail critique se heurte parfois à l’écueil de réaffirmer une séparation entre femmes et hommes déjà trop ancrée. Barbara Hammer suit donc plutôt la philosophe Judith Butler5 en privilégiant ce que les queer « font avec » les normes de genre : elles et ils « font quelque chose de ce moi qui est fait par les normes », dit-elle. En révolutionnant le rapport à son propre corps, Barbara Hammer se réapproprie la figure du nu féminin.
Pond & waterfall, film en 16 millimètres réalisé en 19826 est hypersensible à la matière et à ses états. Les feuillages d’un bois se superposent aux eaux du lac qu’il entoure. Barbara Hammer retrouve les qualités plastiques propres à la thématique des baigneuses à la fin du XIXe siècle, mais pour en inverser l’origine du regard et du désir. Deux perceptions opposées, du rugueux contre du liquide, de l’opaque contre du lumineux, s’entrelacent en des lignes communes. Puis la caméra passe sous la surface, explore les bouillonnements et jaillissements d’une chute d’eau à en perdre tout repère. Lorsque l’objectif de la caméra remonte à la surface du lac, la lisière entre l’eau et l’air oscille au milieu de l’écran, le submergeant à chaque vague. C’est en passant du monde hétérosexuel au monde homosexuel que Barbara Hammer découvre la kinesthésie, cette connexion entre les sens de la vision et du toucher. Elle tourne une seconde fois les images sous-marines du film en ralentissant la caméra de 24 à 4 images par seconde : en démultipliant ainsi la puissance d’exploration de la vision, elle nous laisse le temps de ressentir pleinement cette sensation kinesthésique. L’érotisme procède chez Barbara Hammer non plus du regard du peintre masculin sur le corps féminin, mais de la baigneuse elle-même, qui exprime par le biais de sa caméra la sensualité de son bain en pleine nature. « C’est ainsi que voient les grenouilles » résume-t-elle.
 Frantisek KUPKA (1871 – 1957) L’eau 1906 – 1909 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, dist. Rmn-Grand Palais / Droits réservés © Adagp, Paris 2015
Frantisek KUPKA (1871 – 1957) L’eau 1906 – 1909 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, dist. Rmn-Grand Palais / Droits réservés © Adagp, Paris 2015
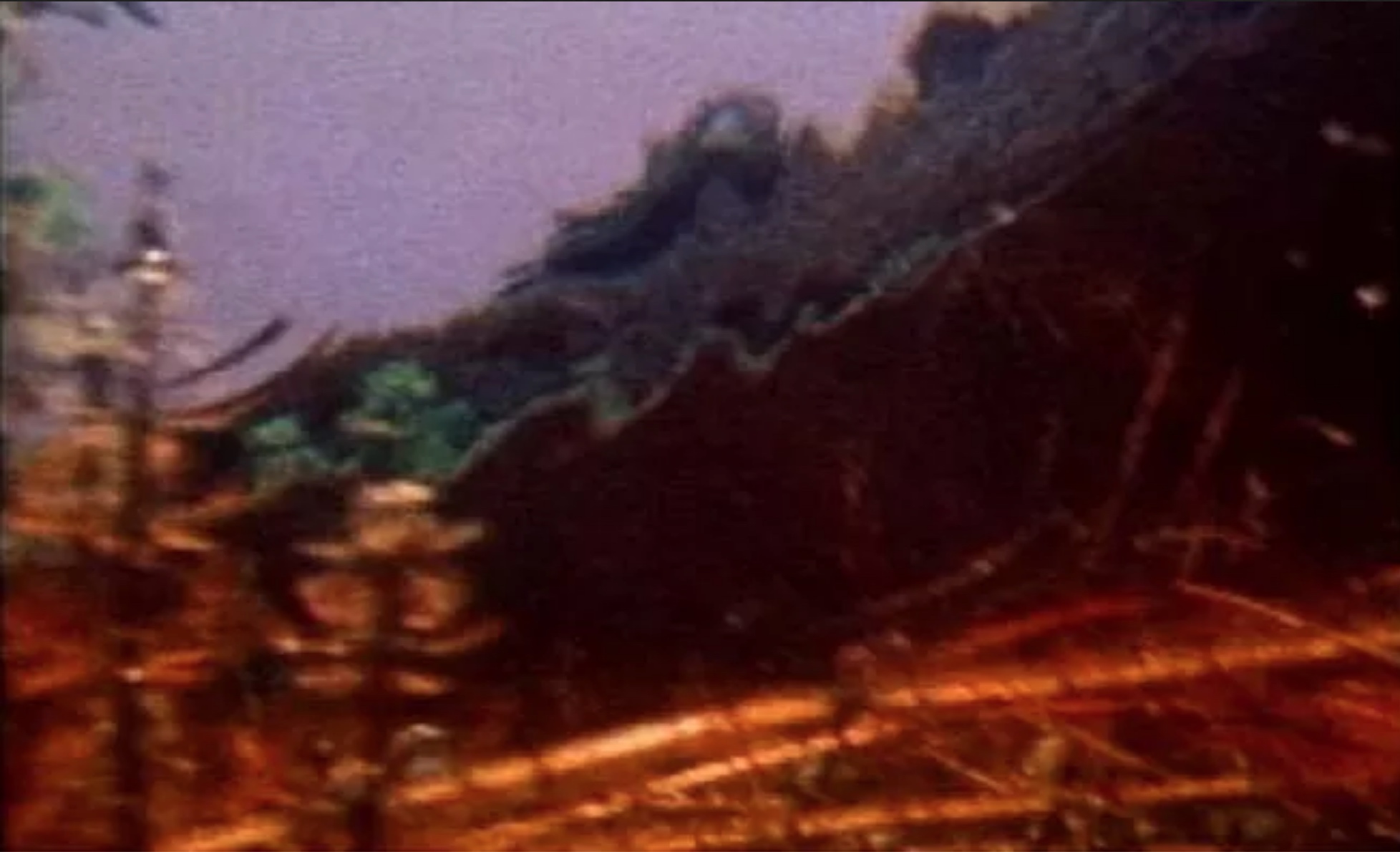 Barbara Hammer, Pond & Waterfall, 1983 © Distr. Light Cone
Barbara Hammer, Pond & Waterfall, 1983 © Distr. Light Cone
En partageant ainsi sa propre sensibilité, Barbara Hammer propose de passer du regard sur l’autre au regard sur soi, de privilégier l’art du contact à celui de la distance. La filmeuse propose à la filmée de n’être plus l’objet du sujet filmeur, mais son propre sujet filmant !
Un cinéma de la sollicitude
Ces représentations nouvelles du féminin naissent le plus souvent dans des territoires alternatifs à l’industrie médiatique ou cinématographique. S’opposant à ces univers professionnels très hiérarchisés, de nombreuses féministes débusquent les mécanismes de domination et inventent ce que Fabienne Brugère, à la suite de Carol Gilligan, propose d’appeler une éthique du care.7 Hélène Fleckinger étudie les collectifs féministes français. Leurs pratiques prennent le contre-pied du fonctionnement du milieu cinématographique, y compris des groupes militants où elles restent sous-représentées. Leur mode de production est collectif et horizontal. Seule la vidéo légère répond à « une exigence politique de prise de parole et de réappropriation de leur corps par l’image ».[Hélène Fleckinger, « Une caméra à soi : quand les féministes s’emparent de la vidéo », in : Ouvrage collectif, Caméra militante : Luttes de libération des années 1970, 2010, p. 34 – 35.]] La pionnière [Carole Roussopoulos raconte : « Les femmes se sont emparées de tous les postes de travail. Il n’y avait pas de division entre travail intellectuel et manuel / technique, et donc pas de hiérarchie, y compris entre les sexes. »8 La frontière entre technicien·ne et artiste est remise en cause. Destituant la suprématie de l’auteur·e, la signature individuelle d’un film est remplacée par une liste de prénoms sans nom de famille.
Ces collectifs veulent filmer « de l’intérieur » pour s’opposer aux médias qui filment « de l’extérieur ». Pour ne pas être terrorisant, l’enregistrement des témoignages peut être séparé de l’image et se faire sur la durée. La même longueur caractérise la fabrication de l’image : les bandes sont montrées à celles et ceux qui sont filmé·e·s et peuvent être refaites à leur demande. Carole Roussopoulos explique pourquoi : « Dans mes films je demande aux gens de se donner le plus sincèrement possible, d’approcher la vérité […] Je considère que ces images et ces sons, ces tranches de concentration ou de vérité, appartiennent aux personnes interviewées plutôt qu’à moi. Moi, j’ai envie de faire des films avec elles […] mais ce sont les gens filmés qui se donnent. […] La fille qui a accepté que l’on filme son avortement dans Y’a qu’à pas baiser (1971 – 73), alors que la pratique était illégale en France, a fait preuve d’un sacré courage ! »9.
La déconstruction de la hiérarchie du tournage, la pratique collaborative permettent à chacun·e, quel que soit son rôle, une juste expression de soi. Les cinéastes expérimentales américaines comme les militantes féministes françaises forgent à travers pratiques et représentations une éthique de la sollicitude qui pourrait bénéficier à la société dans son ensemble. Mais puisque cette révolution suscite des réactions hostiles et une forte répression, les féministes doivent passer à l’offensive.
« Il y a un moment où il faut sortir les couteaux »10 La deuxième vague féministe amène des progrès législatifs et une vaste prise de conscience, en particulier chez les femmes, de l’inscription dans la vie quotidienne d’un système de domination masculine. Mais elle suscite également des réactions anti-féministes virulentes. L’ironie misogyne de la télévision, la résistance des représentations dans la fiction et l’effacement de la contribution des femmes au cinéma sont trois exemples de cet anti-féminisme.
La réaction misogyne de la télévision est parfaitement illustrée par une émission de Bernard Pivot. Au prétexte de commenter la fin de l’année de la femme, thématique choisie par l’ONU en 1975, celui-ci invite Françoise Giroud, secrétaire d’État à la condition féminine. Mais il construit minutieusement un piège autour de son invitée. Mis dans la confidence, des hommes médiatiques surjouent le machisme dans des interviews. Sur le plateau, les invités cisèlent leurs plaisanteries. Le dossier de l’émission, lourd de deux cent pages, a été fignolé. Seule femme sur le plateau, Françoise Giroud semble, elle, découvrir le ton de l’émission devant les caméras. Bernard Pivot lui présente sa collection de discours misogynes en guettant sa réaction scandalisée. Françoise Giroud refuse de répondre au premier degré, au risque d’être vue comme manquant d’humour et de distance et retourne l’ironie à Bernard Pivot en feignant à son tour d’assumer certains des propos proférés par les « fieffés misos » pour mieux en montrer l’idiotie sinon la grossièreté. Lorsque Christian Guy profère : « Les femmes font de la cuisine mais ne font pas la cuisine ! […] Les femmes n’ont pas de talent, sinon on verrait un Bocuse femme […] Chef n’a pas de féminin, vous allez dire une chefesse ? », elle rit et répond : « C’est bien connu, vous rentrez chez vous, vous n’avez jamais mangé un dîner correct ! ». Ce jeu devient vite exécrable et on sent Bernard Pivot, surpris par le tour que prennent les échanges, défendre de manière moins factice les femmes alors que Françoise Giroud mêle à ses molles réparties des opinions inadmissibles : « Pour parler sérieusement, les conditions dans lesquelles on fait la cuisine quand on est chef dans les grands restaurants sont presque intolérables physiquement pour une femme. »

Maso et Miso vont en bateau, Les Muses s’amusent, 1976 © Centre audiovisuel Simone de Beauvoir
En 1976, le pamphlet Maso et Miso vont en bateau reprend de longs extraits de l’émission pour les déconstruire. Les Muses s’amusent, collectif composé de Nadja Ringart, Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Ioana Wieder interrompt l’émission par des cartons, des voix off ou en se filmant réagissant devant la télévision. Devant l’affirmation de Françoise Giroud, elles fulminent : « Et au conseil des ministres ? ». « Les hommes font la cuisine rentable, les femmes font de la cuisine gratuite » répliquent-elles aux propos de Christian Guy. Par le montage parallèle, Les Muses s’amusent font barrage à une avalanche de clichés. La simplicité des moyens du collectif renforce sa portée critique : au contraire de Bernard Pivot, un petit poste de télévision, un tableau et une craie suffisent aux quatre réalisatrices pour s’offrir une place d’où vilipender le machisme.
Cette attaque en règle du discours télévisuel résonne au-delà d’un simple exercice. Françoise Héritier11 montre à quel point la construction de l’inégalité entre femmes et hommes est basée sur ces clichés que l’on balaye souvent comme étant de peu d’importance. La pratique de bon aloi d’un humour misogyne dans un média puissant prouve le manque de considération accordée à la parole d’une femme publique.
« Non, les femmes ne sont pas des hommes sans queue ni tête »12
Cet anti-féminisme assumé de la télévision transparait également dans les films de fiction grand public. Les représentations d’une société patriarcale sont tellement sédimentées qu’on en retrouve les traces partout. Leur persistance est d’autant plus frappante que le cinéaste affirme renouveler les normes de genre dans un sens féministe.
À Cuba, la fresque historique Lucía d’Humberto Solas (1968) dessine la libération des femmes à travers trois figures. Après la Lucía bourgeoise en 1885 et la Lucía militante au cœur de l’échec de la révolution de 1932, la Lucía illettrée des années 1960 s’affranchit d’un mari machiste grâce à la politique d’alphabétisation du régime castriste. Dans cette relecture marxiste de l’histoire cubaine, la première Lucia se sent enfermée dans les conventions rigides de la bourgeoisie. Prête à s’écarter des règles, elle tombe amoureuse d’un séducteur qui la manipule. Son aliénation est personnifiée dans la fiction par une folle errant par les rues et cherchant sans succès à la mettre en garde. Le montage rapide, les travellings tournant la montrent aux prises à une spirale de passion, de jeu, puis de mort : toute à ses sentiments, elle révèle la cache des indépendantistes à celui qui s’avère être un indicateur. Sous prétexte de dénoncer l’esprit patriarcal de la bourgeoisie, le réalisateur mise sur le cliché qui suppose que chez les femmes, les passions dominent la raison. Or ni la deuxième ni la troisième Lucía ne nuanceront cet essentialisme : la Lucía paysanne des années 1960, après avoir bravé son mari qui l’enfermait et la battait, revient vers lui à la fin du film.
Quelques années plus tard, en 1971, le film Klute d’Alan Pakula cherche à faire évoluer les codes du film noir. Après-guerre, Hollywood voulait ramener les épouses et les mères dans le giron domestique. Leurs maris partis au front, les femmes seules avaient goûté une liberté nouvelle, avaient dû travailler et s’étaient parfois engagées dans la résistance. La femme fatale des années 1950 recouvrait cette émancipation féminine d’une odeur de soufre. Dans Klute, la femme fatale est une call-girl, Bree Daniels, indépendante et sexuellement libérée. Le rôle est confié à une actrice féministe, Jane Fonda, engagée contre la guerre du Vietnam au moment du film. Le réalisateur se veut « réaliste » et « progressiste », mais en traitant la libération sexuelle par le biais de la prostitution, il a beau jeu de retourner l’indépendance financière de Bree en piège, l’impression de domination qu’elle tire de ses relations aux hommes en fragilité psychologique. Dans son thriller maîtrisé tourné dans les quartiers populaires de New-York, Alan Pakula fait le procès de la libération sexuelle.
Bree prend en charge, fait rarissime, une partie de la narration. Dotée de scènes où elle est l’unique protagoniste, son point de vue apparaît également à travers une voix off récurrente. Pour son métier, elle enjoint ses clients à réaliser avec elle tous leurs fantasmes, faisant fi de toute morale. Elle méprise et provoque Klute, un puritain en quête de la vérité sur le meurtre de son ami. Surtout, Alan Pakula évite une mise en scène axée sur le « regard du mâle ». Nous voyons Bree regarder Klute autant que Klute la regarde. Lorsque celui-ci observe Bree, c’est de loin, attentif à la pièce où elle vit tout autant qu’à ce qui se trame autour d’elle. Cette forme d’égalité dans le champ/contrechamp est soulignée par un axe de profil absolument médian lorsque les deux personnages sont face à face.
Mais les forces de Bree sont anéanties par le cours du thriller. Bree, que l’on voit d’abord dominer ses clients, devient la proie de l’un d’entre eux. Le désir qu’elle suscite devient donc destructeur et mortifère. Adrienne Boutang13 note combien les phrases qu’elle répète à ses clients, « il ne faut pas avoir honte » ; « j’ai beaucoup d’imagination et aucun jugement moral », deviennent lorsqu’elles sont enregistrées et repassées en boucle un motif de plus en plus négatif, manipulé par le pervers lui-même lorsqu’il cherche à tuer Bree. À ce leitmotiv faussement libérateur, le réalisateur oppose la parole de Bree au cours de ses séances de psychanalyse. Sa satisfaction à contrôler ses rapports aux hommes et à en tirer un profit financier n’enlève rien à son sentiment d’enfermement dans la prostitution. Outre les cadres, de multiples grilles le signifient à l’écran.
Bree est représentée comme un personnage ambivalent, qui utilise son charme pour faire souffrir les hommes, mais dont l’insensibilité n’est qu’une armure cachant une profonde détresse intérieure. Elle interprète son personnage de call-girl comme elle le ferait d’un autre rôle de théâtre : les valeurs qu’elle brandit, la nécessité de briser les tabous et de s’autoriser toute liberté n’est qu’un discours creux mis en accusation par Klute, le véritable héros. Sa pudeur, son intégrité et sa bienveillance lui permettent de devenir le protecteur de Bree, de gagner sa confiance et son amour et de partir avec elle à la fin.
Ce héros austère est étrangement dénué de tout désir pour Bree. Seul l’anti-héros, le tueur pervers, exprime toutes ses pulsions et les exacerbe par sa traque. Alors que l’un est doux, l’autre bat les prostituées qu’il paye. Lorsque Bree voit Klute pour la première fois, il est un visage flou à travers l’oculaire de sa porte. À la fin du film, Bree se confronte au tueur. Elle aperçoit un visage flou masqué par l’obscurité et les penderies de vêtements de l’usine où elle s’est réfugiée. Les deux plans, cadrés de la même manière, rendent les visages presque identiques. Le pervers est le double de Klute, la représentation de ses désirs inconscients. Meurtrier et commanditaire de l’enquête, il tire toutes les ficelles du scénario. Alter-ego de Klute, il pourrait bien être également celui du cinéaste. En caméra subjective, on le perçoit en train d’épier sans cesse Bree, dans une forme aggravée du « regard du mâle ». Du haut d’un gratte-ciel, dans son bureau opulent, il réécoute en boucle la voix enregistrée de celle qu’il désire… Cette figure de prédateur, blanc, riche, homme d’affaire est la caricature de la domination masculine dénoncée par les féministes. Or Alan Pakula a choisi en Jane Fonda une militante. À travers Klute et le tueur, Alan Pakula semble s’auto-analyser entre Docteur Jekyll et M. Hyde. Comme s’il tuait lui-même ses penchants au voyeurisme à la fin du film…
Pour la critique féministe Christine Gledhill, l’indépendance financière et sexuelle de Bree est représentée comme une menace pour la maîtrise masculine du monde.14 Alan Pakula semble rétorquer aux féministes qu’elles ne peuvent utiliser le désir qu’elles suscitent chez les hommes pour les manipuler. Nancy Huston souligne également une contradiction entre le rôle rôle – qu’elle prétend biologique – du regard chez l’homme et l’envahissement d’effigies de beauté féminines à travers la photographie et le cinéma.15 Klute reste une réaction violemment antilibérale : au moment où les femmes revendiquent elles aussi de « jouir sans entraves », faire jouer à une actrice féministe le rôle d’une prostituée permet de dévoyer le combat pour la libération des mœurs.

Klute, Alan Pakula, 1971 © Warner Bros

L’une chante, l’autre pas, Agnès Varda, 1976 © Ciné Tamaris
Si l’univers de la fiction ne ressemble pas à notre monde, il est pourtant fondamental dans la manière dont on le regarde. Ses modèles d’identification autorisent quotidiennement le renouvellement des comportements et le renforcement des modèles. Or, il suffit qu’Agnès Varda réalise une fiction, L’une chante, l’autre pas, en 1976, pour que les féministes puissent s’y reconnaître.
Un photographe vit pour l’art sans parvenir à nourrir sa famille. Sa femme Suzanne assume le quotidien et élève leurs deux enfants. À l’annonce d’une troisième grossesse, il se suicide alors que Suzanne venait juste de réunir la somme nécessaire à un avortement clandestin. Aidée par Pomme, feu follet chanteuse et activiste, elle va se battre pour réussir à vivre pleinement de nouveau. L’amitié des deux femmes grandit à travers leur combat pour le droit à la contraception et à l’autonomie. Le film d’Agnès Varda, classé de manière improbable comme un « drame » sur IMDb, est plus justement décrit par Arte comme un « musical féministe », inaugurant un nouveau genre où les femmes peuvent être libres sans être ni traîtres à leur cause, ni fatales à l’organisation sociale !
Agnès Varda et quelques autres figures de réalisatrices mises à part, le féminisme fut difficilement soluble dans le cinéma de « genre » et la télévision.
Une opportunité perdue
Au même titre que le néoréalisme ou que le Nouvel Hollywood, le septième art devrait compter le cinéma féministe comme une grande époque qui, en bouleversant la hiérarchie des normes de genre, crée l’opportunité de pratiques et de représentations plus horizontales. Mais puisqu’elle s’est traduite par une lutte « contre » les institutions et les pouvoirs patriarcaux, cette contribution a été combattue, dévalorisée et cantonnée à un territoire situé.
Les cinéastes marquantes de cette période ont d’abord été en partie oubliées, leurs contributions reléguées. Le cinéma d’avant-garde américain s’est institutionnalisé comme foncièrement masculin. Ni l’intérêt critique ni les métiers qui les accompagnaient n’ont été accordés aux femmes. Malgré les biais des jurys de l’époque, elles avaient pourtant reçu proportionnellement plus de prix que les hommes.16 En France, la production des collectifs féministes n’a pas fait l’objet d’un travail d’archivage et de conservation. Les militantes elles-mêmes ont souvent refusé le dépôt légal ouvert à la BnF en 1977, car il était à leurs yeux le lieu d’une censure masculine. D’autre part, leur éthique de l’action collective et de l’anonymat, afin de lutter contre le statut de « l’auteur·e », a complexifié le travail des archives.
La naissance des festivals et des journaux consacrés aux femmes cinéastes, aux alentours de 1972 – le First international festival of women’s films à New York, le Women’s event à Edimbourg – avait pour but de rendre visible cette exclusion par les institutions. Le principe de la non-mixité féminine répond à la non-mixité masculine qui règne de fait dans les lieux de pouvoir, ouvrant des possibles, libérant des énergies ailleurs réprimées. Cette méthode de lutte risque l’essentialisme : une forme de catégorisation du cinéma « de femme » échouant à questionner le mécanisme de la discrimination elle-même. L’effacement ou le cantonnement à un territoire « genré » montrent combien la profession a peu intégré les apports du féminisme.

Livre d’or de l’exposition Féminimasculin : le sexe de l’art, Paris. Centre Pompidou, 26 oct. 1995-12 février 1996, Fonds Nathalie Heinich
Le fleurissement actuel de programmations sur le féminisme apparaît comme une re-consécration de cette parole militante. Les interventions contre le droit à l’avortement, l’essor des discours fondamentalistes religieux justifient ces programmations. Après la réaction violente du cinéma de genre et de la télévision des années 1970 et 1980, les signes d’un changement de paradigme se multiplient – le récent Wonderwoman, réalisé par Patty Jenkins (2017) l’indique. L’évidence qui habitait les regards laisse place progressivement à un constant dédoublement à l’écran du signifiant et du signifié. Les causes de ce tournant dans la représentation sont multiples. La fin de cet article se concentre sur le moment tardif, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, où le cinéma de fiction commence à remettre en cause certains de ses clichés. Cette avancée des revendications féministes est passée par la transgression des limites d’un genre cinématographique – précisément par la transmission de formes expérimentales à certain·e·s cinéastes de fiction. Or ces films sont rendus nécessaires afin de créer une représentation plus juste de vies jusqu’ici pas, peu ou mal représentées : celles des homosexuelles17.
Les luttes LGBT ont favorisé l’investissement du cinéma de genre par les préoccupations liées à l’égalité des droits. Avec d’autres pensées de résistance des années 1980 comme les études de genre, le post-colonialisme ou la critique féministe du cinéma, ce mouvement a pu constituer le vecteur puissant pour penser une évolution positive des représentations. Ces préoccupations majeures partagées par Barbara Hammer invitent à examiner comment le cinéma queer18 a pu proposer une démarche fondamentalement trans-genre.
Cinéma expérimental vs cinéma de genre
La définition première du mot queer – étrange, bizarre – rappelle à quel point le regard posé sur l’homosexualité fut longtemps horrifié. Transformer ce soupçon d’anormalité ou de déviance en tolérance puis en acceptation est un enjeu pour les minorités sexuelles.
Or ce regard sur l’homosexualité est largement (in)formé par le cinéma mainstream. Figurée sous le masque du crime dans les années 1920, l’homosexualité est une transgression chèrement punie par la narration classique hollywoodienne. Plus fréquente dans les films des années 1970, elle reste condamnée au suicide ou au malheur. Il faut attendre le début des années 1990 pour que lesbiennes et gay deviennent personnages principaux et aient droit au happy end. Acceptant les caricatures imposées par la morale d’une époque, certains cinéastes mettent à leur profit l’anti-conformisme attribué aux personnages déviants pour mieux traduire la liberté dont dispose chacun·e d’inventer sa propre identité. La vie berlinoise des années 1920, où s’invente un ensemble de signes de reconnaissance, permet par exemple de décoder un cryptage homosexuel autour de la figure du Nosferatu de Murnau (1922).19
Contre le cinéma mainstream, le cinéma expérimental ne cesse d’exprimer ses questionnements sur les normes de genre et les mécanismes d’oppression qu’ils autorisent. Lorsque le féminisme de la « deuxième vague » a été relégué à des territoires « situés », les féministes radicales ont inscrit la séparation d’avec les hommes comme un impératif afin de lutter contre la société patriarcale. Ce séparatisme a animé nombre de communautés lesbiennes amenées à vivre les rapports entre désir et pouvoir indépendamment du regard masculin.20 Barbara Hammer met en scène au cinéma ce que l’on ne voit jamais : le clitoris, le désir féminin, l’amour lesbien, les règles… Et fusille les modes de représentation dominants. Elle l’affirme : « Mon travail vise à déconstruire un cinéma qui, souvent, limite la marge de manoeuvre des femmes, voire les réifie. »[[Catalogue des Rencontres du cinéma documentaire de Montreuil, p. 10]] Par l’hybridation formelle – le found-footage ou le collage par exemple – elle détourne les représentations des femmes dans le cinéma ou la publicité. Par le montage associatif ou discontinu, elle prend le contrepied de la narration linéaire des films de genre, et de leurs sujets bien définis qui ramènent le spectateur à la maison, rassurés sur l’état du monde et de la société.21
L’hybridation formelle permet également à Martha Colburn de dynamiter l’obsession de la beauté féminine dans Cosmetic emergency (2005). Tirés de peintures de grands maîtres, de classiques du cinéma comme de simples magasines, des visages de femmes et des corps de soldats subissent la même reconstruction chirurgicale. Au rythme d’un montage effréné et d’une musique rageuse, explosions et bistouris entaillent les visages et les corps. L’artiste, armée de ses seuls pinceaux, travestit un soldat en pin-up, et recouvre les modèles féminins trop uniformes de multiples identités. Lorsque le film s’arrête sur une opération de chirurgie esthétique, avec un plan long, noir et blanc, tout d’un coup silencieux, il a chargé cette tranquillité apparente d’une véritable violence : une forme de négation de l’identité individuelle.

Martha Colburn, Cosmetic emergency, 2005 © Diffusion Light Cone
Au début des années 1990, cette esthétique expérimentale est reprise dans certains films à succès.
Les fictions queer tordent les genres
Parce qu’elles célèbrent un amour homosexuel enfin exempt de condamnation morale, ces fictions remodèlent les conventions de genre si fortement liées au modèle hétérosexuel. Go fish de Rose Troche (1994) présente le quotidien de jeunes femmes lesbiennes et la naissance d’une relation entre Max et Ely. La narration globale est classiquement linéaire, depuis la première rencontre jusqu’à la première nuit passée ensemble. Cependant, le film s’éloigne du romantisme22. Ely n’est pas séduisante. Le moteur de l’action, loin d’être donné d’avance à travers le coup de foudre et les rebondissements du scénario vient des réflexions respectives des deux personnages. Ely doit se battre contre sa timidité et Max apprendre à connaître Ely pour mieux l’apprécier. Des séquences expérimentales favorisent la distanciation du spectateur. Par exemple, Max exprime en voix off sa méditation sur la vie qu’elle aurait eu si elle s’était mariée à un homme. À l’image, la robe de dentelle, le voile et la coiffure de Max mariée sont tour à tour convoqués comme des symboles et démentis par le contexte — les murs de pierre pourraient être ceux d’un night-club, les lesbiennes de la communauté viennent l’embrasser. De même, le flou glamour dont usent les photographes de mariage est tenu à distance par un split-screen et des raccords cuts. Cette séquence évoque First comes love de Su Friedrich (1987). Choisissant d’accompagner les prises de vues de quatre mariages hétérosexuels par des chansons d’amour, ce film expérimental nous plonge dans la féérie, démontrant notre adhésion immédiate à cette icône du bonheur, pour mieux en rompre le charme, en particulier avec des raccords cuts, mais aussi avec la longue liste de pays qui n’autorisent aucune forme d’union homosexuelle. Go Fish, film indépendant à petit budget, obtient une reconnaissance au festival de Sundance et le soutien de la compagnie hollywoodienne de Samuel Goldwyn. « Des films tels que Go fish devinrent des films hybrides à succès et ainsi furent les précurseurs qui permirent ensuite aux thèmes et aux films gays et lesbiens de toucher le grand public, alors que les cinéastes expérimentaux et d’avant-garde tels que Su Friedrich restaient dans le circuit art et essai. »23 Cette fiction queer amène une part de l’iconoclasme et de la liberté du cinéma expérimental vers une audience plus large. Car s’il renonce à la critique politique et à sa tonalité subversive en s’immisçant dans les normes de la fiction de type hollywoodienne, l’esprit queer est efficace à un autre niveau discursif : en brouillant les frontières de genre cinématographique, il met à distance les normes du féminin comme les carcans possibles du masculin.
Cette hybridation formelle est toujours présente, en 2005, dans un western gay réalisé par Ang Lee. Le secret de Brokeback Mountain parvient à associer cette homosexualité masculine aux valeurs de liberté et à l’esprit pionnier de la « frontière » américaine. Pour parvenir à ce retournement, le réalisateur transgresse les codes du western à l’aide de ceux du mélodrame.24
Par une succession d’oppositions et de déplacements – entre nature et ville, entre genre et sexe – le film met à bas l’héroïsme du cow-boy. Ennis et Jack se rencontrent durant l’été 1963, alors qu’ils doivent garder un troupeau de moutons aux abords d’un parc national. Dans une nature magnifiée, Ennis démontre son courage, échappant à un ours, tuant un élan du premier coup de fusil et se portant volontaire pour emmener le bétail paître de nuit à l’intérieur des limites de la réserve naturelle. Cette liberté du hors-la-loi permet à Ennis de vivre sa première nuit d’amour avec Jack, dans une séquence où les codes du mélodrame se mêlent à l’esthétique du western. Couché auprès du feu éteint, Ennis grelotte. Jack l’invite à partager la chaleur de sa tente. Leur portrait psychologique inverse leur capacité d’action : la sensibilité féminine de Jack, qui l’avait réduit jusque-là à la fonction de cuistot, permet leur idylle. Ennis, orphelin, cache ses sentiments derrière une virilité confinant à la violence. Cette division « genrée » entre Ennis et Jack est redoublée lorsque les deux hommes retournent à la ville. Ennis refuse d’exprimer la moindre vulnérabilité : il exclut donc de vivre publiquement son homosexualité. La caméra se resserre sur des espaces urbains et domestiques privés de tout horizon. La narration classique du mélodrame épouse les conflits intérieurs créés par les mariages d’Ennis puis de Jack. Les traits de caractère qui paraient Ennis de qualités dans le western trahissent ses défauts dans le mélodrame. Incapable d’envisager l’égalité des rôles dans le couple, celui-ci fait irruption sur le lieu de travail de sa femme pour lui laisser leurs trois enfants à garder ; il se montre colérique et autoritaire. À l’inverse, Jack fait preuve de respect autant vis-à-vis de sa femme — championne de rodéo — que d’Ennis, lorsqu’il préserve leur relation et cherche à le convaincre de vivre pleinement leur amour.
Ang Lee, dans ce western gay, renverse la hiérarchie entre force masculine et vulnérabilité féminine. Même si le film, pour manipuler les clichés, les souligne parfois à l’excès, il situe le courage du côté de l’intime, la vraie « frontière » du film.

Le Secret de Brokeback Mountain, 2005

Le Secret de Brokeback Mountain, 2005
C’est donc par la collusion entre deux genres que Le secret de Brokeback Mountain déconstruit et critique l’archétype masculin du cow-boy. Dans ce processus, par la subversion d’un côté et la réinvention de l’autre, le cinéma queer permet à un large public de repenser les rôles respectifs du masculin et du féminin dans sa propre vie. « L’intime est politique », clamait un slogan féministe.
SCUM paradigmo
La brèche qu’a constitué l’esthétique queer dans le cinéma de genre est d’autant plus large qu’elle ne concerne plus uniquement la représentation des femmes mais également celle des hommes. Alors que l’antiféminisme perçoit le discours féministe uniquement comme une menace, le cinéma queer permet aux hommes d’envisager le patriarcat comme une limitation de leur propre être-au-monde. Cette critique des codes de la virilité peut provenir d’un homme comme Ang Lee, mais prend des accents différents lorsque la caméra est tenue par une femme. La parité entre femmes et hommes est toujours loin d’être atteinte dans le métier de scénariste et de réalisateur·trice, dans les institutions cinématographiques, les festivals ou les monographies de l’histoire du cinéma. Lorsqu’une femme filme (parfois) un homme, le paradigme majoritaire : un homme réalisateur filme (parfois) une femme se trouve alors alors totalement inversé.
Dans No sex last night (1996), Sophie Calle affirme son désir comme source d’une double aventure : celle qu’elle espère avec Greg Shephard – peu convaincu par la proposition – et l’aventure du film même, dialogue à deux caméras. Alors qu’ils ont rendez-vous pour traverser les États-Unis en Cadillac, le personnage de Sophie doit tout organiser – le personnage de Greg est cloîtré depuis huit jours et n’a rien préparé. Alors qu’elle lui prête de l’argent, il tombe en panne d’essence. Les premiers jours passent. Entre la silhouette lointaine de l’une et le visage tombant de l’autre, un travelling montre leur traversée d’un tunnel. La nuit tombe, Greg conduit, Sophie panote en suivant le reflet des phares sur le tableau de bord. En voix off, elle cite son journal : « À la caféteria, quand je lui ai pris le stylo des mains, Greg a dit : « J’aime quand tu es forte. » Et moi j’ai répondu : « Plutôt que fragile ? », « Oui, plutôt que fragile. » Au plan suivant, une pancarte lumineuse aguiche les clients : « Strip-Tease, 15 jolies, 2 moches. Bonne année ! ». Après que les féministes de la deuxième vague ont voulu faire basculer l’origine du regard et du désir du côté de la femme, et que le queer incite à fluidifier les rôles, cette performance filmée fait rebondir le récit des deux côtés du couple hétérosexuel, jouant sur le constant décalage des perceptions.

Sophie Calle, No sex last night, 1995 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat © ADAGP, Paris © Gregory Shephard
Autre film, même dispositif. La nuit, deux silhouettes discutent à l’avant d’une voiture. La femme évoque des jeux d’enfants avec son cousin. L’homme, immédiatement, se montre soupçonneux et jaloux. Après avoir éteint le moteur et les lumières, il teste la virginité de celle qui va devenir sa femme. Elle pleure.
En Iran, Mania Akbari explore les relations de couple par la fiction. 20 fingers (2004) questionne les rapports entre désir et pouvoir dans le mariage hétérosexuel. Chacune des sept séquences voit le couple embarquer dans un funiculaire, un train, un bateau et si le mari conduit, la femme mène la conversation. Elle attaque une à une les traditions qui l’entravent : l’interdiction de recevoir un autre homme que son mari chez elle, l’absence de contraception qui provoque des naissances rapprochées… Sa résistance cède uniquement devant la force – lorsqu’elle veut quitter la moto de son mari pour prendre un taxi, celui-ci agresse le conducteur.
Ces deux films appellent les hommes à questionner leur attitude. D’ailleurs, l’acteur de 20 fingers, éduqué en Angleterre, refuse sans cesse les indications de jeu au motif qu’il n’agirait pas de cette manière ! Mais s’ils posent le conflit homme/femme comme moteur de la narration, c’est pour mieux le résoudre. Mania Akbari utilise l’inversion des sexes pour provoquer la réflexion sur l’inversion des rôles. Confrontée à une jalousie maladive, la femme évoque son désir de petite fille de devenir un garçon, son désir d’adulte de se comporter comme un homme. Elle provoque son mari en lui avouant une nuit d’amour avec une amie, manifestant sa volonté d’épanouissement. Dans le dernier plan du film, le mari semble avoir changé. Il revient de trois jours d’atelier théâtre et a symboliquement accepté d’expérimenter un autre rôle que le sien.
Ce retournement du paradigme majoritaire est pleinement accompli dans le documentaire Quelque chose des hommes de Stéphane Mercurio (2015). La cinéaste filme des séances de photographies de pères avec leur fils : torses nus, ils sont amenés à se rapprocher physiquement l’un de l’autre, à se toucher, à communiquer… : Quelque chose des hommes nous montre l’impact sur les corps des stéréotypes masculins – du travail de la musculature au tatouage, tout en amenant chaque duo père/fils à adopter des attitudes moins exclusivement viriles. Ainsi, un père porte son bébé dans la posture d’une vierge à l’enfant. Stéphane Mercurio capte l’expression d’un lien filial en train de se réfléchir, parfois empreint de pudeur et de distance, mais où l’affection provoque des gestes sinon des mots. La fragilité et la douceur qui transparaissent de ces portraits réinventent une image du père.
Extrait — Quelque chose des hommes, Stéphane Mercurio, 2015
Les documentaires militants et les films expérimentaux ont disjoint nos regards des normes de genre, en rendant perceptibles certaines injonctions quotidiennes – les femmes auraient une nature maternante et protectrice, détournée de la performance individuelle ; les hommes devraient s’endurcir et se fermer à l’affectivité, danger pour leur réalisation sociale. En déconstruisant ces idées reçues dans quelques fictions à succès, le cinéma queer donne naissance à de nouveaux visages et bouscule l’essentialisme des représentations de la femme et de l’homme pour un large public. Ce simple tremblement des stéréotypes hollywoodien se répercute dans tous les genres. Aujourd’hui une fiction iranienne, un film expérimental comme celui de Sophie Calle, et le documentaire sur la filiation de Stéphane Mercurio inscrivent dans le quotidien des visions renouvelées de l’amant, du mari et du père. Leurs réalisatrices tracent un chemin vers l’égalité. Mais leurs revendications propres à la troisième vague féministe[[La troisième vague féministe depuis les années 1985 valorise le concept d’hybridité de l’identité et l’intersectionnalité, afin d’articuler la lutte pour les droits des femmes avec la lutte contre tout type d’oppression. ]] sont encore minoritaires. Elles prendront d’autant plus d’ampleur que les femmes feront valoir leur vision du monde à égalité avec les hommes. La parité systématique des diffusions télévisuelles, des financements et des prix est pour cela indispensable. Mais elle n’aura de véritable impact que si elle implique un changement de pratiques professionnelles là où la verticalité et la division des tâches domine.
Gaëlle Rilliard / Traverse
- programmation des 21èmes rencontres du cinéma documentaire de Montreuil
- palmarès du Festival international du film Entrevues à Belfort — 2016
- « Avoir la sensation du monde », entretien avec Corinne Bopp, par Gaëlle Rilliard, revue Traverses #1
- Période du féminisme (1968 – 1980) où la lutte pour le droit à l’avortement s’accompagne d’un ensemble de revendications plus larges, en particulier liées à la (ré)appropriation par les femmes de leur propre corps.
- « La Commune » est le lieu de vie d’une dizaine de militant·e·s dans une grande maison à Aix-en-Provence. Communistes libertaires, els cherchent à déjouer les règles de la famille patriarcale.
- Le livre de Laura Mulvey, Visual pleasure and narrative cinema, 1975 analyse la narration classique comme guidée par le « regard du mâle » sur le corps féminin.
- Explication de Martin Goutte, qui a présenté le film aux Entrevues de Belfort en novembre 2016, dans le cadre de la programmation Cinéma et histoire.
- ce que vous voulez référencer
- Film édité dans le DVD Bent time
- Fabienne Brugère : « Faire et défaire le genre : La question de la sollicitude » dans Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc (dir), Trouble dans le sujet, trouble dans les normes, 2009, pages 69 à 88. L’éthique du « care » est théorisée en 1982 par Carol Gilligan.
- Carole Roussopoulos et Hélène Fleckinger, « Marcher le nez au vent » in : Caméra militante : Luttes de libération des années 1970, 2010, p. 117.
- Carole Roussopoulos et Hélène Fleckinger, « Marcher le nez au vent » in : Caméra militante : Luttes de libération des années 1970, 2010, p. 118.
- Citation tirée de la définition de l’opprimé par Christiane Rochefort
- Propos issus du film d’entretien réalisé par Patric Jean, Conversations avec Françoise Héritier, partie III : « Filiation, terminologie, alliance ».
- Citation de Réponses de femmes d’Agnès Varda, programmé dans la Carte Blanche à la cinémathèque française aux Entrevues de Belfort en 2016.
- Présentation du film par Adrienne Boutang dans le cadre du festival Entrevues à Belfort en 2016, dans la programmation Cinéma et histoire : Ceci est mon corps.
- Christine Gledhill, « Klute1 : a contemporary film noir and feminist criticism », in : Kaplan Ann, Feminism & film, pp. 66 – 85
- Nancy Huston, Reflet dans un oeil d’homme, 2012. Voir en particulier le chapitre sur la pornographie.
- BLAETZ Robin, Women’s experimental cinema : critical frameworks BLAETZ Robin, Women’s experimental cinema : critical frameworks, 2007, p. 2, 2007, p. 2
- Cette analyse est détaillée par Barbara Mennel dans son livre Le cinéma queer, 2013, dans ses chapitres 4 et 5 en particulier.
- « Qui s’inscrit dans un ensemble de courants de pensée politisés, axés sur l’analyse et la remise en question des construits sociaux traditionnels et normatifs qui ont trait aux questions de genre, de sexe et de sexualité. » le collectif
- Barbara Mennel, Le cinéma queer, 2013, p. 163
- Au sujet du « séparatisme » lesbien, le témoignage de Line Chamberland est éclairant : « La pensée queer et la déconstruction du sujet lesbien »
Les panthères roses - BLAETZ Robin, Women’s experimental cinema : critical frameworks, 2007, p. 12 et suivantes
- Barbara Mannel, Le cinéma queer, 2013, p.133
- Barbara Mannel, Le cinéma queer, 2013, p.136
- Barbara Mannel, Le cinéma queer, 2013, p.156

