Avec Casque bleu, Marker, en plus d’offrir un témoignage fort sur un pan mal connu de l’histoire occidentale récente, donne avant tout et surtout une magistrale leçon de journalisme et de cinéma.

Casque bleu
1995 — France — 25’20 — Beta sp — Couleur
Diffusé à 20h, sur Arte, le 2 octobre 1995 et présenté dans l’exposition Face à l’Histoire au Centre Georges Pompidou en 1996, Casque bleu[Également intitulé “Confession d’un casque bleu : témoignage” ou “Témoignage d’un casque bleu”.] est un témoignage, le témoignage franc et direct d’un jeune médecin conscrit qui, plutôt que de perdre son temps sous les drapeaux (au temps où cela était encore une obligation), a préféré s’engager en 1994 comme casque bleu pour partir en mission 6 mois en Bosnie, durant la guerre de Yougoslavie (1991 – 2001). Les raisons de ce choix, comme nous l’explique simplement le personnage au début du film, sont multiples et en somme toutes valables : voir, vivre une expérience, être utile, gagner plus d’argent, “échapper à l’enfer de la caserne»”, etc.
Après 6 mois dans la poche de Bihac, François Crémieux est de retour en France. Quel bilan peut-il tirer de son expérience ? Que reste-t-il de ses attentes, de ses projections, de ses fantasmes d’avant départ ? L’expérience a‑t-elle été positive ou négative ? A quoi ça sert finalement un casque bleu ?
Crémieux raconte, plus qu’il ne se raconte. Marker enregistre simplement une voix en filmant en gros plan le visage de ce témoin d’une éloquence rare, qui sait non seulement dire, mais qui a quelque chose d’intéressant à dire. De ce fait, Marker peut s’effacer presque totalement pour laisser la place à cet autre.
Ainsi, écrit Nathalie Mary dans Bref, “le geste de filmer se résume à un seul regard, s’opposant par cette simplicité même à toute manipulation propagandiste largement pratiquée dans les journaux télévisés ou à l’élaboration d’une fiction sécrétant maladresses et ambiguïtés.“1 Avec le procédé du “talking head” (tête parlante) employé ici par Marker et très décrié dans le milieu cinématographie 2, Chris Marker montre que l’on peut très bien offrir une “tête parlante” durant 26 minutes et proposer aux spectateurs un film intelligent et utile., il est “impossible de détourner les oreilles et les yeux en faveur d’une vérité plus douce ou plus accommodante. La parole nous enjoint à (tout) écouter et sa troublante puissance résulte autant de son contenu, que de la manière dont elle se livre.” Nathalie Mary, op. cit.
Mais c’est peut-être Arnaud Lambert qui exprime le mieux la raison de l’effacement de Marker et la place de Casque bleu dans sa filmographie.
“Le recours massif aux témoignages est un élément caractéristique de la cinématographie markerienne de ces vingt dernières années. Il doit être abordé sous l’angle de l’interlocution et du dialogue. Le témoin qui décrit et partage son expérience s’adresse à nous. C’est ce qui rend sa présence intimidante — accablante : visage ou regard qui témoigne, mais aussi questionne. Le témoin suppose toujours un auditoire — le spectateur, mais aussi l’historien, l’instructeur, le juge. Auditoire qu’il renseigne et bouleverse tout à la fois, qu’il interpelle ; le témoignage est un discours transitif (le témoin prend à témoin). De fait, le témoignage traverse l’écran (le film, l’auteur) et se répand comme un cri. La parole filmée, le filmage du témoignage serait ainsi, pour Marker, un moyen de s’effacer, d’abdiquer la posture surplombante qu’on lui a si fréquemment reprochée, et de n’être plus, par ce retrait, qu’un médiateur ou un passeur (stalker) d’expérience, d’histoires, d’Histoire.“3
En effet, avec Le Joli mai, premier film “d’interviews” de Marker, ce dernier s’est vu reprocher d’avoir, par son montage et les questions posées, ridiculisé, voire trompé, les personnages qui témoignaient et s’exprimaient devant sa caméra avec la plus grande sincérité et un brin de naïveté. Chris Marker y était, en somme, trop présent, même s’il n’apparaît pas à l’écran.
Dans le cas de Casque bleu, c’est l’inverse. L’interview est fragmentée en 19 sections plus ou moins chronologiques : “Raisons”, “Images”, ““Briefing”, “Histoire”, “Bousniouks”, “Agresseur”, “Mission”, “Motivation”, “Engagés”, “Obéissance”, “Chiens”, “Guerre”, “Mort”, “Demi-tour”, “Politique”, “Mensonge”, “Positif”, “ONU”, “Bilan”.
Le montage est simplifié à l’extrême. La voix de Marker, les questions, sont coupées. Casque bleu, c’est François Crémieux, son visage, sa voix et quelques photos “souvenir” saisies lors de sa mission. La place de Marker se limite donc volontairement aux cartons des 19 sections, mais aussi et surtout à la transmission. Quelqu’un à quelque chose à dire, Marker lui donne la possibilité de s’exprimer, comme il l’a fait pour ouvriers de 68 ou pour les jeunes réfugiés bosniaques du 20 heures dans les camps, suivant encore et toujours le modèle de l’expérience du ciné-train de Medvedkine.
Si on replace ce film, dans la filmographie de Marker, il entre pleinement dans sa vision de ce que devrait être la télévision. Détour Ceauscescu (1990) est une critique acerbe et sans concession du Journal télévisé. Le 20 heures dans les camps (1993), au contraire, montre ce que pourrait être un Téléjournal “objectif” et “utile”, bien loin du divertissement actuel proposé sur toutes les chaînes télévisées.
Casque bleu, tout comme le fera Un maire au Kosovo (2000), co-réalisé avec François Crémieux, propose un exemple de ce que devrait être un “vrai” et bon reportage sur la guerre, tel que devrait le pratiquer les journaliste et le montrer les rédacteurs en chef des “news” télévisuelles. En contrepoint au témoignage de François Mérieux, on lira celui du sergent Thomas Goisques, engagé volontairement dans les casques bleus de Bosnie, devenu depuis journaliste-reporter, tout comme le fera Marcel Ophuls dans son documentaire, devenu film de référence : Veillées d’armes (2006). Plutôt qu’une mise en scène montrant un journaliste “sur” les lieux de la guerre, recrachant les informations officielles données lors des conférences de presses, le tout fragmenté par d’innombrables plans de coupe, toujours plus lâches, car cherchant à provoquer l’émotion rapide (cadavres, femmes qui pleurent, enfants mutilés…), offrir un seul visage qui dit directement aux spectateurs son expérience, sans tricherie, sans fioriture, sans valorisation d’un tiers quelconque.
Le résumé de Catherine Blangonnet, dans l’introduction du n° 22 de la revue Images documentaires : la parole filmée décrit parfaitement la situation, en ces mots : “A travers les articles rassemblés ici, c’est une critique de la représentation de la parole à la télévision et une réflexion sur le statut de la parole et du témoignage au cinéma et à la télévision qui est proposée. / Il ne s’agit pas “d’ajouter de la parole à la parole ambiante”, nous dit Jean-Louis Comolli, mais de travailler à “faire entendre” le point de vue des gens sur ce qu’ils vivent. Cette parole est confisquée à la télévision par les journalistes et les hommes politiques. Pierre Bourdieu a bien montré que même quand elle descend dans la rue, la télévision ne recueille auprès des individus qu’un discours d’emprunt, celui que chacun sait que les journalistes veulent entendre. Le témoignage est recueilli à chaud, c’est-à-dire avant que les personnes interrogées aient eu le temps de se forger une opinion.”
Avec Casque bleu, Marker, en plus d’offrir un témoignage fort sur un pan mal connu de l’histoire occidentale récente, donne avant tout et surtout une magistrale leçon de journalisme et de cinéma.

Générique (fin, ordre d’apparition)
Témoignage de François Crémieux
recueilli par Chris Marker
production : Point du jour
Distribution : Films du Jeudi
Commentaire / scénario : non édité
Source de l’article : chrismarker.ch
Transcription Casque bleu de Chris Marker (1995 – 25’20)
Voix off [discours de Jacques Chirac] – « …l’enclave de Srebrenica n’est pas réhabilitée, alors c’est toute la mission de la FORPRONU qui est en cause, tout le moins. Peut-on garantir la zone de Goraz de où se trouve…»
Voix off [speakerine] – « Adieu Gorazde. Le matériel des casques bleus… »
François Crémieux –… c’est-à-dire que j’avais une position de principe sur le service militaire qui était qu’il valait mieux qu’il y ait des appelés qui passent dans l’armée, qui puissent revenir témoigner, dire ce qui s’y passe éventuellement, être, dans une certaine mesure, un contre-pouvoir à l’intérieur de l’armée. Donc j’étais favorable au service militaire.
J’étais… A partir du moment où j’étais favorable au service militaire, relativement favorable à ce que tout le monde le fasse dans les mêmes conditions et où on ne se trouve pas dans une situation où les étudiants… soit les étudiants soit ceux qui avaient des réseaux sociaux relativement adaptés puissent faire leur service militaire dans d’autres conditions que le Français lambda. Donc je suis parti. Au début, j’ai fait mes classes, mes… mon mois de classe, un peu moins d’un mois de classe… comme tout le monde aussi, et il se trouve qu’à la fin de mon mois de classe, le régiment dans lequel j’étais devait envoyer une compagnie en ex-Yougoslavie pour l’été 1994, et donc en novembre, ils ont fait un appel à volontariat parce qu’on envoie que des appelés volontaires en ex-Yougoslavie… Et j’ai répondu oui à cet appel à volontariat et je me suis trouvé ensuite pendant six mois dans une compagnie de préparation et pendant six mois, à Bihac, comme casque bleu.

Raisons [carton] [1’36]
Les raisons pour lesquelles je suis parti, d’abord elles sont un peu compliquées, je suis pas sûr de le maîtriser toutes, mais il y avait un certain nombre de raisons objectives, connues, réfléchies, du type, ben j’étais plutôt favorable à ce que l’ONU intervienne en ex-Yougoslavie, j’étais plutôt favorable à ce qu’on y fasse quelque chose plutôt que rien du tout, j’étais conscient des limites de la mission qu’y existait en novembre 1993 quand on m’a demandé de partir. Ceci dit, je me disais : « Moi, on m’a posé la question de savoir si je voulais partir ou pas. Je peux pas continuer à être pour qu’on fasse quelque chose et le jour où on me demande d’y aller, de prétexter des meilleurs arguments du monde pour dire, ben moi j’y vais pas, d’autres vont le faire à ma place ». Donc, ben, j’ai fini par dire oui et malgré… malgré… malgré plein de pessimisme, malgré plein de réticence par rapport à la mission que je savais qu’on allait me donner… ceci dit, je reviens encore plus pessimiste que je n’étais parti, c’est-à-dire, je ne savais pas tout, je ne savais jusqu’où j’allais m’embarquer.

Images [carton] [2’21]
Ma première image de la guerre, c’est d’avoir survolé la Croatie et d’avoir vu les grandes autoroutes complètement noires parce qu’elles sont vides, et donc, qui dessinaient de grandes, de grandes bandes noires vues du ciel. Et ensuite, on a atterri à Zagreb et on s’est retrouvé dans une base américaine à SOAS (?probablement un acronyme spécifique aux bases américaines), c’est-à-dire avec tous les Burger King, MacDonald qu’on peut imaginer, qui était une base qui ressemblait plus à ce que j’avais pu vivre moi, il y a quelques années, en habitant un peu aux Etats-Unis, que à ce que je pouvais imaginer de ce que la guerre était. Et alors ensuite, la deuxième image de guerre, c’est quand on est allé en camion de Zagreb vers Bihac, qu’on a traversé la Krajina, et que là, j’ai découvert de mes yeux ce que pouvait signifier… un peu, la purification ethnique, sauf que c’est plus dans l’imaginaire que dans le réel, mais ce que peut signifier dans le réel la destruction massive de maisons, la destruction de villages, les no man’s land pendant des kilomètres dans lesquels il n’y a absolument personne… Mais, mais c’est important de savoir que quand on est casque bleu, la réalité, on la rencontre jamais vraiment, c’est-à-dire que quand on rencontre des gens dans un pays en guerre, avec un gilet pare-balles et un fusil, oh ! je suis pas sûr qu’on rencontre vraiment la réalité et qu’on puisse discuter avec eux, entre guillemets, d’égal à égal.


Briefing [carton] [3’23]
On a eu, avant de partir, quelques… quelques exposés qui nous avaient été fait par notre capitaine, commandant l’unité, sur la situation qu’on allait rencontrer là-bas, qui était tous des exposés extrêmement caricaturaux, avec une très très forte connotation raciste. L’idée, c’était de nous préparer à… aux gens qu’on allait rencontrer. Donc, on nous a fait un exposé sur LE Yougoslave qui se déclinait en quatre parties, avec en première partie, le Serbe, le Croate, le Musulman, où on nous expliquait que c’était parce qu’ils avaient vécus dans des régimes communistes, parce qu’ils étaient d’anciens slaves… parce qu’ils étaient slaves ; parce qu’ils avaient vécus pendant cinq années en guerre, c’étaient tous des tueurs au couteau, c’étaient des menteurs nés, ça c’était à cause du communisme, le communisme était un système dans lequel pour survivre, il fallait mentir, donc il nous faudrait, nous, soldats, systématiquement nous méfier de tous les gens qu’on rencontrerait ; parce qu’ils étaient slaves, ils étaient jusqu’au-boutistes, et donc ils hésiteraient pas, éventuellement, à nous tuer au couteau, s’ils en avaient l’occasion. Alors que nous, les Latins, on savait reconnaître nos erreurs, on savait… donc on connaissait les limites à la vie etc., donc on… on n’était pas forcément aussi extrême qu’eux. Et donc, c’était systématiquement une politique de mise en garde vis-à-vis de toutes les personnes qu’on allait rencontrer. C’était également décliné en fonction des gens qu’on rencontrait.
C’est-à-dire, par exemple, il fallait qu’on se méfie particulièrement des femmes, parce que les femmes nous feraient des sourires dans un coin et essaieraient de nous voler notre arme dans l’autre. Les gamins viendraient nous demander des bonbons à l’avant du véhicule pour mieux nous piquer les jerricanes à l’arrière. Et donc c’était systématiquement une… une… un avertissement sur la méfiance que nous devrions avoir vis-à-vis de toutes les populations qu’on rencontrerait.

Histoire [carton] [4’45]
Moi, j’ai eu le droit à un exposé qu’y a dû durer environ un quart d’heure, sur l’ensemble de l’histoire ex-yougoslave depuis la prise du pouvoir par Tito jusqu’à aujourd’hui. C’était extrêmement limité et c’est clair que les officiers, enfin, qui nous donnaient ces cours-là, en savaient vraisemblablement moins que moi et en tout cas pas beaucoup plus, et… Mais surtout, leurs prétextes systématiques, c’était de dire : « on part avec des gens qui sont pas tous très intelligents, dont très très peu d’entre eux ont fait des études, qui sont relativement peu capables de comprendre ce qui se passe là-bas, donc notre objectif, c’est de leur apprendre à manier leur arme, à la nettoyer, à utiliser leur véhicule. Peut importe, à la limite, qu’ils sachent précisément ce qui se passe là-bas…
C’était ça, aussi, un peu le discours. C’était de dire : « Peu importe ce qui se passe. L’important, c’est d’obéir aux ordres, de toute façon, les ordres sont bons parce qu’ils sont des ordres et parce que vos chefs, eux, savent ». Donc, imaginer que quelque part dans la hiérarchie, il y a quelqu’un qui maîtrise parfaitement le conflit, faites votre boulot, obéissez, faites ce qu’on vous dit de faire, tout se passera bien et peu importe pour vous de comprendre très précisément ce qui se passent là-bas, de toute façon, c’est très compliqué, ils se sont toujours tirés dessus, et on va essayer de maintenir la paix entre des… entre des gens qui ont pour unique ambition dans la vie d’utiliser des armes, donc… d’abord c’est compliqué, d’autre part, c’est pas forcément très intéressant de comprendre ce qui se passe ».
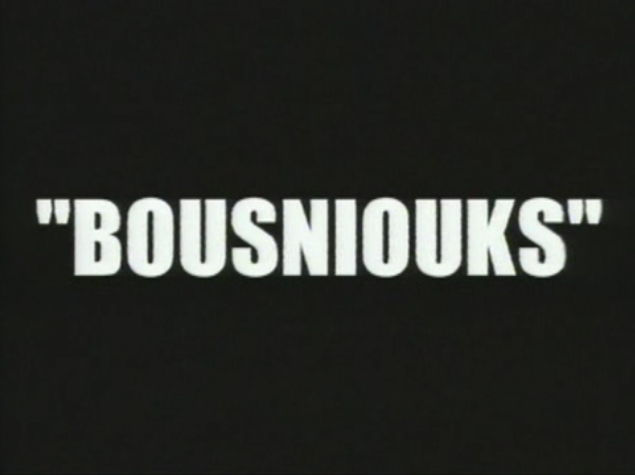
“Bousniouks” [carton] [5’56]
Ensuite, on recalque sur la… sur la situation en ex-Yougoslavie un certain nombre de… de grilles de lecture bien françaises. C’est-à-dire, par exemple, au début, nous étions, bien entendu, neutre. On nous avait donné le vocabulaire. On devait parler des belligérants, on devait parlé des parties. A Bihac, on devait parler des Musulmans du nord et des Musulmans du sud. En aucun cas, on ne devait parler ni des Serbes, ni des Musulmans, ni des Croates, ni des Bosniaques etc. On avait un vocabulaire onusien adapté, mais, au bout de quelques… au bout de quelques semaines, les Musulmans c’étaient quand même, finalement, un peu les mêmes que les Musulmans à Paris, donc un peu des Arabes, et le vocabulaire qui était rapidement utilisé, d’abord par les officiers, les sous-officiers, puis par les soldats, par mimétisme, c’est de parler des Bousniouks, en référence aux Bounioules français, parce que, ben finalement, les Musulmans sont les mêmes partout et puis qu’y a ces mêmes mosquées, il y a les mêmes Allah-akhbar, le soir, comme appel à la prière, et puis, là-bas comme ici, de toute façon, ils égorgent les moutons et ils… et c’était vraiment de ce niveau là, c’est-à-dire que je ne cherche même pas à caricaturer à posteriori. C’était vraiment du racisme vraiment basique et vraiment vraiment simple. Et puis, il y a d’autre part une certaine fascination pour les Serbes, qui est largement organisé. Nous, on n’en a jamais rencontrés de Serbes, à Bihac.
Donc, la fascination que les soldats pouvaient avoir, ne pouvait être que celle qui leur était dictée par les officiers ou les sous-officiers, et donc c’était de dire, les Serbes, eux, sont une armée de professionnels, ce qui n’est pas le cas Musulmans. Ils savent où ils vont. Ils savent ce qu’ils veulent faire, avec pour les officiers, en plus, un certain background historique de vieille alliance et de vieille amitié franco-serbe qui n’avait, à mon avis, de sens pour personne, pas pour moi en tout cas, et je pense, pas pour eux non plus, mais ils finissaient par y croire, et donc on est quand même parti d’un… d’un… d’une neutralité d’apparence, au début, vers un parti pris indéniable pour les Serbes, au bout de quelques semaines, pour des raisons, certaines sentimentales, d’autres politiques, d’autres historiques, mais qui étaient toutes relativement floues, en tout cas.

Agresseur [carton] [7’40]
C’est-à-dire que quand on est dans un pays en guerre, armé, et qu’on a ordre de ne pas utiliser les armes, on est, de fait, du côté de l’agresseur, du côté de celui qui essaie de conquérir du terrain. A Bihac, ça signifiait indéniablement être du côté des Serbes parce que, ben, c’étaient les Serbes qui essayaient de prendre la poche, qui essayaient d’avancer, de gagner du terrain, et donc, c’étaient eux qui nous faisaient reculer. Donc, de fait, on a, à mon avis, jouer un peu le jeu des Serbes parce qu’on a refusé d’utiliser nos armes pour les empêcher d’avancer.

Mission [carton] [8’04]
Officiellement, quand on arrive comme casque bleu, on… on nous donne, enfin, on nous donne pas une liste, mais on nous donne quatre missions officielles ordonnées par l’ONU, qui sont premièrement de faire de l’escorte de convois humanitaires. C’est supposé être… moi, je croyais que c’était la mission principale pour laquelle je partais, que j’allais passer ma vie (j’étais conducteur d’un véhicule blindé), je pensais que j’allais passer ma vie sur les routes de la poche de Bihac à escorter les convois d’aides humanitaires. En fait, cette mission là, moi, je l’ai rempli que trois fois, c’est-à-dire que je n’ai escorté que trois convois parce que rapidement la poche de Bihac a été encerclée par les Serbes de Bosnie… les Serbes de Croatie au nord et les Serbes de Bosnie au sud, et donc aucun convoi du HCR ne rentrait plus dans la poche.
Donc, il n’y avait plus de convoi à faire. Il n’y avait plus rien à protéger.
La deuxième mission, c’était de faire de l’observation. C’est-à-dire que l’ONU essaie de savoir ce qui se passe, essaie de savoir qui tire, qui tire sur qui, qui tire en premier, qui tire où, qui tire quoi, et donc, on allait régulièrement, ben, le plus près possible des lignes de front pour essayer de savoir ce qui se passait. En fait, le plus près possible, c’était en général à quelques kilomètres, cinq, six, sept kilomètres, parce que… ben, ceux qui étaient sur le front nous empêchaient d’approcher plus. Et donc, il s’agissait, ben, à l’oreille, de savoir ce qui se passait. On avait des tables… des tables en bois avec une feuille dessus pour noter… on avait, en colonne, « Serbe », « Croate »… « Serbe », « Bosniaque » ou « indéterminé », en ligne, « rafale légère », « rafale lourde », et puis, on faisait des… des croix ou des bâtons à chaque fois qu’il y avait une rafale légère d’origine serbe. A la fin de la journée, après s’être passé la planche de… de soldat en soldat, ben, on fait le total par lignes et le total par colonnes, et puis tout cela est centralisé, comme ça l’ONU sait, ou en tout cas est supposé savoir ce qui se passe et où est-ce que les tirs reprennent, où est-ce que les tirs se sont estompés, où est-ce que… où est-ce que c’est plutôt du mortier ou plutôt des armes légères qui tirent.
La troisième mission, c’était de faire les patrouilles. Là, l’idée c’est que l’ONU, à partir du moment où elle était présente sur le terrain, elle voulait se montrer et se… voulait que les gens la voit, et donc, il s’agissait, en fait, d’aller et de monter nos gros véhicules blancs avec nos belles armes bien huilées etc. Alors on allait, on avait quelques lieux-dits dans lesquels on s’arrêtait, qui étaient des fermes où on était accueilli, où on nous offrait le café et, éventuellement, la slivovitz, l’alcool de prunes local, et ça se limitait vraiment à ça, comme par ailleurs, aucun des… moi, j’étais dans un groupe de combat, donc on était une dizaine, aucun d’entre nous ne parlait le serbo-croate, donc j’étais le seul ou presque à parler un peu l’allemand ou l’anglais. Donc, on arrivait parfois à communiquer avec quelques… quelques mots d’allemand, quelques mots d’anglais, mais c’était extrêmement limité et il c’était, il n’y avait aucun moyen d’avoir une conversation un tant soit peu subtile ni sur le conflit, ni sur ses origines, ni sur quoique ce soit. Donc, on parlait de femmes, on parlait d’alcool, on parlait de sexe, on parlait de ce que tout bon militaire qui se respecte parle, notamment quand il est à l’étranger, et ça n’avait pas d’autre intérêt que ça. Et puis, deuxième, non, la deuxième chose importante par rapport aux patrouilles, c’est l’occasion de petit trafic. C’est-à-dire qu’on avait, nous, par exemple, des Malboro ou des produits qu’on pouvait acheter au foyer français, et qu’on échangeait, la plupart des soldats, par exemple, voulaient absolument ramener des baïonettes kalachnikov, et donc qu’ils échangeaient contre une ou deux cartouches de Malboro qui nous coûtaient pas très cher parce qu’elles étaient détaxées. Ils échangeaient une ou deux cartouches de Malboro contre des baïonnettes kalachnikov. Parfois, ça allait jusqu’à acheter des armes, c’est-à-dire des kalachnikov que la… que la prévôté du bataillon s’occupait de faire démilitariser et qu’on pouvait ensuite ramener en France. Mais c’était un trafic relativement limité, principalement limité parce que les Français sont pas en manque, c’est-à-dire que comme on avait un foyer bien achalandé, on n’avait pas tellement de raisons et de… et de motivation pour trafiquer, mais on en faisait un peu.
Et la dernière mission, c’était, eh ben, de nous protéger nous-mêmes, et donc, de protéger notre base. Moi, j’ai passé plusieurs heures en haut d’un mirador, de jour comme de nuit, à observer ce qui pouvait se passer alentours. Sur les postes d’observation, il y avait des gardes vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ou il s’agissait également de protéger nos propres convois, c’est-à-dire que quand l’ONU transporte son essence, ses véhicules, ses pièces détachées etc., ben il faut, même chose, des véhicules blindés pour les protéger, ne serait-ce que pour ne pas se faire piquer les camions, plus que leur contenu, et donc, là, c’est presque à cette mission là, moi, que j’ai consacré le plus de temps : la mission de protection de nos propres bases et de nos propres installations.
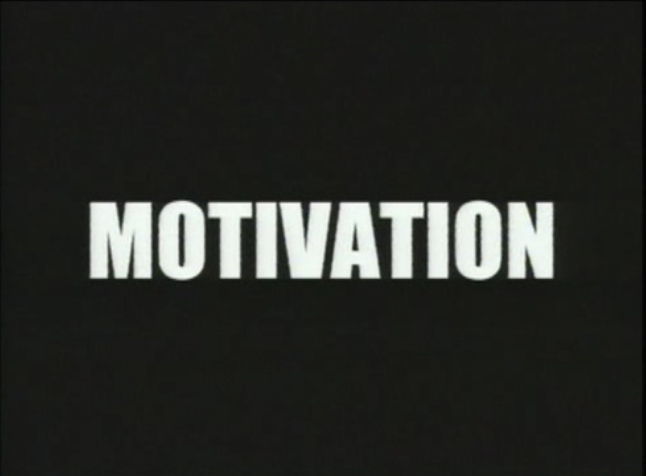
Motivation [carton] [11’52]
La motivation principale, je crois que c’est objectivement l’argent. C’est-à-dire que quand on part en ex-Yougoslavie, qu’on est soldat, on a une solde qui passe de 500 francs à, entre 8’000 et 10’000 à peu de choses près, et pour des gens, pour la plupart d’entre-eux, un peu paumés, qu’ont pas grand chose à l’extérieur, qui souvent sont jeunes parce que si on se retrouve dans une compagnie d’infanterie, c’est souvent parce que, donc, on n’a pas voulu faire autre chose, donc, sans doute, qu’on n’a pas de boulot, qu’on n’a pas fait des études etc. Donc, c’était une somme d’argent extrêmement importante et relativement attirante.
D’autre part, c’est des gens qui on essayé, un peu comme moi, d’échapper un peu à l’enfer militaire traditionnel, c’est-à-dire que, si vous imaginez que vous mettiez des militaires dans une caserne, vous les empêchez de sortir, vous les payez 500 balles par mois et vous leur dites brusquement, au bout de trois ou quatre mois d’enfermement, vous pouvez partir en Yougoslavie, vivre autre chose, être volontaire et gagner 10’000 balles, c’est relativement tentant, et donc, c’est un peu une clientèle assez captive. Donc, c’est là les deux motivations principales. Il y a un peu l’aventure. Mais, j’y crois pas tellement parce que l’aventure est quand même quelque chose qui fait un peu peur par rapport à la Yougoslavie quand on a entre 18 et 25 ans, on est quand même un peu effrayé. En plus, la famille, autour, a quand même tendance un peu à limiter cette envie là. Quant aux volontés plus… aux motivations plus nobles, entre guillemets, qui seraient de vouloir partir pour l’ONU, pour… pour une idée d’une armée internationale etc., bon, moi j’avais le sentiment que c’était extrêmement limité, mais c’était limité parce que les gens qui se trouvent dans une compagnie d’infanterie ont vraiment pas de raisons de partir pour ces motivations là. Ceux qui pourraient les avoir, sont pas à cet endroit là. Donc, c’est un peu lié au recrutement, à la base, de l’armée française.

Engagés [carton] [13’21]
Les engagés, ils le disent, ils le revendiquent, ils pensent même que c’est une motivation noble, ils partent là-bas parce qu’on leur a donné l’ordre de le faire et comme ils sont de bons militaires, ils ont obéis. Mais parmi eux, aucun n’est parti là-bas pour des raisons… pour des raisons autres que des raisons de service. C’est-à-dire qu’ils partent là-bas parce qu’ils triplent leur solde, parce que c’est une perspective de promotion, en terme de carrière et de perspective de carrière. Mais aucun d’entre-eux ne revendique de partir là-bas pour les Droits de l’Homme ou pour l’humanitaire. Ils revendiquent même que ce ne soit pas le cas. C’est-à-dire qu’ils seraient partis là, ils seraient partis n’importe où ailleurs où on leur aurait donné ordre de partir.
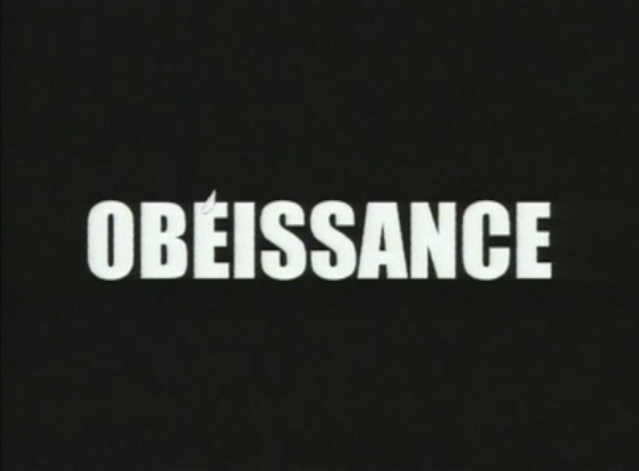
Obéissance [carton] [13’51]
Jusqu’où les militaires sont prêt à obéir ?
Moi, d’ailleurs, enfin, je me suis posé la question, c’est-à-dire que je m’étais dit : « il faut que je me fixe des limites morales à ce que je peux faire ». J’avais un peu lu un peu des livres sur ce qui s’était passé en Algérie ou ailleurs. Et donc j’avais peut-être fantasmé, j’en sais rien, sur l’idée de me dire « il faut que je me fixe des limites », c’est-à-dire faut que ma… faut que ma conscience m’empêche de faire éventuellement un certain nombre de choses, y compris ce qu’on pourrait me donner ordre de faire. Je constate, d’abord, à posteriori, que j’ai tout fait. C’est-à-dire que j’ai obéis à tous les ordres qu’on m’a donnés. Donc la… Alors, est-ce que c’est parce que j’ai jamais été confronté à la limite de la désobéissance ou est-ce que c’est parce que j’ai pas osé le faire ? Je sais pas. Et donc… Voilà ! Après, ce que les militaires sont capables de faire, moi, je crois qu’ils sont, les militaires engagés sont capables d’aller très loin, parce que le… l’obéissance est vraiment un culte à l’intérieur de l’armée, que d’obéir à son chef est en soi un honneur, indépendamment même de l’ordre, indépendamment même de l’acte que l’ordre va impliquer. Et donc, moi, je crois vraiment que, en plus… en plus l’armée est une institution relativement forte, qui est capable de… la preuve, qui est capable de faire faire à peu près ce qu’elle veut à plein de gens, y compris ceux qui avaient essayé de se fixer des limites de départ. Ceux qui en ont pas et qui ont théorisé le fait que de ne pas en avoir était une bonne chose, eux, je pense, sont prêt à aller presque jusqu’à… presque jusqu’à n’importe où.

Chiens [carton] [15’01]
Notre capitaine, commandant d’unité, avait organisé des tueries de chiens. C’est-à-dire que sous le prétexte, au départ, relativement noble,qu’il y avait trop de chiens sur la base et que ça posait un problème de santé publique, qu’il allait falloir commencer à éliminer des chiens et l’élimination des chiens, au début, de façon relativement propre, bon ! avec des armes, mais relativement propre et relativement limité, s’est transformé en un concours de tuerie de chiens, parce que c’était un moyen de défouloir et de… et d’utilisation et de test des armes. Mais les chiens, on allait les chercher. Au début, il y en avait sur la base. Après on allait dans les décharges. On allait tuer les chiens des décharges. Alors, on prétextait que c’était mieux pour la population que de voir ces porteurs de virus, j’allais dire exécutés, tués, mais euh… mais c’était plus le souhait des officiers d’aller là où on pouvait tuer, là où on pouvait trouver la mort.
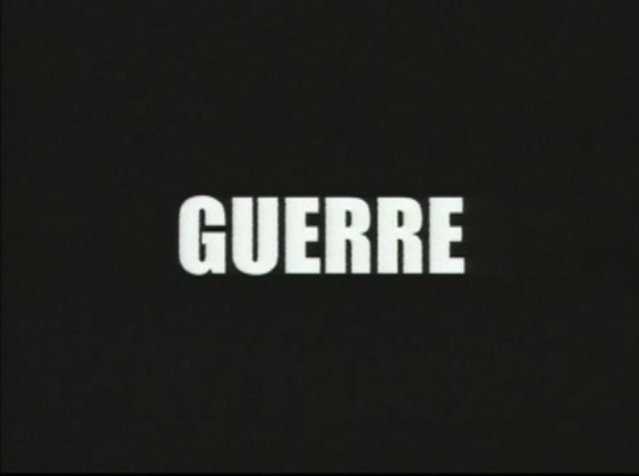
Guerre [carton] [15’46]
Des contacts que j’ai eu avec la guerre, c’est plus des contacts avec ceux qui vivent la guerre. C’est-à-dire qu’on a fini, qu’on finissait par se lier un peu d’amitié… c’est un grand mot, mais qu’on finissait par se lier un peu avec, notamment, des enfants qui étaient autour des postes d’observation parce qu’y avait pas d’école, parce qu’ils s’ennuyaient, donc ils venaient près de nous. En plus, ils avaient des bonbons, des rations de combat, etc. On avait un petit kilo de richesses qui faisaient qu’on attirait un peu les enfants, et donc, on discutait avec eux, et au travers de leur vie à eux, on pouvait approcher, dans une certaine mesure, la guerre, et voir les différentes galères qu’ils vivaient.
Le fait qu’à14 ans, ils étaient responsables de la maison parce que le père était plus là. Donc, il fallait qu’ils s’occupent des animaux, des gens, etc.
C’est… Moi, c’est le contact le plus émotionnel que j’ai eu avec la guerre.
Ensuite, on avait un contact avec, si on parle de la guerre… pour parler des armes, un contact avec les armes de la guerre régulièrement, à chaque fois que l’on passait des checkpoints, et on avait éventuellement des petits ennuis, quoi. Passer un checkpoint, y avait un militaire qui éventuellement braquait une kalachnikov contre le véhicule pour nous demander de faire demi-tour ou autre. Donc là, c’est le… c’est le contact le plus… le plus proche de l’image traditionnelle de la guerre.
La dernière chose, c’est si on parle de la guerre comme, comme contact avec la mort. Là on a eu un contact relativement concret, parce que régulièrement la FORPRONU était chargée d’aller faire ce qu’on appelait nous les ramassages de cadavres, les missions cadavres, sur les lignes de front, les lignes de front, sur lesquelles personne ne peut aller parce que, bon, on se fait tirer dessus par les tireurs d’élite d’en face. Et donc, l’ONU organise des petits cesser-le-feu qui dure deux heures, trois heures, quatre heures ou une demi-journée. Et donc, on va là-bas vers 14h. On rentre dans le no man’s land en faisant attention que les différentes parties respectent le cesser-le-feu. On protège le ramassage des cadavres par une commission désignée par les uns et une commission désignée par les autres. Et puis, ben, quatre ou cinq heures plus tard, on repart. Et là, moi, pour la première fois de ma vie, eh ben, j’ai vu… j’ai vu des cadavres, quoi, que j’avais jamais eu l’occasion de voir avant. Et là c’est… c’est un évènement, un contact avec… un morceau de la guerre.
Ce serait pas honnête de pas dire, à posteriori, que c’était des missions qui avaient une certaine forme d’excitation. C’est-à-dire que quand on nous disait « vous allez partir pour une mission cadavres », d’abord on était, entre guillemets, contents de participer à cette mission là. C’était pas le cas de tous. On se disait que… qu’on allait vers, enfin, qu’on allait vers la guerre et euh… et bon, je peux en avoir honte à posteriori ou autre, mais il y avait une certaine fascination pour cette activité là, qui était l’activité la plus euh… la plus guerrière, la plus proche de la mort etc., qu’on pouvait avoir. D’autre part, quand on… quand je me suis retrouvé, donc, à voir pour la première fois de ma vie un cadavre tué par balles, autour d’une maison, qui était resté là depuis un certains temps etc., j’ai découvert que c’était l’un des côtés les moins inhumains de la guerre. C’est-à-dire que moi j’avais été infiniment plus marqué, touché par les gamins que j’avais rencontrés avant qui m’avaient parlé de choses et d’autres, de leurs histoire, d’aventures… d’aventures sans forcément grande importance. Là, j’ai découvert que même pour celui qui en avait jamais vus, voir des cadavres, les ramasser etc., c’était finalement pas si difficile que ça, tellement ça semblait complètement déshumanisé.

Mort [carton] [18’34]
Par rapport à notre propre, enfin… parler avec le je, par rapport à ma propre mort, c’était… c’est quelque chose d’ambiguë, c’est-à-dire que c’est euh… paradoxalement, c’est une idée qui vient quand elle n’a pas de raisons de venir, c’est-à-dire que c’est par exemple, le soir, quand on est déprimé parce qu’on a pas reçu de lettres de sa copine ou de ses parents, parce qu’on se dit « mais qu’est-ce que je fais là ? » etc., que brusquement, on rentre dans un mécanisme de réflexions, on se dit « mais qu’est-ce que je suis venu prendre le risque de me faire tuer ici, dans une guerre à laquelle je comprends pas tout, qui a l’air vachement compliquée etc. » et brusquement, on a une… on a deux heures d’angoisse. On se dit qu’il vaut mieux dormir et que ça ira mieux le lendemain. Mais on ne retrouve jamais confronté à sa propre mort dans les conditions… enfin, au moment où elle risquerait effectivement d’arriver. C’est-à-dire que plusieurs fois le véhicule que je conduisais s’est fait braqué par des kalachnikov, des véhicules… des armes anti-chars, etc., où je me suis dis « j’espère qu’il y en a pas un qui va faire une connerie, ou ne serait-ce qu’une erreur, et tirer par hasard ou volontairement, je sais pas quoi », mais là, on n’a pas peur, on n’a paradoxalement pas peur. C’est-à-dire qu’on se dit « ben voilà ! je vais faire demi-tour avec mon véhicule et puis ça ira mieux plus tard », mais on a aucune angoisse.

Demi-tour [carton] [19’33]
Ça créé deux types d’impatience, c’est-à-dire que les militaires engagés, eux, ont une vrai… ont un amour propre de militaire, de blessé. C’est-à-dire qu’ils ont des armes, ils ont pas le droit de s’en servir. On les oblige à faire demi-tour. Ils ont l’impression que le mec en face d’eux est un rigolo, qu’il a pour tout armement un revolver, à la limite, même, on sait même pas s’il est chargé ou pas, on n’en sait vraiment rien, et on fait demi-tour devant… devant le symbole de l’homme armé plus que devant l’homme armé lui-même. Moi, d’abord, effectivement, j’avais pas d’amour propre de militaire, c’est-à-dire que faire demi-tour devant des armes, je trouvais pas ça humiliant. C’est-à-dire que… ça me choquait pas outre mesure. Par contre, c’est que c’est… mais là aussi, c’est plus à posteriori qu’on le réalise, c’est clair que par rapport aux idéaux pour lesquels je partais, faire demi-tour devant… devant le moindre Serbe, c’était un reniement… c’était vraiment le reniement ultime qu’on pouvait faire. Mais… Mais encore une fois, sur le coup, on… sur le coup on fait demi-tour parce qu’on est dans l’ambiance de faire demi-tour. Si on nous avait mis dans l’ambiance de résister, avant même que le Serbe soit arrivé, on aurait discuté entre nous dans le véhicule blindé. On se serait dit « au moins si aujourd’hui, il y en a un qui vient, et ben, on partira pas, on restera dans le véhicule, quitte à ce que, éventuellement, il y en ait un de nous qui reste », et je suis sûr que si on avait été mis dans cette ambiance là, on aurait accepté le risque, éventuellement, qu’il y en ait un qui y reste. Mais on était mis dans l’ambiance dans laquelle à chaque fois que quelqu’un vous demande quelque chose… avec une arme, vous faites demi-tour, vous rendez compte et, éventuellement, vos chefs aviseront plus tard.

Politique [carton] [20’50]
J’ai découvert (et je pense que c’est… quand on regarde la télévision, c’est relativement évident), on a une armée extrêmement respectueuse du pouvoir politique. Et en plus, ils sont respectueux du pouvoir politique, malgré la critique qu’ils peuvent en faire. C’est — à — dire que les militaires sont quand même relativement, quand les langues commencent à se délier le soir, sont relativement acerbes vis — à — vis du pouvoir politique et pensent que les politiques sont des incapables par rapport au règlement du conflit yougoslave. Et donc… mais ils sont respectueux, ils sont respectueux jusqu’au bout et ils se posent pas tellement d’états d’âme, et moi je trouve que c’est un point positif. Quand, par exemple, certains intellectuels ont commencé à suggérer, il y a quelques mois, « mais les casques bleus doivent désobéir, ils doivent cesser d’appliquer ces ordres etc. », moi, j’avais une position qui était de dire, d’une part, qui était de dire non, pour deux raisons : d’une part, parce que, le jour où dans une démocratie l’armée se met à faire ça, si elle le fait en Yougoslavie, elle peut le faire n’importe où ailleurs ; mais d’autre part, surtout, le jour où les militaires se mettraient à désobéir en ex-Yougoslavie, je suis pas certain qu’ils seraient du côté de… du côté que défendent ces mêmes intellectuels.

Mensonge [carton] [21’42]
J’ai menti à un certain nombre de gens, c’est — à — dire qu’il y a un certain nombre, soit d’enfants, soit même de femmes qu’on a eu l’occasion de rencontrer, à qui on avait dit à certains moments : « mais oui, on vous aidera », parce que quand on est autour d’un café, on peut pas faire autrement que de dire ça et puis parce que, dans une certaine mesure, on y croit. « Mais oui, on vous aidera. Si la guerre arrive, vous avez qu’à venir nous rejoindre dans le poste d’observation. Si vous avez besoin de quelque chose, venez nous voir ». En plus on avait lié un peu des liens d’amitié… Et donc… et puis le jour où la guerre arrivait, on était même plus sur le poste d’observation qu’on avait déménagé deux jours avant parce que nous… enfin, nous, la FORPRONU l’avait prévue, alors que les habitants autour du poste d’observation ne l’avait pas prévue. Donc, on a le sentiment, moi, j’ai le sentiment d’avoir euh… d’avoir euh, floué un certain nombre de gens, à titre personnel, c’est — à — dire avoir dit « je vous aiderai » et de pas l’avoir fait.

Positif [carton] [22’23]
L’aspect positif, indéniablement, il y en a eu. Les quelques convois de farine que j’ai escortés, c’était positif. On a plusieurs fois aussi escorté des… des convois d’échange de prisonniers ou de blessés, et c’est des trucs, même chose, sur le plan émotionnel, qui était vachement fort parce qu’on arrivait avec les véhicules plein de prisonniers ou plein de blessés dans l’hôpital, enfin dans l’hôpital, on les ramenait dans leur hôpital et donc des cris de joie etc. Et donc, sur le plan émotionnel, on a vécu un certain nombre de choses. Des soirées où on se dit, indéniablement, qu’on a été utile et qu’on n’était pas là pour rien.Ceci dit, on a, on a l’impression, c’est une image traditionnelle, quoi, d’être sur le pont d’un navire et puis sur le pont on fait quelques trucs bien et quelques trucs moins bien, mais surtout le navire ne va pas dans la bonne direction.

ONU [carton] [22’59]
Si l’ONU continue à cautionner ce qui se passe là — bas, après, c’est terminé, on ne fera plus rien, je veux dire, l’ONU ne fera plus rien nulle part. Moi, on n’est pas prêt de m’y reprendre. On n’est pas prêt de m’envoyer sous le casque bleu n’importe où ailleurs dans le monde, parce que je sais à quoi ça sert et je sais que c’est pas, que c’est pas, que c’est pas fait pour… ni pour aider les opprimés ni pour toutes ces idées aussi naïves les unes que les autres que je pouvais avoir avant de partir. Donc il y a aussi l’idée d’essayer de sauver un tant soit peu ce qui peut y avoir aujourd’hui de… enfin d’organisation internationale et d’État au — dessus de l’État et d’armée euh… d’armée composée de tous etc.

Bilan [carton] [23’36]
… je pars de là — bas, j’aurais été incapable de raconter tout ça, et je ne l’avais pas, je l’avais très peu réalisé, entre guillemets, théorisé, c’est — à — dire que je me rendais compte d’un certain nombre de chose, mais c’était extrêmement superficiel. Quand on est rentré, moi, y a eu un… par rapport au conflit… au conflit bosniaque, il y a eu un élément déclencheur : c’est le bombardement de Bihac par les Serbes et l’entrée des Serbes dans la poche de Bihac, où là je me suis dit : « Oulah ! Quoi… Pourquoi ? Pourquoi j’étais là — bas ? », c’est — à — dire que ça n’a vraiment servi à rien et à la fin de deux ans de présence française et de six mois de ma présence à moi dans la poche de Bihac, les Serbes entrent. Donc c’était… c’était vraiment révélateur et symbolique de ce qu’on y avait fait ou de ce qu’on n’y avait pas fait.
Et puis ensuite, pour ce qui est de tout… de tout le reste, c’est — à — dire de tout ce qui concerne pas directement les contingences géopolitiques locales etc., ça remonte à la surface lentement… d’abord parce que l’armée, encore une fois, est quelque chose dont on a du mal à se sortir et qu’on continue à se lever tôt, enfin à se réveiller tôt le matin et à rêver de l’armée etc., parce que c’est une institution dans laquelle on a baigné pendant quatorze mois et notamment, six mois, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, là-bas, et donc, on est relativement pris par ça. Et puis, ça remonte que petit à petit. On a… En plus, on a un dernier petit problème, c’est que c’est un peu le problème de tous les bidasses qui sortent de l’armée, c’est que les copains etc. veulent bien entendre les histoires pendant euh… une soirée, mais certainement pas plus longtemps que ça, et qu’en plus, on se rend compte que ça sert à rien et on le raconte une fois, et en plus, soi-même, à la fin, on en a marre de parler à tout le monde de la Bosnie etc. Et donc, on a un problème de savoir comment l’extérioriser, comment en parler. Mais on a aussi ce problème là, c’est que les gens prêt à vous écouter comme vous venez de le faire, pendant presque une heure sur la Yougoslavie, il n’y en a pas beaucoup.
Témoignage de François Crémieux [carton]
recueilli par Chris Marker [carton]
Transcription de l’entretient “Casque bleu” en PDF
- Nathalie Mary, “Témoignage d’un casque bleu recueilli par Chris. Marker”, Bref, n° 28 (printemps 1996), p. 3
- “L’expression anglaise Talking Heads (les têtes parlantes) est employée généralement dans un sens péjoratif comme une forme particulièrement paresseuse de faire du cinéma” (Catherine Blangonnet, “Introduction”, Images documentaires, n° 22 (1995), p. 9)
- Arnaud Lambert, Also Known as Chris Marker, Paris : Le Point du Jour, 2008, p. 155

